L’âge industriel en Nouvelle Zélande du milieu du XIXème au milieu du XXème siècle
Coloniale Oceanie_Pacifique Premiere
Mis à jour le lundi 17 mars 2025 , par
Plan
I- Mise au point scientifique
1- Tableau de la vie économique
2- Vie politique et combats sociaux
3- Vers une société modèle ?
II- Exploitation pédagogique
1- les accompagnements de programmes
2- présentation de la séquence
3- organisation de la séquence
III- Présentation des documents
Sélection des documents
1- La révolution de la congélation
2- un grand savant, lord Ernest Rutherford
3- La révolution des communications
4- Trois grandes figures politiques néo-zélandaises
5- Le monde de la mine
6- L’Industrial Conciliation and Arbitration Act
7- Tableau des conflits sociaux de 1890 à 1945
8- Trois types de contestation, une volonté de changement
9- Les grèves de 1912-1913 : un échec
10- Des syndicats tout puissants ?
11- Tableau comparatif des progrès sociaux
12- Deux interventions de l’État
13- Auckland
14- Deux aspects de la société néo-zélandaise
15- La population maorie vers l’intégration ?
Bibliographie générale
Il existe très peu d’ouvrages en français abordant, de près ou de loin, ce sujet.
On retiendra surtout :
– LEXTREYT Michel, Nouvelle-Zélande, Papeete, Au Vent des Iles, 2006.
– TOLRON Francine, La Nouvelle-Zélande, du duel au duo, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2000.
En Anglais, les ouvrages généraux de vulgarisation englobant ce thème sont légion. Citons :
– BELICH James, Making peoples, a history of New Zealanders, Auckland, Penguin books, 1996.
– BINNEY Judith et al., An Illustrated History of New Zealand, 1820-1920, Wellington, Allen & Unwin, 1990.
– Collectif d’auteurs, The Oxford history of New Zealand, Auckland, Oxford University, 3e édition, 1992.
– New Zealand Historical Atlas, Auckland, David Bateman Ltd, 1997.
– SINCLAIR Keith, A History of New Zealand, Auckland, Penguin Books, 5e édition, 1991.
Sur Internet, on pourra toujours consulter :
www.NZHistory.net.nz
Une ressource photographique de premier ordre peut être consultée :
– le site Internet de l’Alexander Turnbull Library. Une fois en page d’accueil, aller sur View digital collections, puis sur
Timeframes
++++
I- MISE AU POINT SCIENTIFIQUE
La Nouvelle-Zélande est longtemps demeurée un pays à vocation agricole qui a fondé son économie sur
l’élevage ovin. Toutefois, dès la fin du XIXe siècle, ce pays s’ouvre à l’industrie. Industrie agro-alimentaire
d’abord, puis industrie extractive et industrie de transformation ensuite. C’est ainsi qu’aux premiers colons, qui
étaient avant tout des ruraux, se mêlent de nouveaux immigrants issus du monde ouvrier qui vont donner une
autre coloration à la société néo-zélandaise. Quoiqu’il en soit, sous la pression d’une action syndicale active mais
contrôlée et grâce à des hommes politiques souvent entreprenants ou inventifs, la Nouvelle-Zélande se dote d’un
système socio-économique original qui en fait un temps un modèle pour les nations développées. Notons
toutefois que ces changements s’observent dans le monde anglo-saxon dominant et non au sein de la
communauté maorie, marginalisée tout au long de cette période et qui a même connu une véritable descente aux
enfers.
I – Tableau de la vie économique : un essor tardif qui surmonte les crises
Malgré certaines hésitations, le bilan économique néo-zélandais sur l’ensemble de la période est tout à fait
positif. Il témoigne d’un pays dynamique qui a su faire face à ses problèmes internes comme aux aléas de la
conjoncture internationale pour s’installer dans une vraie prospérité.
1- Les fondements de l’économie néo-zélandaise
La Nouvelle-Zélande est un pays neuf. Rattachée à la couronne d’Angleterre par le traité de Waitangi de 1840,
elle a longtemps servi d’exutoire à un colonat trié sur le volet, composé de familles respectables et laborieuses.
Ces « colons Wakefield », du nom du promoteur de cette immigration que l’on souhaitait modèle, se sont
attachés à mettre en valeur le pays et l’ont orienté très tôt vers l’élevage, omniprésent. C’est donc un monde
profondément rural, conservateur et un rien puritain qui aborde les années 1870 et les débuts de la révolution
industrielle en Nouvelle-Zélande. Ce monde entretient par ailleurs des liens étroits avec la mère patrie, qui
absorbe la quasi-totalité de ses exportations.
De fait, la révolution industrielle apparaît, au moins dans un premier temps, comme extérieure au pays. Si
certaines initiatives sont bien locales, le monde ouvrier naissant se nourrit des vagues d’immigration de la fin du
XIXème siècle et les usines se développent dans les ports ouverts au commerce avec l’Angleterre. Seule
l’extraction minière et certaines branches de l’industrie agro-alimentaire échappent à ce schéma. En tout cas, en
Nouvelle-Zélande peut-être plus qu’ailleurs se creuse un fossé considérable entre le monde rural et le monde
ouvrier, issus de deux horizons radicalement différents et qui ne se comprennent pas.
La situation du pays, aux antipodes de l’Europe, l’amène à être très présent dans l’aventure des communications
dont le développement conditionne l’essor économique, du fait de son économie extravertie. Cette ouverture sur
l’extérieur provoque aussi une grande sensibilité aux crises qui ont jalonné la période et qui ont frappé le pays de
plein fouet.
Enfin, la taille modeste de la Nouvelle-Zélande lui permet de se lancer dans des expériences de tous ordres
impossibles à envisager ailleurs et qui en ont fait un véritable laboratoire économique et social.
2- Une entrée tardive dans la révolution industrielle
On peut faire remonter l’entrée de la Nouvelle-Zélande dans la révolution industrielle aux années 1870 - 1880.
Ces années sont dominées par un homme politique d’exception, Julius Vogel. Vogel a souhaité engager le pays
dans l’économie moderne en développant l’industrie et les voies de communications. Il s’est donc lancé dans une
politique de grands travaux qui ont nécessité à la fois capitaux et main d’œuvre.
Afin de résoudre les problèmes financiers considérables qui se posent à la colonie, Vogel propose un budget
déficitaire qu’il rééquilibre en contractant un emprunt de six millions de livres auprès des banques anglaises.
Suivant une démarche keynésienne avant la lettre, il prône une politique d’investissements fondée entre autre
sur la construction de routes ou de lignes de chemin de fer, de manière à équiper le pays tout en fournissant du travail et donc en renforçant le pouvoir d’achat des ménages. En fait, entre 1869 et 1875, la Nouvelle-Zélande
emprunte jusqu’à vingt millions de livres, ce qui donne un réel coup de fouet à son économie mais inquiète fort
la bourgeoisie coloniale en place. A-t-elle tout à fait tort ? Les gains en effet ne suffisent pas à assurer le
remboursement de la dette. Avec l’arrivée de la dépression économique mondiale, les banques qui ont misé sur
la réussite de la politique Vogel resserrent leurs conditions de crédit, ce qui finit par stopper la croissance et
provoquer la faillite de nombreux commerçants. Vogel doit se retirer en 1876 (allié à Stout, il reviendra au
pouvoir sans grande réussite entre 1884 et 1887).
Quoiqu’il en soit, la Nouvelle-Zélande connaît, sous Vogel, un spectaculaire décollage économique.
L’amélioration des communications avec l’extérieur favorise en effet les exportations et donc le développement
sur place de l’élevage et de l’industrie qui lui est liée, alors que dans l’île du Sud la culture du blé connaît un
essor spectaculaire à la suite de l’introduction des premières moissonneuses-lieuses venues des États-Unis. Une
ombre au tableau demeure toutefois : l’essentiel de l’activité économique se fait en liaison avec le Royaume-Uni
(90 % des exportations par exemple), ce qui place le pays dans une inquiétante situation de dépendance.
Le renouveau économique néo-zélandais s’est accompagné d’un fort accroissement de l’emploi industriel, nourri
par une immigration qui a changé de nature. Aux colons agricoles (les colons « Wakefield » et leurs
descendants) succèdent les ouvriers des grandes villes anglaises, dont beaucoup ont déjà été engagés dans la lutte
syndicale. Ces nouveaux colons (les « colons Vogel ») trouvent à s’employer dans les ports des grandes villes ou
dans les cités minières de l’intérieur, dans des conditions souvent précaires (voir doc. 5a et b).
3- Un pays sujet aux crises internationales
La Nouvelle-Zélande, à l’instar des autres puissances industrielles, doit faire face à trois crises d’envergure entre
les années 1880 et les années 1930 : la crise de 1885-1896, celle de 1921 et celle de 1929. Mais ces crises ne font
que ralentir une marche à la prospérité qui semble inexorable.
Pourquoi les crises ?
À intervalles réguliers, selon des rythmes bien connus des économistes, le monde de cette époque est secoué de
crises de surproduction qui entraînent l’effondrement des prix et de graves problèmes sociaux. La Nouvelle-
Zélande ne peut être épargnée par ce type de crise, dès l’instant où son économie, extravertie, repose
essentiellement sur l’exportation des produits de l’élevage.
La crise des années 1880 est liée à la révolution du rail qui a permis l’ouverture de vastes espaces agricoles en
Russie, aux États-Unis ou en Australie. La surproduction agricole et l’effondrement des prix qui suivent plongent
la colonie dans une crise qui se prolonge jusqu’en 1896, en particulier dans l’île du Sud où les problèmes sociaux
prennent vite le relais des problèmes économiques. En 1921, la surproduction agricole et l’effondrement des prix
résultent du retour sur le marché des pays jusqu’alors en guerre. Quant à la crise de 1929, on en connaît la
complexité, mais elle se traduit de la même façon par un phénomène de surproduction et par la chute des prix des
denrées agricoles en particulier.
Comment lutter contre les crises ?
Les différents gouvernements qui ont été confrontés aux crises économiques de cette période ont usé des mêmes
palliatifs, avec une réussite très aléatoire.
La première mesure est toujours protectionniste. On protège la production locale en élevant des barrières
douanières qui interdisent l’entrée dans le pays de denrées à bas prix. Il s’agit là d’une mesure artificielle et très
insuffisante pour un pays qui vit de ses exportations. Il faut donc maintenir les débouchés extérieurs en soutenant
les producteurs néo-zélandais afin qu’ils puissent vendre moins cher à l’étranger. Ainsi, en 1922-1923, sous la
pression des syndicats de fermiers, le gouvernement crée un Meat Board puis un Dairy Board, chargés de
réguler et d’aider le commerce d’exportation. Dans les années trente, des aides sont également accordées aux
produits agricoles par le gouvernement travailliste. Mais ces soutiens ne peuvent être que provisoires. On
imagine alors se retourner vers l’Angleterre pour signer des accords préférentiels, mais lorsqu’en 1926 le Dairy
Board veut imposer ses prix à Londres, les Britanniques répondent par un boycott des produits néo-zélandais qui
oblige la Nouvelle-Zélande à faire machine arrière. Un autre échec est essuyé dans les années trente lorsque le
pays négocie avec l’Australie auprès du Royaume-Uni pour obtenir des quotas à l’exportation et des prix
garantis.
On instaure également des politiques de grands travaux destinées à résorber le chômage mais dont la très faible
rétribution ne permet pas de soulager la misère sociale. On peut souligner cependant quelques initiatives
d’envergure comme dans les années trente la construction de la route du Milford Sound avec le creusement du
tunnel Homer (voir doc. 12a) ou le reboisement en pins de quelques milliers d’hectares.
Le déséquilibre budgétaire provoqué par les crises entraîne aussi la mise en place de politiques déflationnistes
qui se traduisent par des ponctions sociales vite jugées inacceptables, comme la diminution du montant des
pensions ou des salaires des fonctionnaires (de 20 % entre 1931 et 1932, par exemple) ...
En fait, la solution pour surmonter les crises semble être de produire toujours plus (pour compenser le manque à
gagner des prix qui s’effondrent) et de manière encore plus compétitive. Ainsi, dans les années vingt, la sortie de
crise est due en grande partie aux progrès de l’élevage, devenu plus scientifique, qui se traduisent par la
généralisation de la race Jersey (beaucoup plus productive) et par l’introduction des trayeuses à pétrole, puis
électriques. On peut ainsi produire plus et moins cher. Ainsi en est-il de la production de beurre, qui passe de
22 000 tonnes en 1914 à 46 000 tonnes en 1921 et à 76 000 tonnes en 1929.
Quelles sont les conséquences des crises ?
Les conséquences des crises sont multiples mais pas toujours négatives à moyen terme. On peut les lister ainsi :
– le solde migratoire devient négatif. Dans un pays d’immigration comme la Nouvelle-Zélande, il s’agit
d’une bonne soupape de sécurité par rapport au chômage, qu’elle freine.
– les entreprises les moins rentables disparaissent et l’on redémarre sur des bases plus solides.
– le chômage qui s’installe malgré un solde migratoire négatif crée des conditions de vie précaires,
entraînant des mouvements sociaux de contestation.
– les gouvernements en place sautent pour ne pas avoir été assez réactifs. Les Conservateurs font place
aux Libéraux dans les années 1890, les Libéraux font place aux Travaillistes en 1935…
– (plus inattendu) de grandes réformes sociales se mettent en place dès le retour à la prospérité (années
1890 ; 1935-1940).
Quoiqu’il en soit, on constate que la Nouvelle-Zélande s’est toujours sortie à son avantage de ces situations de
crises, qui n’ont fait que ralentir un temps une forte croissance économique générale.
4- Une forte croissance économique générale
Une croissance économique soutenue
Amorcée sous Vogel, la croissance économique générale de la Nouvelle-Zélande n’a été que ralentie par les
crises. Le pays se transforme très vite et prend sa place dans le concert des nations industrielles, rattrapant vite le
retard initial.
Après la première phase d’équipement initiée par Vogel, l’expansion industrielle se poursuit, y compris durant la
crise des années 1880, grâce à l’utilisation des nouvelles technologies de l’époque. La révolution de la
congélation (voir doc. 1) permet de conserver la viande dans des chambres froides avant qu’elle ne soit expédiée
vers l’Angleterre par de navires frigorifiques (à partir de 1882). La première usine de lait voit également le jour
en 1882, à Edendale (Southland). Les premières machines à tondre arrivent elles aussi dans les années 1880.
Mais ces innovations techniques ont leur revers, puisqu’elles permettent des économies de main-d’oeuvre et, de
fait, provoquent du chômage. D’autres secteurs économiques se maintiennent, comme l’exploitation forestière et
le travail du bois ou l’extraction de la gomme de kauri.
La reprise économique mondiale qui touche le pays à partir de 1896 se traduit par une expansion industrielle
sans précédent dans des secteurs aussi variés que le textile, la photographie, le travail des métaux, l’imprimerie,
les métiers du bois ou l’appareillage électrique... Dans le domaine de l’élevage, des résultats probants sont aussi
enregistrés. La production de lait quintuple entre 1896 et 1914 et celle du fromage est multipliée par dix. Les
exportations de viande par navire frigorifique continuent à progresser. À côté des grandes propriétés qui se
développent surtout dans l’île du Sud, on rencontre, surtout dans l’île du Nord, de plus en plus d’exploitations
familiales moyennes, souvent bien équipées et très compétitives. Il s’agit là du fruit des efforts des Libéraux en
faveur d’une meilleure répartition des terres. Cette économie florissante facilite la mise en œuvre des grandes
réformes sociales de la fin du XIXème siècle.
La Première Guerre mondiale elle-même n’entrave pas vraiment cet essor économique. Si la main d’œuvre fait
parfois défaut du fait des nombreux départs au front, les besoins de l’Angleterre en denrées alimentaires sont
énormes et la Nouvelle-Zélande y pourvoit en partie (laine, viande, produits laitiers). Après le conflit, cet
échange privilégié se prolonge et assure la prospérité du pays, l’Angleterre absorbant jusqu’à 95 % des
exportations néo-zélandaises. Si les années trente sont plus difficiles, elles n’empêchent pas le gouvernement
Savage de mettre en place un train de réformes sociales sans précédent. Le coût de ces mesures va être absorbé
par la Seconde Guerre mondiale, qui vient sauver l’économie et les finances de la Nouvelle-Zélande, une
nouvelle fois épargnée sur son sol.
L’aventure des communications
La Nouvelle-Zélande n’a pris aucun retard pour se lancer dans l’aventure des communications. Son espace vaste
pour si peu d’habitants tellement dispersés, ainsi que son isolement au fin fond du Pacifique lui commandaient
d’être active sur cette affaire.
À l’intérieur, le pays se lance sans tarder dans l’aventure des chemins de fer. Une première ligne est construite
entre Christchurch et Lyttelton. En 1880, Bluff est reliée à Christchurch, Wellington à Wanganui et à Masterton
et Auckland à Hamilton. Vers 1890, on a poussé jusqu’à New Plymouth et Napier. La grande affaire demeure
toutefois le Main Trunk Line, la ligne Auckland – Wellington (voir doc. 3a), achevée en 1908, qui permet de
relier les deux villes en moins de 24 heures. Par ailleurs, alors que l’on mettait 15 jours en 1860 pour aller de
Dunedin à Auckland, on n’en met plus que 6 en 1880 et 3 en 1898. Le réseau routier quant à lui se développe
dans les années vingt. On recense alors 150 000 voitures, 30 000 camions et 36 000 motos... ce qui impose un
effort redoublé dans l’aménagement du réseau routier.
Dans ce pays isolé, les communications avec l’extérieur revêtent un caractère primordial. Après avoir lancé un
câble télégraphique reliant l’île du Nord à l’île du Sud dès 1866, la Nouvelle-Zélande se relie à l’Australie dès
1876. Dans le domaine maritime, un premier service régulier de steamers reliant Auckland à San Francisco est
inauguré par Vogel dans les années 1860. Les liaisons transocéaniques, cependant, demeurent longues et il faut
alors compter 70 jours pour rallier la Nouvelle-Zélande à l’Angleterre via la route de l’ouest et le canal de Suez
par la voile, et encore une soixantaine de jours par la vapeur. Toutefois, à partir de 1880, une route plus rapide
est trouvée en prenant la route de l’est et en traversant les Etats-Unis par la voie ferrée. La durée du voyage est
alors ramenée à une quarantaine de jours. Les progrès de l’aviation se matérialisent par le premier vol entre l’île
du Nord et l’île du Sud en 1920, puis par la première liaison Australie – Nouvelle-Zélande en 1928, par
l’Australien Charles Kingsford Smith sur son avion la Croix du Sud.
II- Vie politique et combats sociaux
Le monde politique néo-zélandais n’a jamais été foncièrement réactionnaire. Il faut voir là une des conséquences
du mode de colonisation. Il n’y a pas de tradition aristocratique, pas de privilège de sang à défendre en Nouvelle-
Zélande. Le rêve de construction d’un monde plus juste que le monde très inégalitaire que l’on a fui en quittant
l’Angleterre est encore très présent à la fin du siècle chez les descendants des premiers colons. Ceci peut
expliquer la vigueur de la politique sociale, comme la dureté de la répression de certains mouvements ouvriers
initiés par les nouveaux venus, suspectés de vouloir importer dans le pays les crises de la vieille Europe.
Sur le plan strictement politique, on voit se succéder trois courants politiques : les conservateurs (dont le Reform
Party, plutôt libéraux, les Libéraux, plutôt radicaux, et les Travaillistes, profondément socialistes.
1- Les « Conservateurs », une vision du monde vite dépassée
Les gouvernements conservateurs de la fin du XIXe siècle sont l’émanation d’une oligarchie terrienne qui n’a su
prendre en main les destinées d’un pays dont les rapides changements l’ont dépassée. Dans ce contexte,
l’expérience Vogel est apparue iconoclaste et son échec relatif n’a fait que renforcer la frilosité de ses
successeurs. Ceux-ci (dont le plus en vue est Harry Atkinson) ne peuvent empêcher que ne se creuse le fossé
entre les politiciens et la population. Il faut dire que pour demeurer compétitif, il est demandé de gros sacrifices
aux travailleurs et leur condition tend à se rapprocher de celle que l’on connaît en Europe à cette époque. Un
rapport officiel de 1890 dénonce d’ailleurs l’exploitation des femmes et des enfants dans l’industrie.
En conséquence, l’action syndicale se développe et se durcit. Elle s’organise autour des « immigrants Vogel »,
dont beaucoup étaient déjà syndiqués dans leur pays d’origine. De nombreuses grèves éclatent dans les années
quatre-vingt. Elles atteignent leur paroxysme en 1890, lorsque le très puissant Maritime Council d’Andrew
Millar (voir doc. 8a), qui réunit dockers, gens de mer et mineurs, déclenche un vaste mouvement de grève qui
dure deux mois et déstabilise le pays avant finalement d’échouer.
C’est dans ce contexte extrêmement troublé que se termine cette expérience conservatrice. Les élections de 1890
marquent en cela la naissance d’une ère nouvelle qui voit la Nouvelle-Zélande changer de cap et s’engager dans
une politique sociale unique au monde, sous la houlette de gouvernements libéraux ambitieux et audacieux qui
bénéficient, il est vrai, de la reprise économique générale.
2- 1891-1906 : des hommes nouveaux avec de nouvelles idées. Les Libéraux au pouvoir.
Stabilisation sociale et grandes réformes
À partir de 1890, la Nouvelle-Zélande change de visage. Elle le doit à quelques hommes remarquables qui se
trouvent à la tête du pays au moment de la reprise économique générale et qui savent en profiter pour provoquer
des avancées sociales majeures. Ces hommes sont deux premiers ministres qui se succèdent à la tête du pays
entre 1891 et 1906 : John Ballance (1891-93) et Richard John Seddon –King Dick- (1893-1906) assistés de
quelques ministres très entreprenants comme William Pember Reeves ou John Mc Kenzie.
Le gouvernement libéral de Ballance est porté au pouvoir par une entente entre syndicats ouvriers et fermiers
mécontents dite « Lib-Lab » (Libéral / Labour). Fortement influencé par les lectures de John Stuart Mill ou de
Ricardo, Ballance donne la première impulsion à ce que l’on pourrait appeler la démocratie sociale. En fait, il ne
veut pas la destruction du capitalisme, mais son contrôle par l’État, de façon à ce que les bénéfices soient plus
équitablement redistribués. Certains historiens néo-zélandais ont pu rapprocher ce capitalisme d’État aux
théories économiques du fascisme contemporain, à la différence majeure toutefois que le fonctionnement
démocratique des institutions a toujours été préservé. Cette forme de développement économique a toujours
reposé sur le consentement de la majorité issue des élections. Ballance peut s’appuyer sur son ministre du travail,
John Pember Reeves (un « radical collectiviste »), sur John Mc Kenzie ou sur Richard Seddon. Personnage hors
pair, il meurt prématurément et sa succession est assurée par Seddon (voir doc. 4a), qui poursuit son œuvre en
lui donnant les nouvelles perspectives que lui permettent sa longévité à la tête du pays (il est Premier ministre
jusqu’à sa mort en 1906).
Les années 1893-1906 auront été marquées par la forte personnalité de « King Dick », ainsi que l’on surnomme
Seddon. Ce dernier facilite la partition des grandes exploitations, encourage le développement d’une agriculture
moderne, nationalise les mines, les chemins de fer, les compagnies maritimes, les postes et la plus grosse
compagnie d’assurances et surtout fait voter des lois sociales (système de conciliation, lois sur l’industrie ou les
fonds de pension, voir plus loin) qui élèvent le pays au rang de modèle pour le monde entier.
Il doit toutefois affronter, dans les dernières années de sa gestion des affaires, une nouvelle montée de l’agitation
sociale, alors qu’une opposition politique de plus en plus active venant parfois de ses propres rangs. Ainsi, au
sein de son mouvement, il voit naître deux courants : un courant conservateur, le Reform Party et un courant
socialisant. Ce dernier, initié dès 1904 par les syndicats, présente ses propres candidats aux élections de 1905 et
1908 (il devient le parti Travailliste en 1910).
Lorsque Seddon disparaît en 1906, il laisse à son successeur, J.G. Ward, un héritage finalement difficile.
3- 1906 – 1935 : entre instabilité et fermeté
Deux groupes de pression qui s’affrontent
Dans les villes l’action syndicale se durcit autour de la Federation of Labour (on parlera des « Red Feds ») aux
mots d’ordre marxistes. Contrairement au parti travailliste, plutôt modéré, les syndicats « Red Feds » veulent se
battre sur le terrain, non à la Chambre et ils font clairement savoir que leur arme est la grève et non le bulletin de
vote. Une de leurs cibles est le système de conciliation mis en place par les Libéraux en 1894 afin de favoriser le
règlement à l’amiable des conflits du travail (voir plus loin et doc. 6). Ils estiment que ce système fonctionne en
faveur du capitalisme et multiplient les grèves dans les chantiers, les ports, les mines, les usines à partir de 1908.
À l’opposé, se développent dans les campagnes, des syndicats de fermiers et d’agriculteurs virulents que l’on
appelle les « Cow Cockies ». Le monde rural estime être la colonne vertébrale de l’économie néo-zélandaise et
milite contre le protectionnisme développé par le gouvernement, qui sert l’industrie mais dont souffre
l’agriculture. Il se montre également inquiet de l’action grandissante des « Reds Feds » et souhaite un
gouvernement fort issu du Reform Party. Un homme se dégage de ces mouvements : un fermier de la région
d’Auckland, William Massey (voir.
Les hommes politiques de l’époque doivent composer avec ces deux groupes de pression antagonistes pour
asseoir leur majorité à la Chambre.
Le retour des conservateurs. La méthode Massey : pause sociale et maintien de l’ordre.
Suite à six années difficiles émaillées de nombreux troubles sociaux qu’ils n’ont su juguler, les Libéraux font
place en 1912 aux Conservateurs du Reform Party emmenés par William Ferguson Massey.
William Massey (voir doc. 4b) devient premier ministre en 1912, grâce au soutien des Cow Cockies et de la
bourgeoisie qui attendent de lui une attitude ferme vis-à-vis des Red Feds. De fait, il combat vigoureusement les
grèves comme à Waihi (1912, voir doc. 9a), à Auckland (voir doc. 9b) ou à Wellington (1913) n’hésitant pas à
faire donner la police montée (voir doc. 9d) renforcée par des volontaires venus des campagnes avec leur cheval
(les « Cosaques de Massey », voir doc. 9e) et appuyée par l’armée et des ouvriers non-grévistes. Par ailleurs, on
fait appel aux syndicats de fermiers pour remplacer les grévistes dans les entreprises ou sur les quais.
Les « Red Feds » sont battus, réduits au silence. Ils tirent la leçon de ces événements. Le monde ouvrier néo-
zélandais n’a pas le poids suffisant, les syndicats sont trop inexpérimentés, l’opinion publique est trop peu
sensibilisée et le gouvernement est trop déterminé pour que les actions violentes puissent aboutir. Dès lors, leurs
leaders choisissent d’entrer en politique. Ils réussissent à se faire élire au Parlement et rejoignent le parti
travailliste dont ils deviennent rapidement des éléments de premier plan. Ils ont pour nom Harry Holland, Bob
Semple, Peter Fraser ou Micky Savage (voir doc. 4c)…
Parallèlement à la reprise en main du monde industriel, Massey engage une série de mesures en faveur du monde
rural en améliorant les conditions de crédit pour les agriculteurs et en transformant les baux à 999 ans accordés
par le gouvernement Seddon en propriété privée, une revendication à laquelle les « Cow Cockies » tenaient
beaucoup. Il faut dire que ce sont les campagnes qui assurent encore 90 % des exportations du pays (laine,
viande congelée, beurre et fromage, voire pommes et céréales, arrivent loin devant le bois, l’or et le charbon,
autres produits à l’exportation).
Lorsque survient la guerre, les méthodes musclées de Massey ont porté leur fruit et le calme social est à peu près
revenu. Sur le plan politique par contre, la partie est loin d’être gagnée et aux élections de 1914 les
Conservateurs l’emportent de justesse face aux Libéraux et aux Travaillistes. Le contexte particulier amène
Ward et Massey à former un gouvernement de coalition qui réunit Conservateurs et Libéraux, alors que les
Travaillistes demeurent seuls dans l’opposition.
Les problèmes de l’immédiat après-guerre : le retour à l’instabilité
Soutenir l’effort de guerre a demandé beaucoup de sacrifices aux Néo-Zélandais (réquisitions, contrôle des prix
et des salaires, interventionnisme redoublé du gouvernement), même si sur le plan économique le pays a tiré des
bénéfices substantiels du conflit. En fait, Ward quitte le gouvernement de coalition dès 1919 et mène avec les
Libéraux une campagne active contre Massey et le Reform Party. De son côté, le parti Travailliste prend de
l’envergure et, débarrassé des vieux démons des « Red Feds », présente une alternative plus rassurante à gauche
en développant une idéologie d’État-providence et en rejetant officiellement le collectivisme.
Le Reform Party n’est pourtant renversé qu’aux élections de 1928 par une coalition regroupant les Libéraux et
les Travaillistes, coalition qui ne résiste pas à la Grande Dépression. Ward démissionne en 1930 et meurt peu
après. George W. Forbes, son successeur, entreprend un rapprochement avec les Conservateurs et crée avec eux
le parti National, rejetant les Travaillistes dans l’opposition.
Mais le parti National ne sait pas répondre à la crise qui s’installe dans le pays. En trois ans, les prix
s’effondrent, la valeur des exportations chute de 40 %, le niveau de vie de 20 % et le nombre de chômeurs
s’accroît dans des proportions inquiétantes. L’extrême dépendance de la Nouvelle-Zélande par rapport à l’Angleterre et le manque de diversification de ses exportations portent un coup fatal à l’économie, touchée sur
ses produits de base.
Des émeutes éclatent bientôt à Auckland, à Wellington ou à Dunedin, alors que par ailleurs se constituent des
milices fascistes. Afin de faire face à cette agitation, des mesures de coercition sont prises, autorisées par le
Public Safety Conservation Act qui donne au gouvernement des pouvoirs exceptionnels dans le cadre du
maintien de l’ordre. En fait, à partir de 1934, l’agitation sociale diminue d’elle-même : les Néo-Zélandais
attendent les élections.
Le gouvernement Forbes a cristallisé les oppositions et il n’est pas surprenant de voir qu’aux élections
législatives de 1935 ce sont les Travaillistes emmenés par Michael Savage qui l’emportent avec une confortable
majorité. Les Travaillistes vont garder les rênes du pouvoir jusqu’en 1949.
4- 1935 – 1940 : les Travaillistes au pouvoir. La deuxième grande vague de réformes sociales.
Lorsque les Travaillistes arrivent au pouvoir, la situation économique et sociale est en voie d’amélioration. Le
nombre des chômeurs, par exemple, est redescendu à 50 000. Le nouveau gouvernement est bien décidé à
profiter de la reprise économique permise par le contexte mondial plus favorable pour s’engager dans de grandes
mesures sociales.
Le nouveau gouvernement, emmené par « Micky » Savage, est composé de socialistes convaincus. Sept
ministres sont d’anciens « Red Feds » dont certains ont connu la prison et dont les plus en vue sont W. Nash aux
finances, Peter Fraser (qui succède à Savage comme Premier ministre en 1940) à la santé et à l’éducation et Bob
Semple aux travaux publics.
Le but poursuivi est d’assurer à tous les citoyens la sécurité économique, sociale et familiale en faisant financer
par l’État (l’impôt) tous les services sociaux. Pour atteindre cet objectif, qui reprend celui poursuivi par les
Libéraux du temps de Seddon, Savage pense lui aussi qu’il faut s’appuyer sur un État interventionniste qui
contrôle les grands axes de l’économie et injecte de l’argent de manière à relancer le pouvoir d’achat des
ménages, sans pour autant que le capitalisme soit remis en cause.
La politique keynésienne suivie par les Travaillistes n’a été rendue possible que par le prélèvement sur les fonds
de réserve constitués quelques années auparavant. Le gouvernement Savage a beaucoup plus donné qu’ils n’a
produit et ce réamorçage de la pompe a coûté très cher au pays qui s’est endetté auprès du Royaume-Uni. À ce
titre, la guerre vient à point nommé pour sauver le gouvernement, qui a été reconduit en 1938, d’une situation
financière qui s’annonçait difficile.
Micky Savage meurt regretté de beaucoup le 27 mars 1940.
III- Vers une société modèle ?
La société néo-zélandaise se transforme rapidement à la fin du siècle. La vieille souche anglo-saxonne, tout en
conservant son esprit pionnier, copie au mieux le modèle britannique, avec ses clubs, ses associations, son mode
de vie qu’elle tente de reconstituer à l’identique. Les nouveaux arrivants quant à eux bousculent ce
conservatisme et contribuent à faire bouger les choses. La Nouvelle-Zélande peut se livrer à des réformes
sociales hardies qui vont étonner le monde entier.
1- État de la société dans les années 1870 - 1880
Une reprise démographique surtout due à l’immigration
La bonne santé de l’économie néo-zélandaise, bien soutenue par la politique vogelienne de grands travaux et de
création d’emplois, favorise le redémarrage démographique, y compris dans les rangs des populations maories,
qui se remettent à croître (faiblement) à partir de 1896. L’essentiel du fort accroissement de population que l’on
constate entre 1874 et 1906 (de 290 000 à 880 000 habitants) est cependant dû à l’immigration. Celle-ci, d’abord
encouragée par Vogel, s’amplifie d’elle-même à la fin du XIXème siècle. Elle a permis d’accélérer la mise en
valeur du pays et en particulier de progresser dans le Grand Bush (moitié sud de l’île du Nord.
On note toutefois que ces nouveaux immigrants n’ont plus le profil des « colons Wakefield » des années 1840.
Ceux-ci fuient la misère des bas quartiers des villes anglaises, allemandes ou scandinaves. Plus urbains que
ruraux, ils contribuent moins à la colonisation agricole. Par contre, ils viennent gonfler la population des grands
villes et des cités minières et représentent une minorité de plus en plus agissante et de moins en moins
contrôlable par la bourgeoisie en place.
De fait, le paysage social de la Nouvelle-Zélande change à la fin du XIXème siècle. L’esprit pionnier des
premiers temps s’effrite peu à peu avec la construction d’une nouvelle société qui n’échappe pas aux clivages
sociaux.
Une nouvelle société se met en place
La société néo-zélandaise des années 1870 - 1880 apparaît d’abord comme l’héritière de la colonisation terrienne
anglo-saxonne des années 1850. Elle croit encore en un monde plus juste fondé sur certaines valeurs que l’on
peut qualifier de « bourgeoises », fondées sur le travail et la famille. Elle est sûrement convaincue de « la
supériorité de l’homme blanc » chère à Kipling et ne se pose pas la question de sa présence sur un territoire
occupé par un autre peuple dont elle a spolié les terres. Volontiers nationaliste, voire raciste, elle hésite à couper
le cordon ombilical qui la relie à l’Angleterre, même si elle y est poussée par les jeunes générations nées dans le
pays, qui représentent 52 % de la population non maorie en 1886. Quant aux Églises qui en assurent
l’encadrement, elles ont fait l’expérience de la tolérance réciproque et font davantage porter leurs efforts sur la
charité publique ou la lutte contre certains fléaux sociaux comme l’alcoolisme que sur le prosélytisme.
Les colons néo-zélandais ont très tôt essayé de reconstituer le modèle anglais dans les éléments de leur vie
quotidienne. On mesure bien ce réflexe en étudiant les sports et les loisirs pratiqués à cette époque. En-dehors
des traditionnels pique-niques (voir doc. 14a) ou de quelques activités de randonnée, on retrouve les courses de
chevaux, très prisées, les régates, la chasse, le cricket, le tennis, le golf, le polo et bien sûr le rugby. La plupart de
ces sports donnent naissance à des clubs qui se dotent d’installations n’ayant rien à envier à celles de la vieille
Angleterre et ils se structurent très tôt en fédérations nationales.
Les activités intellectuelles demeurent plus modestes, mais un réel effort est porté sur l’éducation. Des lois
votées en 1877 tendent à uniformiser l’enseignement, jusqu’alors géré par les provinces et en 1891 on peut
estimer que 80 % des enfants vont à l’école élémentaire, ce qui est un excellent taux pour l’époque. Les collèges et l’université (les deux premiers sont créés à Dunedin en 1869 et à Christchurch en 1873) demeurent toutefois
l’apanage des classes aisées.
Ce bel édifice est contesté dès les années 1880, du fait de l’entrée dans la crise économique qui rend moins
supportable les inégalités sociales qui se développent dans le pays et qui sont dénoncées par les nouveaux
arrivants, les ouvriers sensibilisés aux idées socialistes.
2- Les réformes de la fin du siècle : une avancée sociale majeure
Cette pression face aux changements jugés nécessaires pour consolider leur implantation chez les petits fermiers
et chez les ouvriers, a poussé les Libéraux qui arrivent au pouvoir en 1890 à s’orienter vers des réformes de fond
en ce qui concerne la propriété foncière, la législation du travail ou la protection sociale. La Nouvelle-Zélande
devient un modèle que l’on vient étudier depuis le monde entier. On peut décliner ces réformes en plusieurs
volets :
– L’accès à la terre : une priorité absolue : en matière foncière, Ballance et Seddon militent pour un meilleur
partage des ressources et sont à l’origine d’un ensemble de lois promulguées en faveur de l’accès à la propriété
privée. Le résultat est probant : durant la période libérale le nombre des propriétaires terriens est passé de 43 000
à 74 000 pour un accroissement de terres en propriété privée de 32 à 40 millions d’acres. La plupart des
nouveaux propriétaires ont bénéficié des reventes à bon prix et par petits lots des terres maories achetées par le
gouvernement. Ces quelques mesures ont un effet très positif pour l’assise dans les campagnes du parti Libéral
qui y double son électorat.
L’accès à la propriété privée
En 1891, Ballance fait adopter le « Land and Income Assessment Act », un impôt sur la terre et les revenus,
trop faible toutefois pour être vraiment dissuasif pour les grands propriétaires dont on souhaiterait qu’ils se
séparent d’une partie de leurs terres. Des lois votées en 1892 et 1894 sont plus dissuasives avec des mesures
d’expropriation concernant les grands domaines non exploités. D’autres mesures sont prises dans la foulée de
façon à permettre l’accession à la propriété des petits fermiers. En 1892, Mc Kenzie fait voter le « Crown
Lands Land Act » qui accorde aux colons des facilités d’accès à la propriété, dont la possibilité d’acquérir des
terres de l’État, sous forme d’un bail à 999 ans, sous réserve d’une location modique et non réévaluable. La
seule obligation est de cultiver effectivement la terre ainsi concédée. À cette cession déguisée des terres
appartenant à l’État, J.G. Ward, le ministre des finances de Seddon, adjoint en 1894 une loi sur les prêts aux
colons qui ramène les taux d’intérêt de 10 à 5 % et encourage l’accès à la propriété
– L’amélioration de la condition ouvrière : l’amélioration de la condition ouvrière est régie par les
« Factrories Act » de 1894 et de 1901. Cet ensemble de lois met en place un service de réglementation du travail
qui s’appuie sur des inspecteurs chargés de contrôler les conditions de travail des ouvriers dans les usines, en
particulier des femmes et des enfants, alors qu’est instaurée par ailleurs la semaine de 48 heures (le « Factory
Act » de 1894).
– Les efforts pour normaliser les relations entre ouvriers et patronat : l’« Industrial Conciliation and
Arbitration Act » (1894) : cette loi est un acte majeur dans le cadre des relations socioprofessionnelles. Elle crée
un système public d’arbitrage des conflits du travail (voir doc. 6). Dans chaque district est ouvert un « bureau de
conciliation » composé de représentants élus des travailleurs et des employeurs. Si l’arbitrage de ces bureaux ne
suffit pas, on peut se retourner vers une Cour d’Arbitrage composée d’un juge de la Cour Suprême et de deux
assesseurs élus par les syndicats et le patronat. Cette structure est destinée à régler par le dialogue les problèmes
en amont et éviter ainsi le durcissement des conflits (par les grèves entre autre). Elle contribue longtemps au
calme social, même si les branches dures des syndicats finissent par dénoncer son paternalisme.
– La solidarité envers les personnes âgées : la création d’un système de retraite pour personnes âgées de plus
de 65 ans en 1898 (« Old Age Pension Act ») et la gratuité de certains soins médicaux dans les hôpitaux pour les
personnes indigentes. Ces pensions ne sont accordées qu’aux plus méritants et sont financées par l’impôt sur les
plus riches. Elles sont considérées comme une récompense et non comme de la charité.
– Le droit de vote accordé aux femmes (18 septembre 1893, voir doc. 11)) : la Nouvelle-Zélande est le premier
pays souverain à avoir accordé le droit de vote aux femmes. Cela n’a pas été sans mal. Pour en arriver là, il a
fallu livrer un combat de longue haleine sur une trentaine d’années. La revendication féministe dans le pays date
des années 1860. Elle prend sa source dans le grand activisme de nombreuses femmes de colons qui ont souvent été amenées à prendre une part active dans l’exploitation familiale dans le contexte difficile d’un pays en
construction. Des hommes politiques aussi divers et influents que Fox, Grey, Hall, Stout, Vogel ou Ballance se
montrent très tôt favorables au vote des femmes, mais la majorité des députés de la Chambre y est hostile, à
l’image de Seddon, pourfendeur avéré du féminisme. L’idée fait son chemin cependant. En 1875, les femmes
accèdent aux élections locales et en 1877 aux comités d’école. Par contre, le projet de loi leur permettant de
prendre part aux élections législatives est rejeté à plusieurs reprises (1878, 1879, 1887…). Hall suggère alors à
Kate Sheppard (voir doc. 8b), la présidente du très actif mouvement de tempérance « Women’s Christian
Temperance Union » d’exercer une pression plus active sur le monde politique. C’est ainsi que les réunions et les
meetings se succèdent et que le mouvement prend de l’ampleur avec le ralliement de nombreuses associations de
femmes. Des campagnes de pétitions sont organisées. Elles recueillent 20 000 signatures en 1892 et 30 000 en
1893. Le projet est encore repoussé par deux fois avant d’être enfin accepté en 1893 par 20 voix contre 18. En
cette même année, Elisabeth Yates devient la première femme de l’empire britannique à être élue mairesse (de
Onehunga). Il faut cependant attendre 1919 pour que les femmes puissent siéger au Parlement. Jusqu’à cette
date, elles peuvent voter aux législatives, mais que pour des hommes…
La Nouvelle-Zélande est ainsi devenue en quelques années l’État le plus avancé du monde en matière sociale.
Mais ce modèle laisse dubitatif. Si l’on parle de « laboratoire d’expérimentation politique et sociale pour les
vieilles puissances » (Asquith) on est aussi perplexe devant ce « socialisme sans doctrine ». Les Néo-zélandais
répondent qu’ils sont passés à l’application sans se perdre dans les théories, ce que leur permettaient leurs
structures de pays neuf et leur faible poids démographique. Il s’agit en fait de réponses concrètes à des
problèmes concrets qui ont pris appui sur les réflexions contemporaines sans pour autant être doctrinaires. Par
ailleurs, les mesures sociales touchent surtout la population européenne pour laquelle elles ont été prises. Les
Maoris se retrouvent en marge, tout comme la population d’origine asiatique, dont on freine l’immigration et à
laquelle on n’accorde pas de pension de vieillesse...
Quoiqu’il en soit, le Welfare State est bel et bien né en Nouvelle-Zélande à la fin du XIXème siècle.
3- Un deuxième grand train de réformes : les mesures du gouvernement Savage
Dès son arrivée au pouvoir, le gouvernement travailliste se lance dans une politique sociale hardie et parfois
révolutionnaire (voir doc. 11) :
– semaine de 40 heures dès 1935 ;
– mise en chantier d’un vaste programme de construction de « maisons de l’État » (voir doc. 12b)
coordonné par le Department of Housing (créé dès 1936), selon le principe que chacun a droit à un logement
individuel.
– lutte contre le chômage par l’augmentation des retraites ou la mise en place de la semaine de 40
heures, qui libèrent des emplois pour les jeunes. Le nombre de chômeurs passe rapidement de 38 000 en 1936 à
8 000 en décembre 1937 ;
– protection sociale renforcée au niveau des pensions pour les nécessiteux ou bien des frais médicaux ou
hospitaliers, qui deviennent quasiment gratuits en 1939. Il faut souligner que la Nouvelle-Zélande est le premier
pays au monde à s’être doté d’une telle protection sociale. De plus, celle-ci sera complétée en 1946 par un
système d’allocations familiales dès le premier enfant, dont bénéficieront 230 000 familles ;
– politique éducative qui augmente le temps de la scolarité (en 1936 est instituée l’école jusqu’à 14 ans)
et instaure la gratuité des études dans l’enseignement secondaire.
Cet ensemble de mesures a pu être mis en oeuvre grâce à la reprise économique et à l’interventionnisme de
l’État, qui se traduit par :
– la mise en place d’une caisse de régulation des prix agricoles, garantissant des prix planchers aux
agriculteurs ;
– le contrôle du commerce extérieur, qui permet l’élévation de barrières douanières et le contrôle des
changes (dès 1938) ;
– la nationalisation de certains secteurs de l’économie comme les liaisons aériennes intérieures,
l’industrie du lin ou la Banque de Nouvelle-Zélande ;
– le contrôle accru des systèmes de crédit ;
– la politique volontariste d’industrialisation, coordonnée dès 1936 par un Bureau de l’Industrie. De fait,
entre 1938 et 1947 la production industrielle s’accroît de près de 50 % et le nombre d’ouvriers finit par dépasser
le nombre d’agriculteurs.
4- Les limites du système : les populations maories : de la menace d’extinction à la
marginalisation
L’histoire de la Nouvelle-Zélande de 1872 à 1972 est une « histoire blanche ». Après l’échec des guerres de
Nouvelle-Zélande, les populations maories ont été dépossédées de leurs terres, marginalisées, comme mises au
ban de la nouvelle société qui se construisait sans elles. Étrangères dans leur propre pays, elles ont failli
disparaître avant de recueillir quelques bribes de la prospérité bâtie par les colons anglo-saxons, puis de
reconquérir pas à pas leur dignité.
Une démographie préoccupante
Au tournant de ce siècle, les Maoris sont menacés d’extinction. Ils ne représentent guère que 7 % de la
population totale de la Nouvelle-Zélande. Leur nombre n’a cessé de décroître pour atteindre 42 000 en 1896
(contre 770 000 Pakehas). À cette époque, l’espérance de vie moyenne de la communauté est de l’ordre de 25
ans, ce qui empêche le développement d’un fort taux de natalité. D’aucuns pensent que la race maorie va
disparaître.
En fait, un redressement intervient au lendemain de la Première Guerre mondiale et le chiffre de population
remonte pour atteindre 56 000 en 1921 et retrouver ainsi le niveau qui était le sien à la veille des « guerres de
Nouvelle-Zélande ».... En 1935, les Maoris sont environ 80 000. Cette évolution positive trouve une première
explication dans les réflexes immunitaires dégagés par des organismes qui prennent l’habitude de lutter contre
les maladies importées par les Européens. Elle s’explique aussi par les campagnes d’information sur l’hygiène et
la santé menées par l’État. Elle se traduit par le sensible relèvement de l’espérance de vie, qui atteint alors 45
ans. Toutefois, les Maoris sont très largement minoritaires dans leur propre pays. Ainsi, en 1926 ils sont 64 000
pour une population totale de 1,5 millions.
Le contexte économique et social : pauvreté et marginalisation
La population maorie est essentiellement rurale (à 95 % en 1914 et encore à 89 % en 1935), mais elle se trouve
privée de son principal moyen d’existence, la terre, qui est passée aux mains des Pakeha en l’espace de quelques
décennies (voir annexe ci-dessous). Elle vit souvent pauvrement, dans des conditions précaires. Les hommes ne
trouvent guère à s’employer que comme ouvriers ou manoeuvres dans les grandes exploitations des Européens.
Certains travaillent comme bûcherons, ou cueilleurs de lin ou encore chercheurs de gomme de kauri, activités
extrêmement pénibles mais assez rémunératrices. Beaucoup de tribus toutefois refusent ce semblant d’intégration
et essaient de conserver leur mode de vie ancestral. Mais les zones-refuges sont rares. Le King Country par
exemple est traversé dès 1908 par la Main Trunk Line, qui ouvre une brèche majeure à la colonisation blanche de
l’intérieur. Si la notion de royaume maori a fait long feu, cela n’empêche pas les tribus de se retrouver lors de
grandes occasions (mariages ou décès) qui leur permettent de manifester leur spécificité face au monde
européen. La mort du roi Tawhiao, en 1894, rassemble ainsi 4 000 personnes durant plus d’un mois de festivités.
Globalement, la communauté maorie n’a recueilli que quelques retombées de la prospérité du pays. Les
politiques de protection sociale, d’éducation, de prêts à taux modérés sont pour les Pakeha, pas pour les Maoris.
Lorsqu’ils le souhaitent, ce qui n’est pas toujours le cas, les Maoris connaissent de grandes difficultés pour se
faire soigner par les médecins Pakeha ou pour accéder aux hôpitaux. Beaucoup vivent dans des camps aux
allures de bidonvilles dans des conditions sanitaires douteuses et connaissent un taux de mortalité infantile très
élevé qui traduit bien leur détresse et leur marginalisation. En 1933, 40 % des Maoris sont au chômage, contre
12 % des Pakeha.
Premières velléités d’intégration ?
L’histoire s’accélère pour les populations maories à partir de 1935. L’intégration progressive dans le monde des
Pakeha permet une amélioration du niveau de vie mais le décalage entre les deux communautés persiste bien au-
delà des années cinquante.
De 80 000 en 1935, la population maorie passe à 115 000 en 1951. L’espérance de vie progresse de 48 ans à 55
ans dans le même intervalle. Les mesures prises par le gouvernement dans le domaine de la prévention (lutte
contre la tuberculose par exemple) ou du développement des infrastructures médicales ont eu leurs effets
positifs. Par contre, la population maorie demeure essentiellement rurale : 89 % en 1935 et encore 81 % en 1951.
Dans le même temps, les conditions matérielles commencent à s’améliorer, de par la volonté des autorités
gouvernementales répondant à un plus fort désir d’intégration des Maoris C’est ainsi qu’en 1936, conscient des
sérieux problèmes posés par l’accroissement démographique et par la précarité de l’« habitat indigène », le
premier gouvernement travailliste lance un ambitieux programme immobilier dans le cadre du Native Housing
Act, qui prévoit la construction de 3 000 maisons et de nombreux immeubles collectifs de 1936 à 1951. Ce type
de programme est régulièrement repris plus tard, au fur et à mesure du développement de l’exode rural maori.
D’autre part, pendant la Seconde Guerre mondiale, la communauté maorie s’est montrée particulièrement loyale,
comme en témoigne l’engagement d’un bataillon maori au sein des forces de l’ANZAC et la participation active
des civils dans l’effort de guerre intérieur. À leur retour, contrairement à ce qui s’était passé lors de la Première
Guerre mondiale, les soldats se voient offrir de bons emplois. Enfin, et c’est significatif d’un changement d’état
d’esprit, on abandonne dans les actes officiels l’utilisation du vocable « indigènes » (« natives ») pour celui de
« Maoris », ce qui peut paraître comme une reconnaissance identitaire.
Hésitations et impuissance du monde politique maori
Vers la fin du XIXème siècle, certaines tribus maories se lancent dans des tentatives de gouvernement autonome,
de manière à lutter plus efficacement pour la défense de leurs droits. Il en est ainsi dans le Waikato, avec le
Kotahitanga, ou Parlement maori (créé en 1892) et dans le King Country avec le « Kauhanganui , ou Grand
Conseil (créé en 1894). Toutefois, le Kauhanganui comme le Kotahitanga ne réussissent pas à freiner la
confiscation des terres et à préserver les droits des Maoris sur leur propre sol. Ceux-ci ont été balayés par la
vague européenne qui les a submergés, alors qu’ils subissaient un fort déclin démographique. Deux alternatives
se présentent alors aux Maoris : la solution de l’assimilation prônée par une certaine jeunesse évoluée (Young
Maori Party) ou bien celle de l’enfermement dans les traditions, message véhiculé par quelques illuminés.
Le Young Maori Party demande à ce que la communauté maorie puisse contrôler les terres qui lui restent. Il ne
remet pas en cause la présence britannique dans l’archipel, ni certains aspects de la civilisation occidentale (dans
le domaine de l’éducation ou de la santé par exemple). Il milite pour l’intégration progressive des Maoris dans la
vie économique et sociale de la Nouvelle-Zélande des Pakeha, tout en luttant pour le maintien de certaines
traditions ancestrales. Mais ce parti n’est que la frange évoluée d’un peuple maori qui demeure profondément
attaché à ses traditions et à son environnement rural. Pour beaucoup, la fierté d’être Maori et la défiance envers
les Pakeha sont trop fortes pour que puisse être envisagée une quelconque assimilation. Dès lors, la voie
demeure ouverte à certains mouvements populistes qui, seuls, peuvent encore bercer d’illusions des populations
souvent résignées.
Ces mouvements de résistance sont ponctuels, inorganisés et vite réprimés par la force armée. Les plus
vigoureux puisent leurs forces dans le syncrétisme religieux. Ils se développent dans le Taranaki, la baie de
Hawke ou les Urewera. Ainsi en est-il des mouvements emmenés par Te Whiti, Rua Kenana ou, plus tard et
surtout, Wiremu Ratana.
Deux mondes qui se rapprochent ?
Au milieu du XXe siècle, on peut estimer que le mouvement vers une certaine forme d’intégration est enclenché
et paraît irréversible. De plus en plus d’enfants maoris fréquentent les écoles où ils apprennent les fondements de
la civilisation occidentale. De plus en plus d’adultes se mêlent aux Pakeha dont ils adoptent le mode de vie.
Cette intégration a ses figures de proue : certains intellectuels et hommes politiques, les soldats maoris qui ont
participé à la défense de certaines valeurs de l’Occident lors des deux guerres mondiales, les grandes figures du
sport, comme l’idole des années vingt, le rugbyman George Nepia, qui montre non seulement que les Maoris
peuvent réussir dans le monde des Pakeha, mais qu’ils peuvent aussi les surpasser. À ce propos, il convient de
souligner qu’en Nouvelle-Zélande plus qu’ailleurs, le sport a été un grand vecteur d’intégration. Il faut dire que
les Maoris, malgré la situation sociale difficile dans laquelle la colonisation les a plongés, n’ont pas eu à subir les
égarements ségrégationnistes que l’on rencontre dans d’autres dominions comme l’Afrique du Sud, voire
l’Australie.
CONCLUSION
La Nouvelle-Zélande a construit sa prospérité malgré les contraintes liées à l’isolement et à son faible poids
démographique. Elle a connu tous les aspects de la révolution industrielle, dans ses composantes politiques, économiques et sociales, tout en sachant les retourner à son avantage pour construire une société finalement
prospère et solidaire, le welfare state néo-zélandais.
Annexe : quelques étapes de la spoliation des terres maories
Cette spoliation a revêtu plusieurs formes. Il y a eu les apparences de la légalité, avec les achats de terres par les
colons, généralement par l’intermédiaire du gouvernement. Il y a eu les lois sur le recensement des terres votées
à partir de 1865 visant à faire basculer la propriété collective (tribale) vers la propriété individuelle, qui ont
obligé les Maoris à déclarer leurs propriétés foncières et à les faire cadastrer, ce qui fut fait dans des conditions
souvent litigieuses entraînant souvent des confiscations de fait. Il y a également eu les confiscations de 1864-
1865, liées aux représailles qui ont suivi le soulèvement maori et qui ont touché aveuglément rebelles et
loyalistes, se révélant un ferment de discorde majeur et durable entre les deux communautés. Les confiscations
ont continué au cours du XXème siècle
++++
II- EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
1- Rappel des textes d’accompagnement des programmes
1.1- Classe de première des séries L / ES
I – L’âge industriel et sa civilisation du milieu du XIXe siècle à 1939
1- Transformations économiques, sociales et idéologiques de l’âge industriel, en Europe et dans les pays neufs.
Le phénomène majeur est la croissance économique. On présente le processus d’industrialisation et les
transformations économiques et sociales qui lui sont liées. Il s’agit de saisir les évolutions et les ruptures
majeures sur près d’un siècle et non d’examiner le détail de la conjoncture. En privilégiant le cas français, on
étudie les courants qui tentent d’analyser la société industrielle pour l’organiser ou lui résister (libéralisme,
socialisme, traditionalisme, syndicalisme). On montrera par ailleurs comment des pays comme l’Australie et
surtout la Nouvelle-Zélande ont développé des expériences sociales originales qui en ont fait de véritables
laboratoires.
1.2- Classe de première de la série S
I – L’âge industriel en Europe et dans les « pays neufs » du milieu du XIXe siècle à 1939
2- La société de l’âge industriel.
Le phénomène majeur est la croissance économique. On présente le processus d’industrialisation et les
transformations scientifiques, techniques, économiques, sociales et idéologiques qui lui sont liées. Dans tous les
cas, il s’agit de saisir les évolutions et les ruptures majeures. On peut présenter, comme illustration de ce
thème, l’expérience néo-zélandaise.
1.3- Classe de première de la série STG
III – Diffusion et mutations du modèle industriel à partir de l’Europe
A – Capitalisme, société industrielle, culture européenne à la conquête du monde (milieu XIXe siècle – milieu
XXe siècle).
B – Modèle industriel et changement social du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle
Sujet d’étude au choix : le mouvement ouvrier.
Le mouvement ouvrier est appréhendé à travers son évolution et la diversité de ses manifestations dans l’espace.
On prend appui sur les expériences australienne et néo-zélandaise. L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont
été de véritables laboratoires économiques et sociaux dans les premières décennies de la révolution
industrielle. On en montre les principaux aspects.
2- Indications de mise en oeuvre
Dans les séries générales, on envisage cette question sous l’angle large de la révolution industrielle et de ses
effets sur les transformations techniques, économiques, sociales, idéologiques… Dans les séries technologiques,
l’accent est porté sur l’étude du monde ouvrier.
Quelle que soit la série, la problématique générale conduit à montrer que dans un pays neuf comme la Nouvelle-
Zélande la révolution industrielle et les mouvements ouvriers qui l’accompagnent prennent une dimension
particulière et se démarquent de ce que l’on connaît dans la « vieille Europe ».
2.1- Dans les séries générales
On s’attache tout d’abord à montrer les caractères généraux spécifiques de la révolution industrielle en Nouvelle-
Zélande. On se penche ensuite sur les spécificités de l’action syndicale avant de déboucher sur les réalisations en
matière d’avancée sociale. Une étude sur la société duale peut également être conduite.
On peut imaginer le plan suivant (parmi d’autres).
Introduction : présentation du contexte :
– un pays neuf, isolé et avant tout rural
– une révolution industrielle relativement tardive
– un monde ouvrier composé d’immigrants récents, imprégnés d’idées marxistes, mais minoritaires dans
le pays et accueillis avec suspicion et réticence par le monde colonial en place.
I- Les manifestations scientifiques et techniques de la révolution industrielle
– la révolution dans les campagnes (évolution du matériel agricole)
– le développement de l’industrie minière
– les progrès dans les communications
– quelques grands chercheurs (Rutherford…)
II- Le monde ouvrier, entre lutte et conciliation
– partir de l’Industrial Conciliation and Arbitration Act. En dégager les implications (dialogue plutôt
qu’affrontement). Dire en quoi on a pu reprocher à ce texte d’être paternaliste.
– montrer que si ces dispositions ont permis un vrai dialogue social, elles n’ont pu empêcher des
mouvements de contestation, parfois violents, toujours réprimés (on montre pourquoi).
III- La société néo-zélandaise en mutation
– De grandes avancées sociales : les deux grandes vagues de réforme (années 1890 et années trente) ;
– Une société duale : entre l’entrée dans le welfare state des populations d’origine européenne et la
marginalisation des populations maories.
Conclusion : un modèle original.
Dates repères :
1893 : le vote des femmes, Kate Sheppard
1894 : l’Industrial Conciliation and Arbitration Act.
1912 : les grèves de Waihi
Notions
Conservateurs, Libéraux, Travaillistes
Système de conciliation
Protection sociale
Problématiques possibles
En quoi la révolution industrielle en Nouvelle-Zélande représente-t-elle un cas spécifique ?
En quoi la révolution industrielle en Nouvelle-Zélande diffère-t-elle des expériences européennes ?
Quels sont les principaux caractères de la révolution industrielle en Nouvelle-Zélande ?
2.2- Dans les séries technologiques
On axe beaucoup plus l’étude sur le monde ouvrier, sans pour autant faire l’économie du contexte spécifique
dans lequel il évolue.
La séquence peut être articulée de la manière suivante :
Introduction : présentation du contexte :
– un pays neuf, isolé et avant tout rural
– une révolution industrielle relativement tardive
– un monde ouvrier composé d’immigrants récents, imprégnés d’idées marxistes, mais minoritaires dans
le pays et accueillis avec suspicion et réticence par le monde colonial en place.
I- Analyse des modalités de la lutte : le système de conciliation et ses limites :
– partir de l’Industrial Conciliation and Arbitration Act. En dégager les implications (dialogue plutôt
qu’affrontement). Dire en quoi on a pu reprocher à ce texte d’être paternaliste.
– montrer que si ces dispositions ont permis un vrai dialogue social, elles n’ont pu empêcher des
mouvements de contestation, parfois violents, toujours réprimés (on montre pourquoi).
II- De grandes avancées sociales
– les grandes réformes de la fin du siècle
– les grandes réformes des années trente.
III- Des limites toutefois : les mouvements ouvriers ne touchent pas les populations maories, très marginalisées.
Conclusion : un modèle néo-zélandais ?
Dates repères :
1893 : le vote des femmes, Kate Sheppard
1894 : l’Industrial Conciliation and Arbitration Act.
1912 : les grèves de Waihi
Notions
Conservateurs, Libéraux, Travaillistes
Système de conciliation
Protection sociale
Problématiques possibles
En quoi la Nouvelle-Zélande représente-t-elle un cas particulier dans l’histoire du mouvement ouvrier ?
Pourquoi peut-on dire que la Nouvelle-Zélande a été un laboratoire économique et social ?
++++
III- Présentation des documents


professeur de physique expérimentale. Rutherford fut l’un des pionniers de la recherche dans le domaine nucléaire. Peu de temps après la découverte de la radioactivité, en 1896, par Henri Becquerel, il identifia les trois composants principaux du rayonnement. Son étude du rayonnement le conduisit à décrire l’atome comme un noyau dense autour duquel gravitent des électrons. En 1919, il réalise la première transformation de l’azote en oxygène. Plus tard, en collaboration avec Frederick Soddy, il propose une explication de la radioactivité toujours en vigueur aujourd’hui. Rutherford a reçu le prix Nobel de chimie en 1908. Il est enterré à l’abbaye de Westminster.
Document 3a et b : la révolution des communications
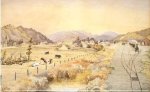
ligne n’est achevée qu’en 1908, soit 45 ans plus tard. Son inauguration est un grand moment. Désormais, on peut relier les deux villes en moins 24 heures

Documents 4a, b et c : trois grandes figures politiques néo-zélandaises de la première moitié du
XXème siècle

la forte personnalité, RJ Seddon, surnommé “King Dick”,
a marqué de son empreinte la vie politique néo-zélandaise
au tournant du siècle. Originaire d’Angleterre, il est
d’abord chercheur d’or en Australie puis dans le Westland
en 1866. Peu cultivé, se montrant parfois borné et
machiste (voir son opposition viscérale au vote des
femmes), mais brillant orateur, il s’impose vite dans la
vie syndicale et politique locale. En tant que premier
ministre, il se montre autoritaire mais toujours proche de
la population. Leader populiste dans son pays, il sait
également s’imposer à l’étranger et contribue grandement
à faire reconnaître la Nouvelle-Zélande sur la scène
internationale.
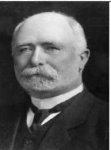
fermier de Mangere (banlieue d’Auckland). Ce
presbytérien d’origine irlandaise est un personnage froid,
rigoriste, obstiné, mais honnête et habile en politique. Il
s’impose à la tête du Reform Party qui remporte les
élections de 1912 et sera premier ministre de 1912 à sa
mort, en 1925. Massey est un terrien qui se méfie
énormément du monde des villes et de l’industrie. Par
ailleurs, il affiche un indéfectible attachement envers
l’empire britannique. Ses méthodes de gouvernement et sa
manière de régler les conflits sociaux ont souvent été sans
nuance, mais lui ont permis de maintenir un certain ordre
dans le pays

né en Australie, qui s’est fait connaître comme un des
leaders des Red Feds dans les mouvements de grève qui
se sont développés avant-guerre sous le gouvernement
Massey. Elu député en 1919 dans les rangs des
Travaillistes, il ne tarde pas à s’imposer en tant que
politicien habile, généreux, idéaliste et …sentimental. Le
nouveau Premier ministre « respire davantage les ventes
de charité que les barricades » dira plus tard à son sujet un
historien néo-zélandais. Les idées défendues par Savage
présentent un mélange de keynésianisme, de socialisme
(celui de Pember Reeves) et d’humanitarisme. Savage
meurt le 27 mars 1940 des suites d’un cancer, alors qu’il
vient d’engager la Nouvelle-Zélande dans la Seconde
Guerre mondiale aux côtés du Royaume-Uni. Cet ardent
pacifiste reçoit alors les honneurs militaires en même
temps que la compassion de tout un peuple.
Documents 5a et b : le monde de la mine
La vie des mineurs en Nouvelle-Zélande est sans doute aussi dure qu’en Europe. Le travail est tout aussi pénible et les
conditions d’existence souvent précaires, la plupart des mines étant situées dans des régions isolées par rapport aux
grands centres urbains et offrant des infrastructures très rudimentaires.

1864. Elle est devenue l’activité principale de la région dans les années 1880, et ceci jusqu’à nos jours. Une première
voie ferrée reliant le bassin minier à Brunner, sur la côte ouest, a été construite en 1876. En 1923, une autre voie ferrée
traverse la chaîne alpine pour mettre le gisement en connexion avec le port de Christchurch, sur la côte est.

centres aurifères de Nouvelle-Zélande et l’extraction de l’or durera jusque dans les années 1950. C’est près de la
Moanataiari Valley que se trouve la ville de Waihi où s’est déroulé en 1912 la grève de mineurs la plus dure qu’ait
jamais connue la Nouvelle-Zélande (voir ci-après).
Document 6 : l’Industrial Conciliation and Arbitration Act
… Son seul intitulé, « loi destiné e à encourager la formation de syndic ats dans l’industrie », est largement éloquent. Si la concilia tion
n’était pas une idée neuve, sa nature obligatoire constitua it une innovation. En Nouvelle-Zé lande comme ailleurs, la grève était
jusque là le meilleur moyen d’action des travailleurs. Mais elle était perçue par le s Libéraux comme un échec auquel il fallait trouver
un remède si l’on voulait éviter que se reproduisent les grands conflits qui empoisonnaient les rapports entre classes. En
conséquence, la loi instaurait la conciliation comme un devoir de l’État de régler un litige entre capital et salariés, à condition que le
salarié soit syndiqué. Un travailleur non syndiqué, présumé satisfait de son sort, ne pouvait intenter une action dans le cadre de cette
loi qui, aprè s la tentative de certains patrons de la court-circuiter en employant des non syndiqués, devint applic able à tous le s
employeurs, assujettis d’office à la règle de la conciliation et de son pendant, l’arbitrage obligatoire. Cela signifiait pour les deux
parties que, lorsqu’un conflit surgissa it, elles devaient en référer à des Conseils de conciliation, au nombre de sept pour le territoire,
divisé en sept secteurs industriels. Elus pour trois ans par les associations d’employeurs et les syndicats, ils avaient pour tâche de
proposer une solution. A ceci s’ajoutait la grande nouveauté que constituait l’arbitrage, également obligatoire, si la conciliation
n’aboutissait pas : un tribunal (un seul pour tout le pays, présidé par un magistrat et composé de trois membres nommés par le
gouvernement, sur recommandation des employeurs et des syndicats) était investi des pleins pouvoirs pour trancher tout litige relatif
aux questions de salaires, horaires, conditions de travail et embauche de mineurs ; toute controverse liée à une préférence donnée à
des non syndiqués était aussi de son ressort.
Au-delà du principe, il importait que ce tribunal, qui remporta un tel succès qu’il dut fonctionner à plein temps, affichât ses options.
Or, il s’avéra que, de manière générale , il se prononçait en fa veur des travailleurs et des syndiqués : les employeurs furent pour leur
part contraints d’obtempérer,c e qui eut pour effet d’accroître le pouvoir des associations ouvrières. Forts de leurs victoire s en
arbitrage, les syndicats pouvaient imposer l’adhésion à tous les ouvriers de l’unité de travail qu’ils contrôlaient ou bie n encore
pratiquer une sélection de leurs membres. Le parti libéral, en imposant cette législation manifestement favorable aux travailleurs,
avait clairement exprimé ses choix : seule la syndicalisation rendait possible la paix sociale et la protection du monde salarial. Les
employeurs, quoique hostiles à la loi, durent s’y habituer, précisément au nom de cette paix sociale qui finale me nt fut favorable à la
croissance économique.
… Cette lé gisla tion fit grand bruit hors des frontières et contribua largement à créer l’image d’un pays qui avait su surmonter les
conflits de classes, un pays sans grèves comme le baptisa le progressiste américain HD Lloyd en 1900.
Document 7 : les conflits sociaux de 1890 à 1945
Peu de grèves dures finalement, dans la mesure où le pays s’est doté très tôt d’un système de conciliation chargé
d’anticiper les mouvements de revendication. Lorsque les syndicats sont passés outre cet arbitrage, la réaction des
autorités, soutenues par la « majorité silencieuse », a généralement été violente.
Août -novembre 1890 Grève des dockers, partie d’Australie et qui a gagné les principaux ports de Nouvelle-Zélande. C’est la
première grève sérieuse que connaît le pays (8 000 grévistes). Si elle se solde par un échec, elle permet
de jeter les bases du syndicalisme dans le pays.
Au total :
– de 1894 à 1911, on compte 42 grèves, dont 20 ont été conduites par des syndicats ayant adhéré au système de
conciliation. Treize d’entre elles ont été réglées en faveur des travailleurs.
– durant la crise de 1929, la moitié des 76 grèves déclenchées se sont conclues à l’avantage des travailleurs.
Documents 8a, b et c : trois types de contestation, une volonté de changement social

Zélande en 1870 et s’engage dans la marine. Devenu capitaine dans la
marine marchande, il est nommé secrétaire du syndicat des gens de mer
en 1887. En 1889, il fonde le Maritime Council qui regroupe le gens de
mer, les dockers, les mineurs et les cheminots. C’est lui qui conduit la
dure grève de 1890 qui se solde par un échec. Il abandonne alors l’action
syndicale sur le terrain et entre en politique. En 1893, il devient député
libéral. En 1906, il rejoint le cabinet Ward avec le portefeuille de
ministre du travail, de la marine, des échanges et des chemins de fer. Il
doit alors s’opposer aux revendications des Red Feds contre le système
d’arbitrage et perd toute crédibilité dans les rangs syndicaux. En 1912,
déçu par son parti qui ne le soutient pas dans ses ambitions politiques (il
visait le poste de Premier), il regagne les rangs du Reform Party de
Massey. Il meurt en octobre 1915.

fille de banquier. Elle rejoint la Nouvelle-Zélande en 1869 où sa famille
s’installe à Christchurch. En 1871, elle se marrie à Walter Allen
Sheppard, un membre de la municipalité de Christchurch. Très tôt, elle
s’investit dans la lutte sociale dans les rangs de congrégations
religieuses. En 1885, elle rejoint la Women’s Christian Temperance
Union, qu’elle dirige deux ans plus tard. Les six années qui suivent la
voient combattre sur tous les fronts pour obtenir aux femmes le droit de
vote. Elle gagne ce dur combat en 1893. Elle poursuit son action
militante jusqu’à sa mort, en 1934, en Nouvelle-Zélande mais aussi en
Europe où elle est invitée par des ligues féministes pour parler de son
expérience.

s’occupe très tôt de l’état de santé de sa tribu et, durant la Première
Guerre mondiale, elle milite contre la conscription pour les Maoris.
Suite aux épidémies qui ont décimé les siens au début du XXème siècle
(dont la grippe espagnole de 1918, qui fit en pourcentage sept fois plus
de victimes maories qu’européennes), Te Puea, qui a recueilli une
centaine d’orphelins, décide de mobiliser son peuple atteint par le
défaitisme autour d’une grande tâche : la construction d’un village
modèle appelé Turangawaewae. Elle y fait élever une grande maison de
réunion, inaugurée solennellement en 1929 devant 6 000 invités,
travaille au maintien de la culture ancestrale en promouvant l’artisanat
traditionnel, mais aussi dote Turangawaewae d’un système d’eau
courante et de tout-à-l’égout, d’une école et d’un hôpital (ouvert en
1943). Te Puea est soutenue dans son action par Gordon Coates, qui lui
rend visite en 1928 alors qu’il est premier ministre et par Apirana Ngata
(voir plus loin). Sa démarche fait tâche d’huile dans beaucoup de tribus
du Waikato qui se prennent davantage en charge.
Documents 9a, b, c , d et e : les grèves de 1912-1913, échec et répression.

système de conciliation et d’arbitrage instauré par le gouvernement Seddon en 1894. Waihi est alors une cité de 6 000 habitants (dont
un millier de mineurs) entièrement vouée à l’extraction de l’or. Dès 1908, les mineurs de Waihi s’affilient à la Federation of Labour
et obtie nnent par la négociation quelques améliorations de leurs conditions de travail. Mais leurs leaders veulent aller plus loin et
décident de se retirer du système d’arbitrage de manière à exercer une pression plus forte sur leurs employeurs en pouvant re courir
directement à la grève. Les violences éclatent lorsque certains mineurs, bientôt soutenus par la direction de la mine puis par le
gouvernement, refusent ce retrait qu’ils jugent hasardeux. La grève est décrétée. Elle va durer cinq mois jusqu’à ce que le
gouvernement Massey utilise la manière forte pour déloger les piquets de grève. Un policier est blessé et un mineur tué par balle. Le
mouvement e st finalement maîtrisé et le travail peut reprendre alors qu’une soixantaine de mineurs grévistes sont arrêtés et de
nombreuses familles déplacées. En fait, les grévistes n’ont pas obtenu le soutien qu’ils escomptaient de la part des autre s syndicats.
Isolés, ils ne pouvaient l’emporter.

à plusie urs autres ports, dont Auckland. Ils sont mieux organisés. Les grèves de 1913 touchent 13 000 salariés et durent 52 jours,
mais ils se heurtent à la farouche détermination du gouvernement, qui bénéficie du soutien de la majorité de la population
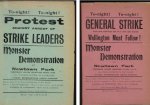
grévistes d’Auc kland. Ces grèves vont être durement réprimées.

même si cette année-là elle a dû être épaulée par les « Cosaques de Massey ».

d’en découdre avec les ouvriers grévistes. Recrutés par Massey pour épauler les forces de l’ordre, leur intervention fut
déterminante dans la réduction des grèves de 1913 Le 8 novembre de cette année-là, ils furent lancés contre les
grévistes dans les ports de Wellington et d’Auckland qu’ils prirent d’assaut.

quatre navires devant des politiciens minuscules (on
reconnaît Massey) qui essaient de le raisonner. Nous
sommes en 1919 et les dockers ont refusé de charger des
sacs de pommes de terre (on voit ceux-ci à la droite de la
caricature) car ils estiment qu’ils auraient dû être écoulés
sur le marché local.
On prête là aux dockers un pouvoir qu’ils n’ont pas
vraiment. Même si les grèves dans les ports ont été assez
nombreuses (pour la Nouvelle-Zélande), elles ont
généralement été réduites par la force.

Documents 12 a et b : deux interventions de l’État

s’agissait d’ouvrir le Milford Sound au tourisme. Le creusement dura 5 ans (de 1935 à 1940) mais la voie ne fut
réellement ouverte à la circulation qu’à partir de 1954. Le tunnel est long de 1 200 mètres.

les Travaillistes ont financé la construction de 30 000 « maisons de l’État » et favorisé par des prêts avantageux la
construction de 19 000 autres maisons individuelles

charrettes tirées par des chevaux. En fait, la ville est déjà le centre économique de la Nouvelle-Zélande et déborde
d’activité.
D’abord choisi par les Maoris pour son site exceptionnel constitué de très nombreux bras de mer qu’ils pouvaient
sillonner en pirogue et de collines sur lesquelles ils ont installé des pa, l’isthme d’Auckland fut ensuite occupé par
quelques colons avant que Hobson ne le choisisse pour fonder la nouvelle capitale de la Nouvelle-Zélande, en 1840, ce
qu’elle demeura jusqu’en 1865. La ville devint assez rapidement un port important et une place économique de premier
ordre pour le pays. Mais son véritable développement date d’après 1945.
| Évolution de la population d’Auckland | |
| 1861 | 10 000 |
| 1881 | 31 500 |
| 1901 | 67 000 |
| 1911 | 102 000 |
| 1934 | 202 000 |
| 1945 | 263 000 |
| Évolution comparée des villes D’Auckland, de Wellington et de Christchurch | |||
| villes | 1886 | 1936 | 1961 |
| AUCKLAND | 33 000 | 226 000 | 450 000 |
| WELLINGTON | 26 000 | 160 000 | 250 000 |
| CHRISTCHURCH | 30 000 | 134 000 | 220 000 |
Document 14a et b : deux aspects de la société néo-zélandaise

prospérité et s’attache à copier les traditions britanniques, beaucoup vivent encore chichement dans de petites masures
de défrichement, dans un grand dénuement.

accueilli les populations maories victimes des confiscations de terres. La communauté de Parihaka s’est enfermée dans
une résistance passive à la colonisation et a tenu à conserver intactes ses traditions. Mais sans réelles ressources, elle a
vécu dans des conditions de vie précaires qui contrastent avec l’aisance de certains colons blancs.
Document 15 a et b : la population maorie vers l’intégration

Maori Party, il a été un ardent défenseur de la culture maorie qu’il a largement contribué à promouvoir.

génération et a démontré que les maoris pouvaient réussir aussi bien sinon mieux que les pakeha (les populations de
souche européenne). Le rugby, pour lequel les maoris ont de réelles dispositions, s’est révélé un excellent vecteur
d’intégration.
Avertissement : toutes les photos reproduites dans ce dossier proviennent de l’Alexander Turnbull Library, de
Wellington.
Documents joints
L’âge industriel en Nouvelle Zélande du milieu du XIXe au milieu du XXe siècle
Cette contribution scientifique peut être utilisée pour les classes de première, séries L, ES, S et STG. Son application pédagogique dépend des orientations données par les textes d'accompagnement de chacun des niveaux concernés.
PDF - 247.9 kio
L’âge industriel en Nouvelle Zélande du milieu du XIXe au milieu du XXe siècle
Le dossier documentaire
PDF - 2.1 Mio
Dans la même rubrique
L’histoire du bagne en Nouvelle-Calédonie
Une contribution scientifique pour mieux connaître cette partie de l'histoire.
La Nouvelle-Calédonie durant la Première Guerre mondiale
Intervention prononcée lors du stage effectué le jeudi 30 avril 2015 au Musée de la Ville de Nouméa
La République française et le fait colonial
Conférence donnée à l'ESPÉ (ex-IUFM) de Nouville le mercredi 11 mars 2015.



