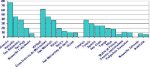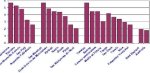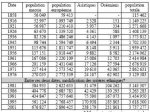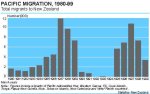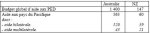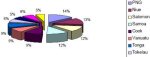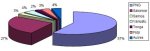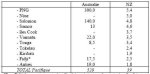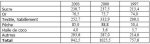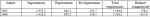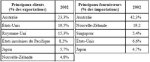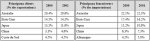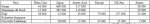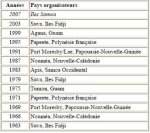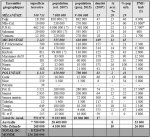Une interface Nord/Sud : l’Océanie
Mis à jour le lundi 17 mars 2025 , par
À l’instar de la Méditerranée, étudiée dans les programmes métropolitains, l’Océanie constitue un espace de clivage en même temps que de contacts entre les pays du
Nord et les pays du Sud. Dans ce cadre géographique, on étudie les écarts de développement, la mobilité des hommes (migrations, déplacements touristiques), les
échanges économiques, financiers et culturels, la variété des statuts politiques. En s’appuyant sur quelques exemples, on montre les effets de ces phénomènes sur les
sociétés et les territoires.
L’étude de l’Océanie permet de mettre en relation un espace îlien tropical en proie à divers problèmes de développement avec un « monde » développé décalé vers la
zone tempérée. Cet ensemble géographique est d’une très grande variété : continent australien et archipel néo-zélandais font face à une multitude d’îles et d’archipels
qui vont des grandes terres mélanésiennes aux poussières d’atolls polynésiens ou micronésiens, de l’espace anglo-saxon à l’espace francophone, des pays indépendants
aux pays plus ou moins autonomes, en passant par des écarts souvent énormes dans le poids démographique ou économique, dans le degré de dépendance économico-
financière ou dans le niveau de vie…
Note importante : l’étude de l’interface océanienne ne saurait se résumer à l’Océanie et donc à l’étude exclusive des relations entre l’Australie / Nouvelle-
Zélande d’une part et les îles et archipels de l’Océanie intertropicale d’autre part. L’Australie et la Nouvelle-Zélande regardent vers d’autres « Sud »,
asiatiques ceux-là. Les micro-États insulaires quant à eux entretiennent des relations parfois privilégiées avec d’autres « Nord » (États-Unis, Japon,
Europe…). Le parti a toutefois été pris ici de privilégier les relations intra-océaniennes, dans la mesure où l’accès à l’information et l’état des recherches sur
cet espace géographique sont assez fragmentaires. Le professeur saura élargir le champ autant que de besoin.
I- MISE AU POINT SCIENTIFIQUE
1- Présentation générale de l’interface océanien
1.1. – Quelques réflexions préalables
Cette question concerne l’Océanie en tant que l’une des cinq (ou six) parties du monde (éviter le vocable « continent ») [1].
Elle introduit les notions de Nord et de Sud, termes économiques et non géographiques, qui posent problème lorsqu’on les applique à l’Océanie puisque, dans
l’hémisphère sud, le nord économique se trouve au sud géographique.
Elle fait également appel à la notion d’interface, qui doit être clairement explicitée, et délimitée géographiquement. Une interface est une discontinuité entre deux
espaces géographiques différents. Son étude conduit à s’interroger sur la nature des relations qu’entretiennent ces deux espaces en matière de flux et d’échanges
humains, matériels et immatériels.
Par ailleurs, étudier l’Océanie en tant qu’interface Nord / Sud amène à s’interroger sur les limites géographiques de ce contact, puis à en étudier la nature. Mais doit-on
réduire l’interface Nord / Sud aux pays océaniens ? La question mérite d’être posée. En effet, les îles et États d’Océanie intertropicale entretiennent des relations avec
d’autres pays du Nord que l’Australie et la Nouvelle-Zélande. De même, l’Australie et la Nouvelle-Zélande entretiennent des relations avec d’autres pays du Sud que
les pays océaniens (en Asie par exemple). Les relations Nord / Sud ne sont donc pas seulement limitées à cette partie du monde et doivent être élargies
géographiquement, sous peine de ne pouvoir en cerner les véritables enjeux. Ainsi, les trois entités françaises du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française,
Wallis-et-Futuna) entretiennent beaucoup plus de relations avec la métropole qu’avec leurs voisins du Pacifique, alors que Guam et la Micronésie regardent vers le
Japon et les États-Unis et non vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande. De même, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont une vision beaucoup plus large de leurs relations
avec le Sud, plus intenses au niveau de l’Asie que du Pacifique proprement dit.
1.2. - L’espace océanien : une identité commune ?
La partie du monde que l’on appelle Océanie juxtapose donc un continent, l’Australie, et un ensemble d’îles et d’archipels qui, en dehors de la Nouvelle-Zélande, sont
tous situés dans la zone intertropicale.
Cet espace tout d’abord est plus maritime que continental. L’océan Pacifique, qui baigne ces terres, est en effet partout présent. Il couvre environ 80 millions de km²
dans lesquels se perdent 820 000 km² de terres émergées (hors Australie), ce qui conduit à introduire l’idée d’isolement et par là-même des contraintes qui lui sont
liées : exiguïté des territoires et faiblesse numérique des populations, difficulté -et cherté- des communications entre les îles, éloignement des grands centres de
décision…
D’autre part, cet espace est situé aux antipodes de l’Europe et s’est donc trouvé longtemps marginalisé (d’où l’idée d’implanter des bagnes en Australie ou en Nouvelle-
Calédonie) par rapport aux grands foyers économiques de la planète. On notera également que, du fait de cette situation géographique excentrée, l’Océanie fut
également la dernière partie du monde à être colonisée par les hommes, puis la dernière à être redécouverte par les Européens, au moins dans sa composante insulaire.
Espace vide et délaissé par les Européens pendant longtemps, l’Océanie est incluse dans un ensemble Pacifique qui s’est éveillé au monde à la fin du XIXème siècle et
aurait même, à en croire les chiffres, supplanté l’Atlantique dans le volume des échanges commerciaux transocéaniques à la fin du XXème siècle. Mais on l’a bien
compris : ce réveil concerne avant tout le Pacifique Nord, quasiment vide en son centre mais bordé par des géants économiques qui multiplient les relations
commerciales entre eux : le Japon, les États-Unis, les « Quatre Tigres », les autres pays de l’ASEAN et maintenant la Chine. Il n’en est pas de même pour la partie sud
de la région, qui nous intéresse plus spécialement. Celle-ci est certes animée par le continent australien et l’archipel néo-zélandais, mais elle est constellée en son centre
de micro-États insulaires constituant un espace délaissé et marginal. Ces derniers ne pèsent d’aucun poids sur l’échiquier économique international. Ils sont le ventre
mou d’un système extrêmement actif sur ses marges. Ils échappent aux grands courants d’échanges et n’en génèrent pas véritablement eux-mêmes. Ils ne sont qu’une
poussière de terres perdues dans l’océan et connaissent tous, y compris les plus riches d’entre eux, des problèmes de développement qu’ils s’attachent à surmonter avec
des fortunes diverses.
Au final, l’Océanie met bien en opposition deux mondes présentant des profils de développement fort contrastés entre lesquels s’est noué un tissu de relations de type
Nord / Sud qu’il convient d’analyser.
1.3. - Le bloc développé (Australie – Nouvelle-Zélande) : deux pays anglo-saxons du bout du monde
Le bloc développé est donc constitué de deux pays, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui présentent bien des caractères communs tout en affichant ostensiblement
leurs différences (voir tableau joint en annexe).
Ces deux pays, qui sont membres de l’OCDE, font partie du cercle fermé des pays riches. Bien des éléments les rapprochent. On pense à leur population majoritaire, de
souche anglo-saxonne, fruit d’une colonisation dite « de peuplement » qui s’est effectuée pour l’essentiel dans la deuxième moitié du XIXème siècle. On pense également
aux problèmes qu’ils rencontrent aujourd’hui par rapport à l’intégration jusqu’ici mal négociée des populations originelles, maories ou aborigènes. On peut également
mettre en exergue leur système de gouvernement, de type démocratique mais conservant un lien au moins affectif avec l’ancien colonisateur par le biais de l’adhésion
au Commonwealth et surtout de la reconnaissance du souverain anglais comme chef de l’État. On signalera encore la volonté de ces deux pays de fédérer leurs
politiques économiques avec l’instauration d’un véritable marché commun autorisant entre eux la libre circulation des biens et des personnes.
Mais les points de ressemblance s’arrêtent vite. En effet, tout par ailleurs semble opposer ces deux pays. Opposition entre une île-continent composée d’un socle d’une
grande stabilité, aux paysages plutôt monotones et un archipel instable aux paysages variés. Opposition entre un climat à dominante désertique et un climat à dominante
océanique. Opposition entre une colonisation pénale rude qui s’est livrée à une tentative d’extermination de populations autochtones démunies et une colonisation de
fermiers qui a dû composer avec des populations autochtones pugnaces. Opposition entre une fédération d’États et de Territoires et un État centralisé. Opposition entre
un pays disposant de gigantesques ressources minières et un pays tourné avant tout vers les ressources liées à l’agriculture. Opposition enfin entre une puissance
économique de rang mondial et une puissance régionale moyenne …
L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont une implication nécessaire et inévitable dans une partie du monde qu’ils considèrent comme leur chasse gardée, tout en s’étant
réparti tacitement leur zone d’influence, plutôt mélanésienne pour l’Australie et plutôt polynésienne pour la Nouvelle-Zélande. Mais ces deux pays n’ont pas forcément
les moyens (Nouvelle-Zélande) ou la volonté (Australie) de leurs ambitions. Au-delà du grand écart de développement qui les sépare de la plupart des pays insulaires de
l’Océanie intertropicale, ils se démarquent de par cet héritage de l’histoire qui en a fait des pays anglo-saxons qui doivent faire face à des Océaniens qui vivent et
pensent différemment, ce qui ne fait qu’accroître la fracture Nord / Sud, qui n’est pas seulement économique, mais aussi et peut-être surtout socioculturelle.
1.4. - Les îles et archipels de l’Océanie intertropicale : un ensemble insulaire multiforme en proie à de sérieux problèmes de développement
Les îles et archipels de l’Océanie intertropicale ont entre eux un des points communs qui leur permettent d’afficher leur « océanité » et de se démarquer du monde
extérieur. Ils ne présentent pas pour autant un ensemble homogène et les clivages qui les séparent sont nombreux. On peut s’essayer à dresser la liste de leurs principales
caractéristiques :
- une très forte insularité. Celle-ci se traduit par une très faible superficie de terres émergées (en-dehors du "géant" de PNG [2]) perdues dans l’immensité
océanique. Il en découle l’éloignement des centres de décision, les contraintes liées à la dispersion des îles ou la difficulté et la cherté des communications… Cette insularité est plus forte au niveau des îles volcaniques et des atolls du centre et de l’est, véritables poussières d’îles perdues dans le grand océan, qu’à l’ouest où l’on
rencontre les grandes terres mélanésiennes, morceaux de socles détachés du continent asiatique.
- un climat tropical humide, moins clément qu’il n’y paraît, avec de longues périodes de sécheresse qui frappent beaucoup d’atolls, des trombes d’eau qui
s’abattent sur les côtes au vent des îles hautes et enfin des cyclones qui sillonnent régulièrement la région, surtout dans sa partie centrale et occidentale.
- une division en trois ensembles ethnoculturels : la Mélanésie (les "îles noires"), la Micronésie (les "petites îles") et la Polynésie (les "îles nombreuses"). Ces
trois mondes issus d’une même souche austronésienne ont encore conservé des pratiques coutumières très fortes qui ont pour effet de privilégier le groupe sur l’individu.
Les conséquences en sont souvent fâcheuses, dans la mesure où le poids de la tradition vient bloquer les initiatives pouvant conduire à des processus de développement.
Le frein social demeure donc considérable, mais inégal toutefois suivant les pays.
- des pays découverts et colonisés tardivement. L’espace océanien a représenté au XIXème° siècle, dans la foulée des aventures africaines ou asiatiques un enjeu
de pouvoirs pour les puissances européennes et pour les États-Unis. La colonisation s’est toutefois effectuée ici avec moins d’enthousiasme (trop loin, trop exigu), plus
tardivement et moins durement. Il n’en demeure pas moins que l’héritage colonial est encore très présent. On en prendra pour preuve la division de la zone en un
ensemble anglo-saxon et un ensemble français fort différents et parfois opposés, sur un fond culturel primitif pourtant identique (Tahiti et les îles Cook ; Wallis et
Futuna et les Samoa-Tonga, Nouvelle-Calédonie et les Salomon ou le Vanuatu...). On doit également insister sur l’héritage religieux qui se traduit par l’omniprésence
d’un christianisme à la fois œcuménique (toutes ses tendances y sont représentées et cohabitent sans problème) et syncrétique (absorption de certaines croyances
ancestrales avec lesquelles il faut bien composer). Tout comme la coutume, la religion peut être un facteur bloquant pour le développement, mais d’un autre côté elle
assure la stabilité des sociétés en place qui ne rechignent pas à être encadrées par le prêtre ou le pasteur.
- des pays qui vivent une véritable crise identitaire au travers des problèmes de décolonisation et d’indépendance. Entre 1962 (Samoa Occidental, actuel
Samoa) et 1980 (Nouvelles-Hébrides, actuel Vanuatu), neuf États océaniens ont accédé à l’indépendance. Dans les années 1990, ils ont été rejoints par plusieurs pays
sous tutelle étasunienne, comme Palau. Parmi les autres, on rencontre tous les types de statuts, allant de l’indépendance-association (îles Cook…) à diverses situations
de dépendance (Samoa américaines, Guam, Tokelau, Pitcairn…) en passant par une très large autonomie (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française…). Mais le
problème non résolu est d’arriver à allier indépendance économique et indépendance politique…
- des pays qui connaissent des problèmes de développement.. En effet, les îles et archipels de l’Océanie intertropicale présentent tous, à diverses échelles et y
compris les plus riches d’entre eux (mais leur richesse est souvent artificielle), certains des caractères propres aux pays du Tiers Monde : démographie non toujours
maîtrisée, structures sociales traditionnelles encore fortes, fondées sur l’enseignement des Églises et sur le respect des chefs et des Anciens, mais déstabilisées suite à
l’introduction brutale de certaines formes de développement, sous-qualification de la main d’œuvre, secteur tertiaire non productif prédominant (bureaucratie), activités
peu diversifiées, insuffisantes et vulnérables, forte dépendance politique et économique, assistanat qui se traduit par l’appel à toutes formes d’aides extérieures, quel que
soit par ailleurs le niveau de développement, extrêmement variable d’un pays à un autre.
- des pays fragiles sur le plan politique. Le fonctionnement démocratique des institutions est souvent mis en danger par les problèmes d’insécurité (PNG,
Salomon), les problèmes ethniques (Fidji), le poids des traditions qui maintient l’emprise des chefferies (en particulier sur Tonga et Samoa), le rôle parfois bloquant des
Églises, l’immaturité enfin de la classe politique et sa faible assise qui favorisent l’émergence de leaders plus ou moins charismatiques qui peuvent succomber à la
tentation du pouvoir personnel (Vanuatu entre autres). Ces problèmes touchent en priorité les pays indépendants dégagés d’une métropole garante et protectrice de la
légalité institutionnelle. Cela ne veut pas dire pour autant que les autres entités, dans le cadre de leur autonomie de plus en plus affirmée, ne soient à l’abri de pratiques
déviantes (îles Cook, entités françaises du Pacifique).
- un ensemble régional enfin qui est tiraillé entre sa volonté de regroupement et les influences extérieures qui contribuent à son éclatement. Par le regroupement
au sein d’organismes comme la Communauté du Pacifique ou le Forum (voir dossier), les pays de la région cultivent l’appartenance à une même communauté d’intérêts
et espèrent être plus forts vis-à-vis de l’extérieur. Il n’en demeure pas moins qu’ils se trouvent écartelés entre de multiples influences externes, ce qui a amené B.
Antheaume et J. Bonemaison [3] à découper la région en quatre réseaux fonctionnant de façon autonome et ayant chacun pour caractéristique d’entretenir des liens
privilégiés avec une puissance du Nor. Ces réseaux sont considérés selon les auteurs comme des "ensembles géographico-politico-culturels" qui "contribuent à forger
l’identité des populations qui les composent". Il s’agit des réseaux :- australo-mélanésien
- zélando-polynésien
- franco-océanien (sic)
- américano-micronésien".
2- Comment fonctionne l’interface Nord / Sud océanien ?
La nature de l’interface Nord / Sud en Océanie est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît, du fait des héritages de l’histoire coloniale qui font que la simple relation de
proximité géographique est largement dépassée par l’entretien et le développement de liens beaucoup plus larges dans lesquels les anciens colonisateurs que sont le
Royaume-Uni, les États-Unis ou la France pèsent de tout leur poids. L’ouverture par ailleurs des marchés asiatiques proches ne doit pas être sous-estimée non plus, en
particulier en ce qui concerne l’espace micronésien.
Les relations qui se tissent dans l’interface océanien sont de divers ordres : démographique (les migrations de population), économique et financier (aides et transferts,
échanges commerciaux, tourisme), politique ou socioculturel. On y retrouve des flux migratoires déséquilibrés, un système d’échanges inégaux, des pratiques d’aides et
de transferts largement développées mais aliénantes, un fonctionnement de type centre-périphérie à plusieurs niveaux d’échelle, une opposition entre des pôles actifs et
des périphéries délaissées…
2.1. - Les flux migratoires
Entre l’Australie / Nouvelle-Zélande et les archipels de l’Océanie intertropicale, on relève des mouvements de populations importants typiques du système de relations
Nord / Sud.
Ces flux revêtent aujourd’hui une importance majeure. Ils se font dans les deux sens, mais les échanges sont inégaux : plus d’Océaniens insulaires quittent la région que
d’étrangers n’y entrent. Ces derniers sont le plus souvent des fonctionnaires ou des assistants techniques, au séjour temporaire, entretenant entre eux sur la région un
flux d’échanges équilibré. Par contre, on note une forte émigration des insulaires océaniens vers les pôles périphériques. Ce sont les Samoans, Tongiens, Rarotongiens,
Niueans ou Tuvaluans vers la Nouvelle-Zélande (il y a plus de Rarotongiens en Nouvelle-Zélande qu’aux îles Cook), les Nauruans, les habitants de la PNG ou les
Salomoniens vers l’Australie ou bien les Samoans et les Micronésiens vers les États-Unis. Ces migrations sont rendues d’autant plus aisées que beaucoup de ces pays bénéficient de la liberté d’accès dans le pays « tuteur ». On notera par contre que relativement peu de Calédoniens, de Polynésiens français ou de Wallisiens-Futuniens
migrent (de façon définitive tout du moins) vers la France métropolitaine, contrairement aux Antillais par exemple.
Ces migrations peuvent évoluer dans le temps, en fonction de la politique migratoire ou de la situation économique des pays d’accueil. C’est ainsi que durant la crise
qu’elle a subie au début des années 1990, la Nouvelle-Zélande s’est refermée sur elle-même et s’est un temps effacée derrière les États-Unis (Hawaii et la Californie
surtout). La situation interne des pays du Pacifique peut également provoquer des mouvements d’une amplitude non négligeable. Ainsi, les deux coups d’État du
colonel Rabuka, aux îles Fidji (1987) et la période d’incertitude qui a suivi ont engendré une émigration indienne assez forte vers les États-Unis ou l’Australie.
Quoiqu’il en soit, d’une manière générale, plus d’hommes quittent la région qu’il n’y arrivent. Ce phénomène se traduit dans les chiffres (estimations de 2002) par des
soldes migratoires généralement négatifs, dont les plus forts se rencontrent à Niue (-4,3 %), à Tokelau (-2,5), aux Cook (-2,2 %), aux Marshall (-2,0 %), au Samoa (-1,8
%) ou à Tonga (-1,5). Parfois, comme à Niue, les pertes de population par phénomène migratoire ne sont pas compensées par l’accroissement naturel (Niue : +2,1 % et -
4,3 % = -2,2 %).
Ces flux migratoires ne sont pas sans incidence sur les sociétés en place, qu’elles tendent à déstabiliser et donc à fragiliser. On peut leur reprocher de provoquer le
vieillissement de la population du pays de départ, la fuite des cerveaux, l’enfermement dans un système sclérosant qui inhibe les initiatives locales et renforce le pouvoir
des Anciens, l’inscription inévitable dans une logique d’assistanat. Mais on comprend aussi que ces déplacements permettent aux jeunes adultes, les premiers concernés,
de fuir le chômage structurel de leur île pour aller tenter leur chance ailleurs et donc de leur offrir des perspectives d’avenir qui font défaut sur place. Ils offrent aussi au
pays de départ une source de revenus non négligeable par les transferts de salaires qu’ils génèrent (voir ci-après).
2.2. - Les aides financières et les transferts. Le système MIRAB.
Avant tout, les pays de l’Océanie intertropicale s’inscrivent, quels qu’ils soient et à des degrés divers, dans un système d’aide financière, à laquelle contribuent à leur
mesure l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ne sont pas les premiers bailleurs de fonds en ce domaine. Ce système d’aides est assez bien résumé dans ce que deux
chercheurs anglo-saxons, Bertram et Watters, ont appelé le système MIRAB : MI comme migrations (émigration des jeunes actifs vers les pays riches), R comme
remittances (mandats envoyés par les travailleurs émigrés à leurs familles), A comme aid (aide internationale multilatérale et bilatérale), B comme bureaucracy (poids
important de l’administration dans les emplois, financés par l’aide internationale)… Certains ont également proposé le sigle MIRAGE, qui s’obtient en remplaçant
Bureucracy par Government expenditure, sans doute plus explicite.
On peut distinguer plusieurs formes d’aides et de transferts :
- le binôme Migrations / Remittances, qui est élevé à l’état d’institution par un certain nombre de petites entités de Polynésie centrale dont c’est la principale
source de revenus (voir dossier).
- les aides bilatérales, qui sont les plus fréquentes et les plus conséquentes. Elles sont fournies par les métropoles (France, États-Unis) ou les anciennes
métropoles (Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Australie) sous forme de contrats de plans. Elles se caractérisent par des transferts financiers qui peuvent être très
importants (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Guam, par exemple) ou par l’envoi de personnels qualifiés (techniciens, fonctionnaires) rémunérés par la
puissance protectrice. On notera que dans ce volet ce ne sont pas, et de très loin, les puissances océaniennes qui investissent le plus. Australie et Nouvelle-Zélande se
caractérisent même par une assez grande frilosité. Quant aux États-Unis ou à la France, le volume de leur contribution est (ou a été) à la mesure de leur volonté de se
maintenir dans la région, entre autre pour des raisons stratégiques (essais nucléaires, bases de lancement de missiles, stations de surveillance, richesses naturelles, etc.).
Cette présence a un prix, élevé. Les pays insulaires passent aussi des accords ponctuels avec certains pays asiatiques, comme la Chine par exemple (c’est la Chine qui a
financé en grande partie les installations sportives construites à Suva pour accueillir les Jeux du Pacifique de 2003.)
- les aides multilatérales, qui sont un complément aux aides bilatérales. Moins importantes, elles portent sur des projets et répondent souvent à des demandes
précises. On retrouve ici les contributions de la France, du Royaume-Uni, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande dans le financement des actions de la Communauté
du Pacifique ou du Forum, ou bien l’Union européenne qui soutient les programmes de développement dans le cadre du FED.
2.3. – Les politiques économiques et les échanges commerciaux
Les données du problème
Les pays insulaires de l’Océanie intertropicale subissent de plein fouet les échanges inégaux qui caractérisent les relations Nord / Sud. Ils présentent en effet un
faisceau de handicaps qui les prédisposent à être privés d’une partie de leurs richesses au profit des multinationales des pays développés.
En effet, leur faible poids économique les empêche de mettre en place par eux-mêmes des structures d’exploitation ou de commercialisation de leurs richesses
et leurs productions modestes font qu’ils ne peuvent peser sur les marchés. Ils se trouvent tributaires d’un extérieur qui leur impose ses propres règles du jeu. Ainsi, la
plupart des grandes opérations hôtelières ou industrielles sont le fait d’investissements étrangers, ce qui pose le problème de la maîtrise des politiques économiques
locales. On a vu par exemple s’installer à Fidji de grands complexes hôteliers (japonais) dont la construction et le fonctionnement ont échappé pour l’essentiel au pays
d’accueil et qui vivent en autarcie quasi-complète, important même la plupart des denrées alimentaires qu’ils utilisent dans leurs restaurants. Le résultat est que les pays
océaniens comme la plupart des pays du tiers-monde voient leur territoire exploité, voire pillé (ressources minières) sans en retirer pour autant des bénéfices
substantiels. L’origine de ces capitaux est surtout étasunienne en Micronésie et surtout australienne en Mélanésie. Les investisseurs sont plus variés dans l’espace
polynésien.
Se pose également le problème de la faiblesse et du manque de diversification des productions, l’économie de certains pays ne reposant que sur une ressource, à
laquelle s’ajoutent quelques recettes touristiques… L’équilibre financier s’en trouve d’autant plus fragilisé, une baisse des cours ne pouvant être compensée par d’autres
entrées de devises. Si Nauru et le phosphate sont le cas extrême, on peut aussi évoquer les pêcheries des Samoa américaines ou le nickel calédonien, bien que pour ce
dernier cas l’aide de la métropole réduise le danger. Par ailleurs, les exportations se limitent à des produits de base alors que l’on doit importer la quasi-totalité des biens
de consommation. Dans l’ensemble, les balances commerciales sont très largement déficitaires et ne peuvent être compensées que par le tourisme et surtout les aides
évoquées plus haut.
Par ailleurs, on est confronté au problème de la main-d’œuvre qualifiée, très insuffisante dans ces petites entités où l’essentiel de la population vit encore de
manière traditionnelle et où les taux de réussite scolaire sont faibles. Il en résulte que les cadres sont pour une bonne part des étrangers ou des Métropolitains et que les
décisions ne se prennent que rarement sur place.
Le constat de carence ainsi dressé a amené les pays insulaires du Pacifique à rechercher des solutions qui leur permettent de limiter leur dépendance
économique.
Ressources propres et « niches » économiques
La plupart des pays insulaires océaniens sont encore dominés par des structures économiques très traditionnelles reposant sur des formes variées d’agriculture
vivrière ou de pêche et donc de vie en autarcie. À la marge, on essaie de développer un secteur spéculatif qui souvent sert d’appoint aux ressources des familles ou des
villages pour peu que l’on sache mettre en place parallèlement un circuit de commercialisation fiable… Le premier des produits commercialisés sur l’ensemble de la
région est le coprah, mais on a également tenté des expériences de développement de la culture du cacao, du café, du palmier à huile (Mélanésie), des pastèques (Tonga)
ou de la vanille et plus récemment du nono (Tahiti)… Une seule expérience de plantation à grande échelle a véritablement réussi, c’est la canne à sucre à Fidji, mais elle
connaît aujourd’hui de sérieuses difficultés. La Nouvelle-Calédonie a par ailleurs développé un élevage compétitif mais dont la portée demeure locale.
En dehors de l’agriculture et de l’élevage, un autre secteur traditionnel a pu connaître un essor spectaculaire dans certains pays : la pêche. Les Samoa
américaines en vivent largement. D’autres pays, comme la Polynésie française, essaient de développer ce secteur. Les forêts également (aux Salomon en particulier)
peuvent représenter une perspective d’avenir, mais là aussi les moyens manquent.
Les ressources minières sont un axe fort de l’économie de certains pays, essentiellement mélanésiens : PNG (or, cuivre, voire hydrocarbures…), Fidji (or) et
surtout Nouvelle-Calédonie (nickel). Les ressources en phosphates (Makatea, Banaba / Ocean, Nauru) sont à présent épuisées. On constate toutefois que les énormes
investissements nécessités par l’extraction minière ont fait que cette activité a souvent échappé, et échappe encore aux initiatives et aux capitaux locaux. Ceci dit,
malgré le pillage, réel, de ces ressources par des sociétés étrangères, les pays concernés en retirent de substantiels bénéfices qu’ils ne savent malheureusement pas
toujours faire fructifier (on pense à la PNG par exemple).
Au-delà, il faut parler de « niches » économiques. La faible taille des pays océaniens tropicaux les oblige à rechercher des secteurs spécifiques ou plus ou moins
délaissés où la concurrence ne sera pas trop rude. La Polynésie française a ainsi développé la perliculture qui bénéficie d’un label international (la perle noire de Tahiti),
ce qui ne l’empêche pas de se trouver aujourd’hui en sérieuse difficulté face au développement de la concurrence étrangère (en particulier des îles Cook qui ont
également investi ce créneau). D’autres pays se sont lancés dans les pavillons de complaisance, la philatélie (Pitcairn), l’exploitation de sites Internet (Tuvalu) ou même
dans la production de passeports dont il a été dénoncé récemment l’illégalité…
Le tourisme, voie de l’avenir ?
La plupart des pays océaniens jouent la carte du tourisme. L’Australie et Hawaii, avec cinq millions de touristes par an, ou la Nouvelle-Zélande, avec plus de
deux millions, sont devenus de gros marchés touristiques internationaux, qui plus est en forte expansion à une époque où cette activité a tendance à stagner. Mais les
pays insulaires ne sont pas en reste. Ce secteur économique est devenu prépondérant à Guam où la capitale, Agana, est noyée sous les infrastructures hôtelières de front
de mer et sous le flot des touristes asiatiques. On retrouve une forte activité touristique également aux îles Mariannes, à Fidji ou en Polynésie française. Ailleurs, le
tourisme fournit toujours un apport qui peut être conséquent et combler en partie le déficit de la balance commerciale. Partout cependant cette activité est aux mains de
capitaux étrangers et les retombées ne sont pas aussi importantes qu’elles le devraient. L’essentiel des touristes provient de la zone Pacifique : Asiatiques (Japon, Corée
du Sud) un peu partout, mais surtout en Micronésie (plus proche), Étasuniens en Micronésie et en Polynésie, Australiens en Mélanésie… On retrouve également des
touristes européens en Mélanésie et en Polynésie (voir dossier).
Après la production, la commercialisation…
Tout d’abord, les micro-États de la zone ont tenté de se regrouper pour mieux faire face aux enjeux du monde d’aujourd’hui et aux contraintes du marché
international. Si le premier de ces regroupements d’États (la C.P.S. devenue Communauté du Pacifique), initié par les puissances coloniales avant la décolonisation du
Pacifique, n’avait pas une vocation économique, il n’en a pas été de même des suivants. C’est ainsi que le Forum, créé en 1971 autour d’une volonté politique, a rapidement mis en place des agences ou des organismes ayant pour vocation le développement économique concerté de la région (Agence des pêches, Forum Line..).
On notera également des organismes tels que le PROE, le PIDP, la SOPAC, le SPTO et quelques autres (voir dossier).
Au-delà de ces regroupements internes, les pays insulaires tropicaux océaniens ont passé des accords économiques et commerciaux avec les pays du « Nord ».
On retiendra ici les deux plus marquants :
– les accords SPARTECA (South Pacific Regional Trade and Economic Co-operation Agreement) avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces deux pays,
qui ont ouvert entre eux une zone de libre échange des biens et des personnes, ont également signé en 1981 des accords commerciaux permettant aux pays
insulaires membres du Forum d’exporter chez eux leurs productions libres de droits d’entrée ;
– les facilités d’échanges avec l’Union européenne dans le cadre des conventions de Lomé, puis de Cotonou.
Par ailleurs, on n’oubliera pas les accords commerciaux bilatéraux qui sont légion, surtout dans le contexte de pays n’ayant pas encore accédé à l’indépendance.
Des échanges qui demeurent très inégaux
Quelles que soient les mesures entreprises, force est de constater que les balances commerciales des pays insulaires océaniens sont largement déficitaires avec
les pays développés, en particulier avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Ce déficit est en partie compensé par les devises générées par l’activité touristique, puis par
les aides. Le taux de dépendance est donc généralement très fort.
2.4. - La culture , le sport, les loisirs et les enjeux socioculturels
La culture, le sport et les loisirs prennent une part non négligeable dans les échanges à l’intérieur du monde océanien. Ils contribuent fortement à rassembler
autour d’objectifs communs des pays qui par ailleurs ont du mal à se rencontrer à cause de leur éparpillement et de leur isolement. La Nouvelle-Zélande et l’Australie, à
des degrés divers et suivant les circonstances s’impliquent par des aides à la fois financières et techniques, dans ces manifestations dont le cœur demeure le monde
océanien tropical insulaire. On peut en citer quelques-unes :
- le Festival des Arts océaniens (voir dossier)
- les Jeux du Pacifique Sud (voir dossier)
- l’Université du Pacifique-Sud (voir dossier)
- la CEPAC (Conférence des Évêques du Pacifique), dont le siège est à Suva et qui coordonne l’action de l’Église catholique sur l’ensemble du Pacifique
insulaire (hors PNG)
On s’aperçoit donc au travers de ces exemples, que l’on pourrait multiplier, que la volonté de vivre et de travailler ensemble est bien réelle. Mais au-delà de ces
louables initiatives de rapprochement des pays du « Sud » entre eux et avec les deux puissances développées de la région, demeure le problème de deux mondes aux
caractères très marqués qui va bien au-delà des clivages économiques ou des écarts de niveau de vie. En fait, le premier fossé qui sépare ces deux ensembles humains
est culturel, au sens fort du terme. D’un côté les Australiens et les Néo-Zélandais de souche anglo-saxonne sont les héritiers et défenseurs des valeurs occidentales. De
l’autre, les Mélanésiens, Micronésiens ou Polynésiens sont porteurs de valeurs océaniennes qui leur sont propres et qui se marient difficilement avec le monde moderne.
Du contact entre ces deux ensembles sont nés bien des déséquilibres et bien des incompréhensions.
Au sein même de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, les clivages sont encore considérables entre deux sociétés qui ne se comprennent pas toujours. Cela a
commencé par les relations difficiles avec les Maoris ou les Aborigènes, cela se poursuit avec les problèmes d’intégration posés par l’immigration actuelle des Océaniens. On a pu parler, à juste titre, d’un tiers monde à domicile. Ce tiers-monde lutte pourtant pour conserver ses valeurs (langue, coutume), mais son choix
demeure encore et surtout entre l’intégration, synonyme de perte de repères, et le maintien des traditions dans le refus des valeurs occidentales, synonyme de
marginalisation.
Dans les petits pays insulaires, le choix est tout aussi douloureux. Les Salomon, la PNG, le Vanuatu, Samoa souhaitent se protéger des excès du monde moderne
et vivre dans le respect des valeurs traditionnelles qui mettent en avant les structures claniques, le respect des Anciens, la coutume sous toutes ses formes, autant de
facteurs sécurisants, mais bloquants. Ces États se trouvent en marge du développement qu’ils n’approchent que par le biais d’échanges inégaux dont ils ne tirent qu’un
maigre profit. On touche là aux entités parmi les plus pauvres de la planète. À l’autre bout du spectre se trouvent des pays comme Guam ou la Polynésie française, qui
sont largement entrés dans le monde moderne. Ils en ont recueilli les bénéfices, non négligeables au niveau de la santé, de l’éducation ou du niveau de vie, qui n’ont rien
à envier aux puissances occidentales développées. Ils en ont aussi payé le prix : déstabilisation de la société, perte de valeurs ou de repères. Entre les deux, la Nouvelle-
Calédonie présente un exemple saisissant en juxtaposant une communauté de souche européenne vivant à l’occidentale et une société mélanésienne souhaitant
conserver ses valeurs traditionnelles, même si les choses évoluent en ce domaine depuis peu. Ailleurs, la modernité s’immisce à des degrés divers dans les structures
traditionnelles, mais elle introduit en même temps des paramètres déstabilisants comme la critique des Anciens ou l’adoption de pratiques occidentales entrent en conflit
avec l’enseignement des Églises.
2.5. - Les enjeux politiques
L’espace océanien présente tous les types de statuts, depuis les États indépendants jusqu’aux divers statuts d’autonomie.
L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont toujours milité pour que l’Océanie s’émancipe des anciennes puissances coloniales, ne serait-ce que pour mieux, elles-mêmes,
contrôler une région qu’elles considèrent comme leur chasse gardée. Elles ont longtemps agité deux épouvantails : les problèmes ethniques en Nouvelle-Calédonie et les
essais nucléaires en Polynésie française. Deux arguments suffisants pour faire pression à l’échelle internationale (devant l’ONU en particulier) contre la politique –et la
présence- française dans le Pacifique. Le paroxysme de cet affrontement a sans doute été la très malheureuse affaire du Rainbow Warrior. Toutefois, le problème
fidjien, les sérieuses difficultés internes que connaissent ces deux pays avec leurs propres minorités, l’évolution plutôt favorable de la situation intérieure de l’outre-mer
français du Pacifique, ont largement désamorcé les critiques qui se font plus ténues aujourd’hui. Celles-ci ne se sont d’ailleurs pas limitées à la France. Dans son combat
contre le nucléaire, la Nouvelle-Zélande a dénoncé le traité d’alliance militaire qu’elle avait signé avec les l’Australie et les États-Unis (ANZUS), en interdisant l’accès
de ses ports aux sous-marin américains à propulsion nucléaire. La lutte anti-nucléaire qui a servi de ciment à une partie du monde océanien contre les puissances
extérieures a conduit à la signature du traité de Rarotonga (dénucléarisation du Pacifique-Sud).
Par ailleurs, les pays indépendants de la région se regroupent au sein de ce que l’on appelle le Forum des Iles du Pacifique, dominé par l’Australie et la Nouvelle-
Zélande. Le Forum est avant tout une tribune politique qui milite pour l’accès à l’indépendance de tous les pays de la région et qui dénonce la présence de puissances
non océaniennes dans le Pacifique.
3- Des espaces océaniens qui vivent l’interface différemment
L’interface vécue depuis l’Australie et la Nouvelle-Zélande
L’Australie et la Nouvelle-Zélande ne trouvent pas ailleurs en Océanie de partenaires à leur mesure. De fait, elles privilégient les relations Nord / Nord entre elles deux
tout d’abord, puis avec l’Union européenne, le Japon ou les États-Unis. Quant à leurs relations avec les pays du Sud, elles se font avant tout avec certains pays
asiatiques qui sont devenus des partenaires privilégiés ((Indonésie, Philippines, Chine…).
Les relations avec le Sud océanien ne sont pas marginales pour autant. Elles sont d’ordre :
o humain : migrations des insulaires océaniens, surtout en Nouvelle-Zélande
o économiques : implantation de capitaux sur la Mélanésie surtout (Australie)
o humanitaire : l’essentiel des programmes d’aide au tiers monde (AusAID et NZAID) est orienté vers l’Océanie insulaire, même si cette aide est sans
commune mesure avec celle accordée par la France à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, par exemple.
On notera toutefois que l’Australie et la Nouvelle-Zélande vivent différemment ces relations Nord / Sud.
– pour les Australiens, ces relations sont plus imposées que subies et s’identifient bien au modèle. Elle sont avant tout économiques. De nombreuses firmes
australiennes se sont implantées en PNG ou à Fidji par exemple, dans le monde mélanésien, et l’on peut sûrement parler de pratiques néo-coloniales dans
lesquelles l’Australie sait ménager ses intérêts ;
– pour les Néo-Zélandais, ces relations apparaissent plus comme subies qu’imposées. La Nouvelle-Zélande traîne comme un boulet son statut de grande sœur
polynésienne. Si cela lui permet de marquer sa différence et d’affirmer un certain rayonnement dans le Pacifique central, cela l’oblige aussi à servir de terre
d’accueil à une communauté océanienne de plus en plus importante qui se transforme trop souvent en un tiers monde à domicile. Les immigrés océaniens
sont légion en Nouvelle-Zélande. Mal intégrés, ils posent des problèmes sociaux importants. Ils contribuent également à une certaine fuite de capitaux par le
système de « remittances », c’est-à-dire d’envoi d’une partie des salaires vers le pays d’origine.
L’interface vécue depuis le monde mélanésien anglophone
Monde plutôt fermé et cloisonné, le monde mélanésien anglophone, à l’exception de Fidji, est en proie à d’énormes problèmes de développement. Les sociétés sont
demeurées très traditionnelles et avant tout rurales. Quant aux villes (Port Moresby en particulier), elles sont insalubres et dangereuses. Le niveau de vie est très faible et
la situation politique est difficile : guerre entre la PNG et les Salomon, indépendance mal gérée au Vanuatu, coups d’État à Fidji… Quant à l’économie, ou ce qu’il en
reste, elle végète ou bien est entre les mains de puissances extérieures, l’Australie en particulier, dont c’est la zone d’influence directe et qui se comporte en puissance
néo-coloniale. C’est aussi l’Australie qui accueille les quelques Mélanésiens qui ont décidé de tenter leur chance hors de leur pays. Seules dans ce marasme les îles Fidji
semblent présenter quelques perspectives d’avenir malgré les récentes difficultés liées à l’exploitation sucrière et la concurrence des textiles asiatiques.
L’interface vécue depuis le monde polynésien anglophone
Le monde polynésien anglophone est un monde de petites îles sans ressources propres autre que la pêche, dont ont su tirer profit les Samoa américaines, et le coprah. Il
souffre d’énormes problèmes de communications avec l’extérieur, ce qui limite considérablement le développement du tourisme. Encore freiné par les traditions qui
bloquent tout développement dans ces îles, il laisse partir ses jeunes vers l’extérieur (la Nouvelle-Zélande surtout), ce qui lui permet de survivre grâce aux mandats
rapatriés au pays. Cette politique migratoire élevée à l’état d’institution (voir dossier) nourrit artificiellement les finances locales et place ces pays dans une situation de
forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur.
L’interface vécu depuis le monde micronésien
La Micronésie est résolument tournée vers le Japon et les États-Unis. Elle sort ainsi de l’interface strictement océanien. Le niveau de vie convenable de Guam, voire des
Mariannes du Nord est dû tout autant à la rente stratégique qu’aux activités touristiques et apparaît comme le résultat d’une économie extravertie qui échappe aux
intérêts locaux. Le néo-colonialisme économique bat son plein dans ces îles. Dans les autres archipels micronésiens, qui échappent à cette main-mise extérieure (États
Fédérés de Micronésie, îles Marshall, Kiribati…), la situation est bien différente mais moins réjouissante. Dans ces pays délaissés par le Nord, l’état de marginalisation
est extrême et le niveau de vie très bas, sans qu’il y ait de véritables perspectives d’avenir.
L’interface vécu depuis les entités françaises du Pacifique
Les entités françaises du Pacifique sont tournées vers la France, dont elles reçoivent l’essentiel de leur aide, ce qui leur permet de pointer parmi les pays les plus riches
de la région. Dans l’espace océanien, elles se retrouvent isolées de par l’héritage de la colonisation (elles sont françaises dans un monde anglo-saxon) et du fait de leur
statut politique (elles sont autonomes et non indépendantes). De fait, elles entretiennent peu de liens commerciaux avec leurs voisins et ne participent pas à tous les
grands projets océaniens (ceux initiés par le Forum par exemple). Par contre, leur haut niveau de vie et leurs attaches avec la France (donc avec l’Union européenne)
peuvent les amener à servir de vecteurs des pays du Nord vers le Sud océanien en difficulté (aides à la suite de catastrophes naturelles par exemple, comme aux Tonga
récemment).
Elles vivent de manière inégale l’écart qui existe entre un niveau de vie et des structures économiques à l’occidentale qui les rapprochent des pays du Nord et des
mentalités « océaniennes » qui s’accommodent difficilement des bouleversements actuels.
4- Annexe documentaire : quelques tableaux pour mieux comprendre (voir pages suivantes).
AUSTRALIE – NOUVELLE - ZÉLANDE : TABLEAU COMPARATIF
AUSTRALIE – NOUVELLE – ZÉLANDE / OCÉANIE INTERTROPICALE : TABLEAU COMPARATIF
1) Des points communs ?
Quasiment aucun point commun entre ces deux ensembles, si ce n’est que :
– ils sont situés dans une périphérie, aux antipodes de l’Europe ;
– ils ont tous été colonisés par les Européens ou les Américains.
2) Deux mondes très différents
UN OU PLUSIEURS MONDES EN OCÉANIE INTERTROPICALE ?
Milieu naturel
– Opposition entre :
-
- les grandes terres mélanésiennes
- les terres exiguës, dispersées, de Polynésie et de Micronésie
– Climat tropical plus ou moins marqué. Zone occidentale plus touchée par les cyclones
– Situation très différente par rapport aux handicaps liés à l’insularité (le monde mélanésien est bien mieux loti que les mondes
micronésien et polynésien)
Démographie et population
– trois mondes ethno-culturels : Mélanésie, Polynésie, Micronésie
– deux mondes linguistiques et culturels issus de la colonisation : aire francophone et aire anglophone
– opposition entre des comportements démographiques de type tiers-monde d’un côté (on est en phase B de la transition
démographique) et de type développé de l’autre (on est sorti de la transition démographique)
– comportements différents par rapport aux migrations : les Mélanésiens migrent peu alors que les Micronésiens et surtout les
Polynésiens centraux migrent beaucoup
Situation politique
– une découverte et une colonisation tardives. Les puissances coloniales ne se sont pas bousculées en Océanie, mais elles ont
fini par y faire leur marché. L’Océanie a été dépecée comme l’Afrique par exemple et a fait l’objet des mêmes tractations. Il en
est résulté les découpages politiques actuels qui ne correspondent pas à l’histoire océanienne (WF par rapport à Tonga et
Samoa, les deux Samoa, la PF et les îles Cook, etc.
Opposition entre :
– des pays indépendants, de fraîche date
– des pays dépendants, mais largement autonomes (à l’exception de WF et de Pitcairn)
Richesses naturelles
– richesses minières dans le monde mélanésien et sur quelques atolls (phosphate)
– richesse en bois d’œuvre en Mélanésie seulement
– espaces favorables aux plantations et à l’élevage en Mélanésie seulement
Situation économique et problèmes de
développement
Très gros écarts de développement entre les différentes entités de la zone. On distingue :
– des PMA, qui ne disposent d’aucune richesse et vivent très pauvrement
– des PED qui survivent par des transferts et des aides qui viennent épauler une vie économique fragile
– des entités qui présentent les caractères économiques des pays développés, grâce à une mono-activité dominante
(Guam, Nauru, voire les Mariannes du Nord) ou aux transferts et aides très importants venant épauler des activités
plus ou moins florissantes (NC et PF), mais qui connaissent une fracture sociale caractéristique des PED.
La société : de la tradition à la déstabilisation
- partout, les sociétés océaniennes sont profondément ancrées dans la tradition, elle-même marquée par l’évangélisation. Il s’en
suit des blocages importants au niveau des mentalités et des pratiques quotidiennes. Ces blocages (coutume, tapu,
intégrisme…) freinent le processus de développement et marginalisent les pays les plus concernés
– parallèlement, de plus en plus de pays océaniens entrent dans le monde moderne, mais ils s’en trouvent déstabilisés, voire
déstructurés. L’abandon des valeurs traditionnelles n’est pas toujours relayé par l’adoption de nouvelles valeurs. Ces pays
connaissent de profondes crises identitaires
Regroupements régionaux
Plusieurs types de regroupements régionaux existent. Ils ont généralement été initiés par les anciennes puissances coloniales :
– la C.P.S. (devenue Communauté du Pacifique) qui regroupe tous les pays de la région, ainsi que l’Australie, la NZ,
le Royaume-Uni, la France…
– le Forum, qui regroupe seulement les pays indépendants de la région
– autres regroupements possibles : Fer de Lance mélanésien (politique), SPARTECA (économique), etc…
Relations avec l’extérieur Les pays sont écartelés entre différentes influences extérieures qui sont toujours plus fortes que les influences de proximité. On
a parlé de quatre mondes :
-
- le monde australo-mélanésien
- le monde zélando-polynésien
- le monde franco-océanien
- le monde américano- micronésien
En fait, il existe des relations bilatérales très fortes entre entités océaniennes et ex-pays colonisateurs ou leurs séides (Australie,
NZ). À ces relations, il faut ajouter le poids de certaines puissances économiques du Pacifique comme le Japon ou les États-
Unis. Enfin, l’aide de l’Union européenne n’est pas négligeable.
ATOUTS ET HANDICAPS AU DÉVELOPPEMENT EN OCÉANIE INTERTROPICALE
Principaux caractères du relief des îles et États de l’Océanie intertropicale
++++
II- EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
Cette question a un statut différent suivant qu’elle est traitée en série L/ES ou en série S.
En série L/ES, elle s’insère dans le thème général « des mondes en quête de développement » où, après un chapitre de présentation sur l’unité et la diversité des
Sud, on passe à deux études de cas : l’Océanie comme interface Nord / Sud (la Méditerranée en métropole) et la Russie en tant qu’espace en recomposition.
Dans la série S, l’angle problématique apparaît moins. L’Océanie devient une question à part entière, au même titre que les États-Unis ou l’Asie orientale. On
pourrait penser que l’on est plus dans la logique d’une étude de géographie régionale que de géographie thématique. En fait, la problématique du développement inégal
demeure tout à fait centrale.
Quelles notions activer ?
La notion de développement est fondamentale. On admettra que le développement « désigne l’accroissement des richesses associé à l’amélioration des conditions de
vie d’une population sur un territoire et va donc bien au-delà de la simple croissance économique » (accompagnement des programmes de terminale). Elle appelle
toutefois des interrogations sur sa mesure (quels critères adopter ?), sur l’échelle d’analyse (nationale, régionale, locale ?) et sur les écarts qu’elle révèle. Ces écarts en
Océanie revêtent toutes les formes possibles et imaginables puisque l’on trouve dans la région des pays à classer dans les PMA, des pays en développement, des pays
partiellement développés mais assistés, des pays développés enfin… Ces écarts dans le niveau de développement auront été analysés dans la première partie du thème
sur les mondes en quête de développement (séries L et ES) ou dans « Les centres d’impulsion et les inégalités de développement » (série S). Il sera sûrement nécessaire
d’y revenir dans la série S. On aura posé également l’interrogation sur les différentes dénominations utilisées dans le passé et dans le présent pour désigner les pays
connaissant des difficultés de développement (tiers-monde, pays sous-développés, pays en voie de développement, pays en développement, pays les moins avancés,
mal-développement, Nord et Sud, ou « les Nord » et « les Sud »…). Le professeur aura sans doute à l’esprit que le découpage Nord / Sud sur lequel il travaille dans
cette séquence peut être discuté, dès l’instant où il relève d’une réalité géographique datée qui trouve ses limites aujourd’hui (que faire des NPI par exemple, et
comment situer les collectivités d’outre-mer françaises du Pacifique ?).
À la notion de développement il faut adjoindre celle de développement durable, « qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs » (rapport Brundtland). Le développement durable est particulièrement à prendre en compte dans le milieu insulaire océanien, d’une grande
fragilité.
La notion d’interface est évidemment centrale. Elle est explicitée plus haut. Elle implique celles de contact, d’échanges (inégaux le plus souvent), de flux… Ces
échanges et ces flux sont à la fois humains, économiques, culturels…
Une autre notion, plus spécifique à la région océanienne, est fondamentale : l’insularité. On ne peut comprendre le fonctionnement de la région sans s’attarder sur les
composantes de l’insularité et sur leurs conséquences. La notion d’insularité sous-tend les notions d’éloignement, de dispersion, d’exiguïté, autant de handicaps au processus de développement. Elle doit se nourrir d’une réflexion sur la notion de distance. La distance ne doit pas être envisagée que sous la forme kilométrique. C’est
aussi la distance-coût, la distance-temps, la distance-fréquence…
D’autres notions, que l’on qualifiera de notions-relais, pourront être utilisées et exploitées : le système « MIRAB », les différents types d’aide et de transferts (dont
NZAID et AUSAID), les « niches » économiques, les accords commerciaux préférentiels (SPARTECA), l’assistanat, le développement artificiel. Des organismes
devront être connus, comme la Communauté du Pacifique ou le Forum, de même que l’on retiendra les diverses formes de l’intervention européenne (FED, Convention
de Cotonou…).
Quels objectifs cognitifs poursuivre, au moyen de quelles problématiques ?
À l’issue de l’étude de cette question, les élèves devraient être en mesure de :
– replacer l’étude de l’Océanie dans le cadre de la mondialisation et des interdépendances ;
– mesurer la diversité du monde océanien et en percevoir les principales caractéristiques ;
– savoir décrire et analyser les écarts de développement entre les pays océaniens ;
– comprendre la nature et les enjeux des échanges Nord / Sud en Océanie et dans le monde ;
– saisir la complexité de ces échanges à l’échelle d’un pays insulaire ;
– comprendre l’impact d’une activité comme le tourisme dans le processus de développement ;
– appliquer la notion de développement durable au monde océanien à partir de quelques exemples (catastrophe phosphatière de Nauru, la gestion de la forêt
ou de la faune marine, la question des littoraux…) ;
– mettre en relation les notions de développement, d’aménagement et de gestion de l’espace, de respect de l’environnement.
Ces quelques pistes (non exhaustives) doivent servir de trame à la construction d’un cours que le professeur problématisera à sa convenance dans le respect des
objectifs généraux tels qu’ils sont définis dans les programmes et leurs accompagnements.
Le traitement de cette question doit permettre de reprendre, en les approfondissant à une échelle régionale, les problématiques sur la mondialisation et l’inégal
développement. On rappellera qu’il ne s’agit pas d’étudier l’espace océanien pour lui-même mais en tant qu’exemple significatif d’interface Nord / Sud.
L’organisation de la séquence
Elle relève de la liberté pédagogique de l’enseignant. On ne saurait trop recommander toutefois de songer à un traitement, au moins partiel, par étude de cas.
++++
III- DOSSIER DOCUMENTAIRE
Remarques préalables
Une batterie de documents cartographiques sur l’Océanie est disponible sur le site www.itereva.pf
(disciplines/pédagogie/ressources documentaires). Ils ne sont pas reproduits ici.
Les documents ci-après présentent beaucoup de données chiffrées. Celles-ci posent problème. En effet, elles
varient énormément d’une source à l’autre, y compris en ce qui concerne les superficies ! Les raisons en sont
multiples : rareté et fragilité des recensements, manque de fiabilité parfois volontaire des documents
statistiques, évolution très rapide de certaines situations, en particulier au sein des micro-États où les
retournements démographiques ou économiques peuvent être marqués, difficultés à évaluer des économies
de subsistance qui échappent à la logique des marchés, manque d’intérêt des grands organismes mondiaux
(organisations internationales, banques…) pour des entités considérées comme négligeables à l’échelle de la
planète…
Travailler sur un outil statistique qui serait fiable relève donc de l’utopie en Océanie. Il n’est pas douteux que
vous trouviez au cours de vos recherches des chiffres différents de ceux présentés ici, et ce pour les mêmes
années de référence. Il est donc important de considérer ces chiffres comme approximatifs et de les utiliser
surtout dans une approche comparative. Dans la mesure du possible, chaque tableau de données fait
référence à une source statistique officielle dont il est toujours fait référence. On retrouvera la Communauté
du Pacifique, la Banque mondiale ou Index mundi. Index mundi est la production en ligne du World factbook,
document statistique de synthèse émis par les services de renseignements étasuniens.
On notera enfin que certains documents n’ont pas été traduits de l’anglais. Il s’agit là d’une démarche
volontaire visant à favoriser la transdisciplinarité. Ces documents ne présentent d’ailleurs pas de difficulté
particulière et doivent être compris par tout élève de terminale.
Quelques sites
Figurent ci-dessous quelques sites qui permettent d’aller plus facilement à la collecte d’informations
statistiques récentes :
– Le site du secrétariat de la Communauté du Pacifique : www.spc.org.nc, que l’on complètera par son récent
prolongement statistique, le PRISM : www.spc.int/prism/, qui est un système d’informations en ligne pour la
région océanienne, récemment mis en place.
– Le site du PIDP - East-West center, qui fournit une multitude de liens très utiles :
www.pidp.eastwestcenter.org/pireport/text.shtml (aller sur islands profiles)
– Le site d’Index mundi, émanation du CIA World factbook : www.indexmundi.com
– Le site de la banque mondiale : www.banquemondiale.org
– Un site renvoyant à des données statistiques générales : www.liensutiles.org/oceanie
– Un site sur la lointaine Micronésie : www.mymicronesia.com
– Le site officiel de statistiques néo-zélandais, Te tari tatou : www.stats.govt.nz
– Le site officiel de statistiques australien : www.abs.gov.au
1- Principaux caractères des pays océaniens
Document 1 : tableau de bord
(1) Évaluation 2006, en dollars US PPP (purchasing power parity). Données lissées en fonction des sources.
Lorsque les écarts sont trop importants, voir ci-dessous.
* 19 000 (NC), 700 (PNG), 1 200 (Kiribati), selon certaines sources.
Document 2 : données démographiques
(Année de référence : 2007 - estimations. Certains chiffres moins récents ont été extrapolés)
* 52 (Vanuatu), 60 (Marshall), selon d’autres sources ;
Document 3 : deux données démographiques en graphiques
Taux de mortalité infantile (2000)
(Source : Communauté du Pacifique)
Indice synthétique de fécondité (2000)
(Source : Communauté du Pacifique)
Doc. 4 : les handicaps liés à l’insularité
Il n’y a pas forcément de lien de cause à effet entre insularité et niveau de vie.
On recense en effet autant de pays en difficulté dans la catégorie à faibles handicaps insulaires que dans la catégorie à
forts handicaps. Il en est de même pour les pays au PNB/hab. élevé. Il apparaît en conséquence que les handicaps liés à
l’insularité sont surmontés par l’homme lorsque ce dernier est placé dans un contexte socio-économique favorable.
Quelques exemples nous aideront à mieux le comprendre.
Prenons le cas de la PNG. C’est de loin le pays le moins lié aux contraintes insulaires et c’est pourtant l’un des pays les
plus pauvres de la région. Peut-on raisonnablement inclure d’autres facteurs limitants liés aux conditions naturelles ? Ce
ne serait pas convainquant là non plus. En effet, si la montagne et la forêt représentent un handicap réel, celui-ci est
largement compensé par les richesses du sous-sol. Il faut donc rechercher ailleurs, au niveau des structures sociales ou
politiques probablement, les véritables raisons des graves problèmes de développement qu e connaît le pays.
Commentaires
Ces quatre documents sont extrêmement riches et peuvent être utilisés de manière transversale ou
complémentaire avec les documents qui suivent. Les chiffres qu’ils donnent ne sont qu’indicatifs et certains
(taux de natalité, PNB/hab….) évoluent très vite. Il n’en demeure pas moins que leur recoupement peut
conduire à une classification pouvant être éclairante. On dégagera quelques idées-forces :
– la situation démographique des pays de la région s’oriente vers un type évolué et rares sont les pays
qui demeurent dans un contexte de sous-développement à ce niveau. Par contre, tous les cas de
figure se rencontrent ;
– les données migratoires sont capitales (voir plus loin) pour bien comprendre certaines situations ;
– les écarts de niveau de vie sont eux-mêmes considérables, mais recouvrent des réalités fort
différentes. On pourra montrer l’aspect artificiel de certaines situations ;
– la relation entre handicaps liés à l’insularité et niveau de vie n’est pertinente que pour les cas
extrêmes (Kiribati, Tokelau…) ;
– chaque ensemble géographique a ses pays moteurs et ses pays en grande difficulté ;
– l’Australie et la Nouvelle-Zélande affichent à tous les niveaux les caractères bien marqués des pays
développés.
L’INSULARITÉ
L’approche de la notion d’insularité est d’une grande complexité, ne serait-ce que par la définition de l’île qu’elle
présuppose (comment classer par exemple la PNG, qui est manifestement un espace plus continental qu’îlien ?). En fait,
l’insularité s’organise autour de quatre indices majeurs, l’exiguïté, l’isolement, l’éloignement et la dispersion.
– l’exiguïté : la notion d’île ou de milieu insulaire impliq ue obligatoirement le caractère d’exiguïté. En effet, on a pu
écrire avec raison que "les vraies îles sont celles qui subissent, sans pouvoir les modifier, les influences de l’hydroclimat
océanique" (Fr. Doumenge). Cet élément de définition amène à distinguer en fait les petites îles océaniques, dont la
surface ne saurait excéder 4 000 km² et dont le modèle absolu est l’atoll, et les "grandes terres", qui sont des îles de
4 000 à 20 000 km² où le climat océanique subit l’influence plus ou moins marquée du relief. Dans cette approche, seule
la partie "continentale" de la PNG échappe à l’insularité.
– l’isolement : les îles et archipels de l’Océanie intertropicale sont noyés dans l’immensité océanique et se retrouvent fort
distants les uns des autres. François Doumenge a souhaité mesurer ce handicap en créant un indice d’isolement, calculé
en rapportant la surface des terres émergées à la surface maritime en Zones Economiques Exclusives, ou ZEE. Il
propose que tout indice supérieur à 100 soit considéré comme de fort isolement (donc de fortes contraintes). Pour les
îles et archipels de l’Océanie intertropicale, l’indice d’isolement est globalement de 1/55, soit 1 km² pour 55 km² de
ZEE, mais ce rapport est largement faussé par la présence parmi les 22 entités de la région des 462 000 km² de la PNG.
La PNG écartée, on se retrouve avec 1 km² de terres émergées pour 300 km² de Z.E.E. (1/300) !
– l’éloignement : l’indice d’isolement ne dit pas tout. En effet, l’isolement tel qu’il est défini ci-dessus ne mesure q ue les
rapports de surfaces au sein d’un même ensemble régional. Il ne tient pas compte de l’éloignement par rapport aux
centres extérieurs. Que les Cook soient proches de la Polynésie française ou que le Vanuatu soit proche des Salomon ou
de la Nouvelle-Calédonie ne rompt en rien la dynamique de l’iso lement de ces pays-là. Par contre, le fait q ue la
Nouvelle-Calédonie ne soit qu’à 1 600 km de Brisbane ou que les Mariannes ne soient qu’à 2 800 km du Japon, alors
que la Polynésie française pointe à 5 000 km du centre d’impulsion le plus proche (Auckland) laisse moins indifférent.
Ajoutons qu’une analyse plus fine doit permettre de dépasser ces considérations sur les distances kilométriques pour
s’interroger sur les distances-temps, les distances-fréquences ou les distances-coût, qui serrent de beaucoup plus près la
réalité.
– la dispersion : les petits pays insulaires éprouvent d’autant plus de difficulté à se développer qu’ils sont éclatés en
archipels. La différence est ainsi énorme entre le Kiribati, composé d’une nuée d’atolls dispersés sur un immense
territoire et ses voisins samoans, beau coup plus concentrés. La même remarqu e pourrait être faite entre Guam et les
Mariannes du Nord ou entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Enfin, les 2 935 km² de Savai’i et Upolu, qui à elles
seules constituent le Samo a, et les 3 521 km² d e la centaine d’îles qui composent la Polyn ésie française ne recouvrent
pas la même réalité. Nous pouvons ainsi poser comme postulat que plus un pays compte d’îles habitées, et plus ces îles
sont éloignées les unes des autres, plus il éprouvera de difficultés à engager un processus de développement. En effet, la
dispersion accentue les handicaps déjà constatés et en rajoute d’autres :
- l’éloignement se calcule en général par rapport à l’île-capitale. Les handicaps qui lui sont liés se trouvent
multipliés lorsqu’on prend en compte les îles périphériques.
- la dispersion de la population sur plusieurs îles engendre des dépenses accrues au niveau des transports,
aériens ou maritimes. Il faut ravitailler ces îles, qui d e leur côté ont besoin d’exporter ce qu’elles produisent.
- la dispersion et l’éclatement entraînent des "dépenses d’échelle" parfois colossales. Une île habitée, aussi
éloignée soit-elle, a besoin d’infrastructures minima (wharf, école, dispensaire, voire port, aéroport, collège,
infirmerie...). Tout cela coûte très cher, pour des effectifs de population parfois très réduits.
2- Les flux migratoires ; l’exemple de la Nouvelle-Zélande et de Samoa (étude de cas)
Doc. 1 : évolution de la population océanienne en Nouvelle-Zélande
* Maoris et métis sont regroupés dans la population maorie
Doc. 2 : l’immigration en Nouvelle-Zélande depuis 1990
Doc. 3 : l’immigration océanienne en Nouvelle-Zélande depuis 1969
« En 1969, les autorités néo-zélandaises décidèrent de favoriser l’immigration de main d’œuvre en provenance de
monde entier, y compris des entités polynésiennes… La situation économique s’étant détériorée en 1974, le
gouvernement changea de politique migratoire… Les procédures de régularisatio n devinrent plus rigoureuses et la
police fit la chasse aux immigrants en situation irrégulière… À partir de 1975, l’opinion publique néo-zélandaise a ainsi
radicalement changé à l’encontre de l’immigration polynésienne… Le débat sur l’immigration prit alors une tournure
ouvertement raciste… Un rapport d e 1986 … montrait qu’un nomb re disproportionné d’insulaires du Pacifique avaient
été poursuivis comme étrangers en situation irrégu lière. 86 % des poursuites les concernaien t en dépit du fait qu’ils
représentaient seulement un tiers de ces irréguliers. En comparaison, les clandestins américains et anglais, qui
représentaient 31 % des overstayers, ne représentaient que 5 % des individus poursuivis…
Entre 1986 et 1989, le nombre d’immigrés en provenance des îles du Pacifique doubla par rapport aux cinq années
précédentes… Les Fidjiens ont été particulièrement nombreux à émigrer à la suite des deux coups d’État qui eurent lieu
à Fidji en 1987. Cet accroissement est également dû au programme visant à régulariser la situation des clandestins à
partir du mois de n ov embre 1987…Depuis la fin des années 1991, la Nouvelle-Zélande est revenue à une politique
restrictive et désormais l’autorisation d’entrer dans le pays est fonction d’un nombre de points que doit obtenir
l’immigrant… »
Doc. 4 IMMIGRER EN NOUVELLE-ZÉLANDE AUJOURD’HUI
(application des textes de 2002)
L’immigration est libre pour les ressortissants australiens.
Pour les autres pays, deux possibilités :
- obtenir un visa qui autorise le séjour en NZ durant une année, reconductible
- obtenir un certificat de résidence qu i autorise un séjour à durée illimitée
Les services de l’immigration néo-zélandais distinguent plusieurs catégories de migrants auxquelles ils appliquent une
réglementation différente :
- les migrants relevant de conditions générales, qui sont recrutés au mérite selon leur classement à partir d’un
système d’attribution de points tenant compte des diplômes, de la qualification professionnelle, de l’âge (de 18 à 55
ans)…
- les migrants de la catégorie « affaires » (business), investisseurs ou entrepreneurs recrutés eux-aussi selon un
barème qui privilégie l’expérience professionnelle et l’apport financier
- les familles : le certificat de résidence est accordé automatiquement aux conjoints et enfants de citoyens néo-
zélandais et selon un quota et après analyse du dossier aux candidats recommandés par des citoyens néo-zélandais.
- les catégories dites « spéciales », qui concernent les ressortissants de certaines îles polynésiennes du
Pacifique. Les ressortissants des pays concernés remplissent un formulaire qui est ensuite tiré au sort par les services de
l’immigration jusqu’à ce que soit atteint un quota. Pour l’ann ée 2002, le quota était fixé à 1 100 Samoans, 250
Tongiens, 75 Tuvaluans et 50 I-Kiribati. Tous doivent ensuite justifier d’une promesse d’emploi dans le pays. Pour les
Tongiens, Tuvaluans et I-Kiribati, il est de plus imposé d’être âgé de 18 à 45 ans (on notera que les habitants de Niue et
des îles Cook ne sont pas soumis à cette réglementation puisqu’ils bénéficient d’un passeport néo-zélandais.
- à ces catégories, il faut ajouter les personnes relevant de l’aide humanitaire et les réfugiés (750 en 1999)
Pour tout candidat à l’immigration, il est demandé en substance une bonne maîtrise de l’Anglais, un certificat médical
attestant d’un bon état de santé et un extrait de casier judiciaire.
En-dehors des quotas fixes attribués à certains Océaniens, le système de classement permet de contrôler l’immigration
en travaillant sur le barème, que l’on ouvre plus ou moins en fixant chaque année la barre des points nécessaires à
l’obtention du certificat de résidence.
Doc. 5 : les femmes samoanes en Nouvelle-Zélande
« Elle arriva en Nouvelle-Zélande il y a cinq ans. Elle ne savait pas qu’elle allait partir dans ce pays jusqu’à une
semaine de son départ. Son père avait téléphoné à sa sœur qui vivait à Christchurch et lui avait demandé de payer son
voyage. Elle fut prévenue après que tout ait été organisé. Au début, elle ne voulait pas partir et elle pleura... En moins
d’un mois, elle obtint un emploi de couturière dans la firme où son oncle travaillait… Son emploi consistait à coudre
des collants… Elle avait à fournir un quota journalier et si elle ne le faisait p as, elle perdait son emploi. Elle travaille au
moins cinquante heures par semaine et dans une bonne semaine elle gagne 320 dollars néo-zélandais. Elle envoie au
moins la moitié de cette somme directement à ses parents aux Samoa ».
Doc. 6 : les problèmes posés par l’immigration océanienne en Nouvelle-Zélande
« Un des problèmes majeurs qui est posé par les immigrants océaniens tient au fait qu’en 1995, 97 % d’entre eux
résidaient dans les zones urbaines… Cette situation est particulièrement préoccupante si l’on songe que l’immense
majorité des Océaniens a grandi dans des petits villages insulaires, au sein de sociétés traditionnelles rurales, dans une
économie de subsistance. Brutalement, ces ruraux sont propulsés dans un style de vie qui leur est étranger, en particulier pour les jeunes qui évoluent vers l’exclusion ou la délinquance…C’est une situation de ghetto qui se développe, avec
son cortège de marginalisation et d’exclusion, parmi une population particulièrement frappée par le chômage… D’après
Ron Crocombe, le taux de criminalité des Océaniens est 4,7 fois plus élevé que celui de la population néo-zélandaise…
De plus en plus d’adolescents d’origine océanienne … font partie de gangs, de bandes de jeunes délinquants qui
prolifèrent dans les rues des grands centres urbains…
[Ceci] est la conséquence de nombreux facteurs comme l’aliénation culturelle, les cond itions de vie dans les zones
urbaines déshéritées, mais aussi et surtout les niveaux de qualification, les conditions d’emploi, le chômage … Peu
d’insulaires sont instruits, la majorité étant employée dans les usines comme manœuvres… »
Doc. 7 : quelques chiffres et indices pour mieux comprendre
(1) Estimations 2000
* toutes ethnies confondues
Doc. 8 : une manne provisoire ?
« Les transferts financiers des immigrés samoans cessent dès la deuxième génération, que ce soit à l’égard des parents
restés dans les îles ou à l’égard des Églises qui demandent régulièrement des sommes considérables aux émigrés…
Souvent, les mariages mixtes accélèrent ce phénomène d’assimilation au pays d’accueil avec en parallèle l’oubli du
pays des ancêtres. Si un jour les pays développés du Pacifique venaient à fermer leurs portes aux immigrants insulaires
de la région , les transferts cesseraient dès la deuxième génération et ces micro-États sous développés connaîtraient de
graves problèmes économiques et sociaux ».
Doc. 9 IMMIGRATION QUOTA CHANGES
Dated : 16 Sep 2004 By MINISTRY OF THE PRIME MINISTER AND CABINE
Visa Free Travel
The Petition for Visa Free travel to New Zealand for our citizen s is not proceeding. There was a previous arrangement
in December 1986 to February 1987 for all Pacific countries including Samoa. This, however, was discontinued
because of the very high number of over-stayers in New Zealand from Samoa at that time.
• The New Zealand Immigration Services has improved the speed of verification of job offers to in most cases,
within 14 days of receipt of required information from prospective employers.
• Quota places are now released throughout the year rather than during just one month. Applicants will not be
seeking jobs in New Zealand at the same time thus reducing potential adverse impact on the Samoan labour
force.
• Applications are now accepted from Samoan people already lawfully in New Zealand. They need not return to
Samoa to submit applications for residence, as was previously the case.
• A new relationship manager position to be established to focus on identifying and establishing employment
opportunities for pro spective Samoan quota migrants.
• The development of private sector partnerships, to assist place suitable migrants in employment will be
pursued and to be in place for the 2005/06 quota year.
• The minimum income level requirement to be based on the unemployment benefit and the maximum
accommodation allowance. This reduces the level from NZ$31,556 to $25,585 per annum.
• The remaining places from the unfilled 2002/03 and 2003/04 quotas to be retained and made available over
the course of the next three quota years, commencing with the 2004/05 year.
• Settlement information for Samoan migrants to be provided, more ap propriately targeted to Samoan migrants’
needs.
• If there are unfilled in the Samoan quota at the end of each financial quarter, Samoan citizens who are
lawfully in New Zealand and have a job offer may apply for, and may be granted residence under the quota.
The two countries have agreed on holding annual consultations at Ministerial level to discuss bilateral issues like
Immigration, Quarantine, Trade, Security and so on. .
Doc. 10 . les migrations internationales aux Samoa américaines
« The population of American Samoa has been shaped by international migration as evidenced by the relative
proportions of foreign-born persons over the year. In 1990, 45% of the population were foreign-born compared to only
12% in 1960. The highest increase the foreigne-born population was during the decade 1960-70, when it increased by
205%.
The main migrants flows to American Samoa have been from Samoa, Tonga and other Pacific Island countries, mainly
for empoyment reasons. American Samoa’s attractive wage rates have lured many people over the years, especially
from neighbouring countries. Furthermore, American Samoa has served as a gateway for people wishing to migrate to
th e US mainland ».
Commentaires
Les Océaniens étaient 230 000 en 2001, soit 6% de la population de la Nouvelle-Zélande (ils n’étaient que
130 000 pour 4 % de la population en 1986). En fait, leur nombre ne cesse d’augmenter (doc. 1) et certaines
projections de population font apparaître que ces populations, soit par immigration soit par accroissement
naturel, devraient atteindre 300 000 habitants en 2010 et peut-être 600 000 habitants en 2050, soit 12 % de la
population du pays. Cette immigration s’est surtout développée à partir des années 1960, lorsque les colonies
océaniennes ont accédé à l’indépendance (Samoa dès 1962, Fidji en 1970…) ou à une large autonomie. Très
fragiles économiquement, les pays océaniens ne sont alors pas capables de fournir du travail aux jeunes
adultes qui tentent leur chance dans les pays développés de la région. Ces migrants forment rapidement
Nouvelle-Zélande un noyau qui fera office de catalyseur pour d’autres candidats à l’émigration. Il s’en suit
un effet boule de neige que le pays d’accueil souhaite contrôler, surtout dans les années 1970, lorsqu’il est
touché par la crise économique. À partir de cette date, le flux d’immigrants océaniens est tributaire des règles
édictées par la Nouvelle-Zélande en fonction de ses besoins (doc. 3 et 4). Les Océaniens bénéficieront
cependant de mesures de faveur (sous forme de quotas plus ou moins garantis) par rapport aux autres
candidats à l’immigration. Le graphique du document 2 montre les effets de cette politique migratoire : deux
pics d’immigration entourent les années 1990-1994, au cours desquelles la Nouvelle-Zélande a traversé une
rude crise économique. Le document 4 précise les données actuelles du problème.
En fait, si la Nouvelle-Zélande a pu tirer quelque profit de cette immigration océanienne en période de
prospérité, ce n’est plus le cas aujourd’hui. En effet, ces immigrés, très nombreux, éprouvent de sérieuses
difficultés d’intégration. Ils arrivent dans le pays avec un niveau de qualification souvent modeste et ont
beaucoup de difficulté à trouver du travail. Près de 20 % des adultes n’ont pas d’emplois et 20 % sont
employés à temps partiels. La plupart des autres vivent de petits boulots peu rémunérateurs (doc. 5).
Agglutinés dans certains quartiers des grandes villes (dans le sud d’Auckland surtout), ils forment un lumpen
prolétariat vivant dans des conditions plus précaires encore que les populations maories. Les appartements ou
les maisons, loués, se partagent à plusieurs familles dans près de la moitié des cas et les conditions d’hygiène
laissent à désirer (voir doc. 7). Ces populations connaissent par ailleurs des problèmes de santé importants.
Ainsi, le taux d’hospitalisation des enfants de moins de un an est de 39 % supérieur à la moyenne nationale (28 % supérieur de 1 à 4 ans). Chez les adultes, le R.A.A. et les autres maladies cardiaques ou pulmonaires
sont beaucoup plus répandues que dans les autres ethnies. Enfin, il faut bien constater que le taux de
criminalité est plus important dans ces communautés que dans les autres couches de la population, y compris
par rapport aux Maoris (doc. 6).
Le phénomène migratoire vu à partir de l’archipel des Samoa prend une autre coloration.
L’archipel des Samoa a été peuplé par des Polynésiens il y a environ 3 000 ans. Découvert par Roggeveen en
1672, puis visité par Bougainville (1768) et La Pérouse (1787), il a été christianisé par les missionnaires de
la LMS. Convoité à la fois par les États-Unis, qui installent très tôt un port dans la rade de Pago Pago,
l’Allemagne et l’Angleterre, il est soumis à un contrôle de type condominium par ces trois pays de 1889 à
1899, avant d’être partagé entre l’Allemagne et les États-Unis, l’Angleterre ayant obtenu des compensations
ailleurs. Le Samoa occidental, composé principalement des deux îles de Savai’i et de Upolu, couvrant 2 935
km², revient à l’Allemagne (qui le perd dès 1914, date à laquelle le pays passe sous mandat néo-zélandais).
Les États-Unis récupèrent quant à eux ce qui devient les Samoa américaines, petite entité de 197 km² de
superficie (dont 145 pour la seule Tutuila). Si le Samoa occidental a été le premier pays tropical océanien à
obtenir son indépendance, dès 1962, les Samoa américaines relèvent du Ministère de l’Intérieur américain,
après avoir longtemps dépendu de la Navy (de 1900 à 1951). Aujourd’hui, le Samoa, ex-Samoa occidental,
compte 178 000 habitants, alors que les Samoa américaines n’en recensent que 62 000 (estimations de 2003).
Ce découpage colonial tout à fait artificiel n’a pas réussi à effacer les liens qui s’étaient tissés auparavant
entre les différentes parties de l’archipel.
Au niveau des mouvements migratoires, on peut distinguer une première phase d’exode rural qui entraîne les
populations vers les petites agglomérations du littoral, puis vers la capitale Apia, et une deuxième phase qui
amène les émigrants à quitter Samoa pour rejoindre soit la Nouvelle-Zélande, soit Pago-Pago, aux Samoa
américaines. L’émigration vers la Nouvelle-Zélande bénéficie d’accords privilégiés entre les deux pays,
accords qui peuvent être remis en cause à tout moment par le pays d’accueil et qui font l’objet de
renégociations constantes (doc. 9). Il faut bien considérer que pour le gouvernement de Samoa l’émigration
et les transferts financiers qu’elle engendre, même s’ils sont fragiles (doc. 8) contribue largement à équilibrer
une balance des paiements sinon largement déficitaire. C’est cette même logique qui conduit de nombreux
Samoans à regagner les Samoa américaines toutes proches (doc. 10), avec l’espoir supplémentaire de
pouvoir décrocher la nationalité américaine qui ouvre les portes des États-Unis (Hawaii, la Californie ou
l’Utah -pour des raisons religieuses).
Ces opérations ne tiennent nullement de l’anecdote. En effet, alors que l’on dénombre 178 000 habitants au
Samoa, on retrouve de 15 000 ressortissants de ce pays aux Samoa américaines, 102 000 en Nouvelle-
Zélande et 50 000 aux États-Unis, soit l’équivalent de la population du pays. Par ailleurs, les Samoa
américaines comptent 62 000 habitants, mais environ 50 000 Samoans américains vivent actuellement aux
États-Unis (dont 15 000 à Hawaii).
3- Les aides financières et les transferts
Doc. 1 : la « MIRAB Economy »
« Beaucoup de petites économies insulaires vivent en partie ou en totalité d’une rente, soit naturelle (exploitation d’une
ressource naturelle bénéficiant d’un prix élevé sur le marché mondial : phosphate, vente de droits de pêche), soit
monétaire : recettes induites par une base militaire, aide internationale ou bilatérale, notamment en provenance d’une
métropole ou d’une ancienne métropole avec laquelle subsistent des liens privilégiés. La plupart des économies
insulaires du Pacifique bénéficient d’un niveau élevé d’aide internationale par tête, ce qui leur permet dans bien des cas
d’entretenir un déficit chronique de leur balance commerciale. … Le montant de l’aide par habitant est d’autant plus
élevé que la population est faible et l’aide est en général plus forte pour les territoires que pour les États indépendants.
Le budget de fonctionnement [des îles de Polynésie centrale] est alimenté surtout par l’aide de la Nouvelle-Zélande et
de quelques autres pays donateurs, accordée sous forme de dons, et il sert principalement à employer une bureaucratie
qui fournit la plupart des emplois. Ainsi, l’administration distribue un pourcentage de la masse salariale totale qui va de 40 % aux Cook à 90 % à Tokelau en passant par 53 % à Tuvalu et 80 % à Niue (55 % en Polynésie française)… Les
emplois créés dans l’administration permettent le développement du secteur tertiaire non marchand.
De plus, ces pays reçoivent une bonne partie de leurs ressources des travailleurs émigrés : à Tokelau, aux îles Cook, à
Niue, les expatriés dépassent la population restée sur place…. Ces économies insulaires liées à la Nouvelle-Zélande
ressemblent désormais en quelque sorte à des « banlieues dortoirs » de l’économie dominante, peuplées de retraités et
de fonctionnaires. En effet, beaucoup d’émigrés reviennent prendre leur retraite dans leur île natale et les relations
familiales entre les émigrés et leur famille restée au pays peuven t subsister même sur plusieurs générations, entretenues
par de fréquents voyages. Les réseaux de familles étendues se maintiennent malgré la grande dispersion de leurs
membres, forman t une entreprise familiale multinationale. Le rôle essentiel joué par l’émigration et les envois de fonds
des expatriés à leurs familles dans l’économie insulaire, et le développement limité observé dans ces îles, amène à
constater que le secteur moderne de ces économies se trouve en fait situé à l’extérieur, ce qu i explique la faiblesse du
développement productif. La logique … de la spécialisation internationale du travail amène l’économie insulaire
périphérique à exporter directement ses travailleurs vers le secteur moderne situé dans l’économie métropolitaine (au
sens large du terme) pour obtenir les marchandises convoitées au lieu de chercher à les fabriquer sur place ou à exporter
des marchandises pour les échanger contre celles de l’économie métropolitaine…. Bertram pense que le système
MIRAB n’est pas une simple anomalie provisoire, une transition v ers un autre mo de d e développement, mais au
contraire qu’il s’est installé spontanément et pour longtemps et qu’il s’agit d’une stratégie durable et viable à long terme
de ces pays, dont l’économie repose sur une rente qu’ils peuvent raisonnablement espérer recevoir pendant longtemps…
… Le modèle MIRAB correspond tout à fait à ce que C. de Miras appelle l’économie de transferts et à ce que nous
appelons l’économie de rente. »
Doc. 2 : les actions de NZAID dans le monde
Doc. 3 : les aides australienne et néo-zélandaise en quelques chiffres
Aide aux PED (en millions de dollars US, chiffres de 2002)
Aide bilatérale néo-zélandaise aux pays de la Communauté du Pacifique
Aide bilatérale australienne aux pays de la Communauté du Pacifique
Aide bilatérale au Pacifique (en millions de dollars US)
*Pour Fidji, le gouvernement néo-zélandais maintient un boycott néo-zélandais contre le gouvernement illégal en place dans ce pays
depuis 2000.
Doc. 4 : l’aide par habitant à quelques pays océaniens
* en dollars US
Note : les chiffres de l’aide par habitant proviennent de la Banque mondiale (2003) ; ceux du commerce extérieur
d’Index mundi.
Commentaires
Tous les pays du Pacifique insulaire sont des pays assistés qui relèvent, peu ou prou, du système MIRAB
décrit par Bertram et Waters et qu’explicite B. Poirine dans le document 1. Il est par contre assez aléatoire de
se risquer à quantifier les aides reçues. En effet, celles-ci prennent des formes extrêmement variées : aide
bilatérale ou multilatérale, aide directe sous forme de subventions régulières (après signature de contrats) ou
exceptionnelles (après une calamité naturelle par exemple), allègement de la dette, facilités commerciales,
retours de salaires (remittances), prise en charge des salaires de fonctionnaires ou de personnel de santé,
construction d’infrastructures (routes, écoles, hôpitaux, stades…), etc. De fait, les chiffres les plus divers
circulent dans les documents statistiques. Ils ne recouvrent pas, d’un pays à l’autre, les mêmes réalités. Il faut
être conscient de ce problème et ne pas se focaliser sur la précision des données. Ainsi, les chiffres qui figurent dans le tableau du document 4 ne correspondent pas forcément, pour l’outre-mer français du
Pacifique en particulier, aux chiffres auxquels nous avons accès par ailleurs.
Cet avertissement étant formulé, force est de constater que les plus grands donneurs pour les micro-États
insulaires océaniens ne sont pas l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces deux pays ont pourtant mis en place
des agences gouvernementales, NZ AID (New Zealand Agency for International Development) et AusAID
(Australian Agency for International Development) chargées de donner assistance aux PED, en particulier à
ceux de la région Pacifique. Ces agences ont pour objectif déclaré de :
- lutter contre la pauvreté
- défendre les droits civiques (bonne gouvernance, défense de la démocratie, justice sociale)
– participer au maintien de la paix et de la sécurité
– développer des politiques de santé et d’éducation
– aider au développement économique
– promouvoir la protection de l’environnement.
Mais le budget de AusAID et de NZAID n’est pas à la hauteur des ambitions affichées par ces deux pays, qui
ont pourtant tendance à considérer la région comme leur chasse gardée. De fait, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande ont dû abandonner la lointaine Micronésie aux États-Unis et l’outre-mer français à la France. Quant
à la sphère qui leur reste, c’est-à-dire la Mélanésie et la Polynésie anglo-saxonnes, ils n’y apparaissent pas
comme particulièrement généreux puisque leurs budgets cumulés n’arrivent même pas à la hauteur du
montant de l’aide française pour la seule Polynésie française ou la seule Nouvelle-Calédonie. On doit en
effet prendre conscience que l’aide australienne, qui se concentre essentiellement sur la PNG, et dans une
moindre mesure sur les îles Salomon, est importante sur le papier mais dérisoire si on la rapporte au nombre
d’habitants de ces deux pays. L’aide néo-zélandaise quant à elle est encore plus légère (même si l’on tient
compte de l’écart de puissance avec l’Australie), d’autant qu’elle se disperse davantage (doc. 3).
Quoiqu’il en soit, le doc. 4 montre que ces aides australienne et néo-zélandaise viennent loin derrière celles
des États-Unis et de la France, qui hissent leurs satellites vers des niveaux de vie plus que décents, même
s’ils peuvent être jugés artificiels, alors que les pays sous influence australienne et néo-zélandaise demeurent
confinés dans une situation de sous ou de mal-développement.
4- Politiques économiques et échanges commerciaux
Doc. 1 : le commerce extérieur dans quelques pays de la région
Chiffres moyens sur la période 2000-2002, source Index mundi.
Doc. 2 : tableau de bord des échanges extérieurs fidjiens
Principales importations (en millions de dollars)
Principales exportations (en millions de dollars)
Balance commerciale (en millions de dollars)
Répartition par pays partenaires
Doc. 4 : tableau de bord des échanges extérieurs néo-zélandais
Répartition par type de marchandises / services
Répartition par pays partenaires
Source : banque mondiale
Commentaires
D’une manière générale, les pays insulaires du Pacifique affichent une balance commerciale très
déséquilibrée
– ils produisent peu (produits agricoles, poissons, textiles, produits miniers) et donc exportent peu,
malgré des accords commerciaux qui peuvent être très avantageux pour eux, comme le SPARTECA
(South Pacific Regional Trade and Economic Co-operation Agreement). Par cet accord commercial
signé en 1980, l’Australie et la Nouvelle-Zélande s’engagent à laisser rentrer chez eux sans taxe ni restriction
d’aucune sorte les produits exportés par les États insulaires membres du Forum du Pacifique (îles Cook, États
Fédérés de Micronésie, Fidji, Kiribati, îles Marshall, Nauru, Niue, PNG, îles Salomon, Tonga, Tuvalu,
Vanuatu et Samoa). La seule restriction concerne le sucre fidjien, non admis sans taxe sur le territoire
australien (l’Australie est productrice de sucre de canne) ;
– ils ont par contre des besoins croissants en produits finis, ce qui provoque un déséquilibre de leur
balance commerciale qu’ils ne comblent qu’en partie par les recettes touristiques, les niches de
services, les retours de salaires ou les aides multiples.
À l’opposé, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, bien qu’affichant une structure d’échanges qui semblerait les
rapprocher des pays en développement (exportations de produits agricoles et miniers et importations de
produits finis), présentent des balances commerciales et de paiement proches de l’équilibre.
On notera que les exportations des îles et archipels de l’Océanie intertropicale sont dirigées pour l’essentiel
vers l’Asie, puis vers les États-Unis ou l’Australie. Par contre, les importations proviennent majoritairement
d’Australie, de Nouvelle-Zélande ou de Singapour. Dans cette liste de partenaires, les pays européens sont absents. Ils n’occupent aujourd’hui qu’une position très secondaire, à l’exception de la France envers ses
possessions ultra-marines. La réorientation vers les pays asiatiques au détriment de l’Europe est patente, y
compris pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le cordon ombilical est bien rompu et l’on peut dire qu’à
l’interface intra-océanien vient se surajouter l’interface entre l’Océanie et l’Asie, qui a supplanté les relations
privilégiées que l’Océanie a longtemps entretenues avec l’Europe (le Royaume-Uni surtout).
L’étude comparée des échanges commerciaux de la Nouvelle-Zélande et des îles Fidji (doc. 2 et 3) permet
d’affiner l’étude. On se rend compte à quel point les échanges de la Nouvelle-Zélande avec les entités
insulaires du Pacifique sont déséquilibrés. La Nouvelle-Zélande n’importe quasiment rien de Fidji alors
qu’elle couvre près du cinquième des importations de ce pays. Quant aux îles Fidji, elles entretiennent des
relations de proximité avec Samoa et quelques autres micro-États de la région, fonctionnant ainsi comme un
centre secondaire ou un centre relais des puissances développées voisines. D’une manière générale, les
micro-États insulaires sont plus dépendants pour leurs échanges commerciaux de l’Australie et de la
Nouvelle-Zélande que ne le sont ces deux pays envers eux.
5- Le tourisme, voie de l’avenir ?
Note : ce thème sera approfondi ultérieurement et complété par d’autres
contributions
Doc. 1 : la fréquentation touristique en Océanie (n’ont été retenus que les pays recevant au moins
10 000 touristes par an)
Sources : SPTO, PRISM, Saipan Tribune
* 2 350 000 en 2004
Doc. 2 : les pays émetteurs vers les cinq grandes destinations touristiques de l’Océanie intertropicale
Chiffres de 2003, mêmes sources
Doc. 3 : l’évolution du tourisme dans les Mariannes du Nord
Tourist arrivals started its downward trend in FY 1998 as a result of the Asian economic crisis. In that year, arrivals
plunged to 526,298, a decline of 27.6 percent as compared with FY 1997. The numbers further sank in FY 1999, when the CNMI recorded 491,602 in total arrivals. A slight improvement was seen in FY 2000, with arrivals of 526,111.
Arrivals ha ve not surpassed the half-million mark since then. Terrorist atta cks in the United States in September 2001
broke the momentum of the visitor industry, causing arrivals to the CNMI to reach only 497,696.The negative impact of
9/11 became more evident in 2002, when arrivals totaled only 423,932. In 2003, the SARS ep idemic* and the outbreak
of the war in Iraq compounded the 9/11 events, further devastating the world tourism industry.
* SARS epidemic : Severe Acute Respiratory Syndrome
Docs 4, 5, 6...
À venir.
Commentaires
Voir étude spécifique sur le tourisme, à venir.
6- Les enjeux socioculturels
Doc. 1 : L’Europe débloque 450 000 Euros pour le Festival des Arts océaniens de Palau
Mars 2004 à Koror, en République de Palau
L’Union européenne, par le truchement de la délégation régionale de la Commission basée à Suva a annoncé mardi
l’octroi d’une subvention de quelque 450 000 Euros, destinés à "aider à l’organisation" du neuvième Festival des Arts
océaniens, qui devrait se dérouler à Palau le mois prochain (22 au 31 juillet) et ainsi regrouper les expressions
culturelles des 22 États et territoires du Pacifique.
Dans un communiqué conjoint, la Commission européenne, le Forum des îles du Pacifique (FIP) et le Secrétariat
Général de la Communauté du Pacifique (CPS), précisent que cette somme devrait en premier lieu être destinée
financer l’acquisition et la mise en place de matériel de sonorisation et d’éclairage, ainsi que prendre en charge certains
frais de restauration et d’hébergement sur place lors de la venue d’importantes délégations de toute l’Océanie.
En annonçant l’octroi de cette somme, Franz Baan, chef de la délégation régionale de la commission européenne, a tenu
à souligner le rôle de ce festival dans le processus d’intégration des territoires français du Pacifique dans leur
environnement régional. "La participation des territoires d’outre-mer français est un aspect qui fait partie intégrante de
ce festival ; cette participation renforce le sentiment de solid arité entre les Polynésiens francophones et anglophones,
mais aussi entre les Mélanésiens, les Polynésiens et les Micronésiens", a-t-il estimé, tout en rapp elant le "rôle-clé" que
ce festival tient d ans le processu s de "renaissance culturelle du Pacifique", en dépit de "l’isolement géographique" de
cette région.
Le Festival des Arts océaniens, événement qui se déroule tous les quatre ans sous l’égide du Conseil des Arts du
Pacifique (lui-même une émanation de la CPS), aura cette année pour thème "Nourrir, régénérer, célébrer", une sorte de
célébration des cultures ancestrales préservées et transmises par la tradition orale par les anciens. L’édition précédente,
en octobre 2000, avait eu lieu en Nouvelle-Calédonie, autour du thème "Paroles d’hier, paroles d’aujourd’hui, paroles de
demain".
Doc. 2 : le programme du Festival des Arts de Palau
Au cours des dix jours que durera le Festival, on pourra assister à des démonstrations et à des
interprétations dans les domaines suivants :
• Organisation de colloques, débats et
• Art contemporain, arts traditionnels :
ateliers notamment la protection
juridique des savoirs traditionnels,
les rôles des chefs traditionnels et
élus,
expression corporelle, tissage,
sculpture du bois, de l’os et de la
pierre, réalisation
de tapas, tatouages, confection de
bijoux et de colliers, art du coquillage
et poterie
• Architecture traditionnelle
• Médecine traditionnelle et curative
• Art culinaire traditionnel
• Photographie, cinématographie,
• Littérature
costumes et art floral
• Les ressources naturelles telles que
• Arts scéniques traditionnels et
la richesse, les changements sociaux
et l’éducation
contemporains : art oratoire et
contes, instruments de musique,
chant, danse, théâtre, art dramatique,
marche sur le feu, sports
traditionnels
• Construction de pirogues et
d’embarcations traditionnelles
Doc. 3 : les Jeux du Pacifique
(1) Îles Cook, États fédérés de Micronésie, Fidji, Guam, Kiribati, Mariannes du Nord, République des Îles Marshall, Nauru, Niue,
Norfolk, Nouvelle-Calédonie, Palau, Papouasie Nouvelle-Guinée, Polynésie française, Tuvalu, Iles Salomon, Samoa américaines,
Samoa, Tokelau, Tonga, Vanuatu, Wallis et Futuna.
Commentaires
Le Festival des Arts est né du souci de lutter contre la disparition progressive des pratiques coutumières et
traditionnelles (doc. 2). Patronné par le Conseil des Arts du Pacifique, qui est une émanation de la
Communauté du Pacifique, il est organisé tous les quatre ans depuis 1972 et permet aux Océaniens de se
réunir pour un moment de partage et d’échanges culturels. On retrouve là non seulement les petits pays
insulaires océaniens, mais aussi les Maoris de Nouvelle-Zélande et les Aborigènes d’Australie. Les
Hawaiiens, bien que n’étant pas membres de la Communauté du Pacifique, sont aussi régulièrement invités
en tant que Polynésiens. Le Festival est financé sur fonds de la Communauté du Pacifique, du Forum, ainsi
que sur des crédits débloqués par l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou l’Union européenne (voir doc. 1). Il s’agit d’un rendez-vous majeur qui contribue fortement au maintien d’une unité culturelle océanienne et au
rapprochement de ces peuples. C’est une occasion également pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande de
replonger dans les racines de leur peuplement originel.
Les Jeux du Pacifique sont devenus une institution dans la région. Ils ne concernent que les pays insulaires
océaniens, qui se rencontrent entre eux, mais l’Australie et la Nouvelle-Zélande ne sont pas absents pour
autant. Ils assurent une participation financière et fournissent des cadres techniques pour leur organisation.
Créés officiellement en 1961, à l’initiative des Fidjiens, ils avaient pour objectif « [d’] assurer la promotion
et le développement de la pratique du sport amateur, [et de] créer des liens d’amitié fraternels entre les
peuples et les différentes régions du Pacifique Sud ». La première édition a eu lieu à Suva en 1963. Depuis,
ils se sont déroulés tous les trois, puis quatre ans (doc. 3). Ils sont devenus une énorme entreprise, le nombre
de participants (et d’accompagnateurs) étant de plus en plus important. Si le Festival des Arts a rassemblé
environ 2 000 personnes dans sa dernière édition à Palau, les derniers Jeux du Pacifique qui se sont déroulés
à Suva en 2003 ont accueilli plus de 4 000 athlètes et officiels. Ils ont nécessité la construction d’installations
sportives de haut niveau et donc un engagement financier très important. Tous les pays insulaires océaniens y
étaient représentés. De tels jeux, désormais, ne peuvent être organisés que par les grandes entités de la zone.
Les pays plus petits peuvent se contenter des « mini-jeux », qui ont lieu dans l’intervalle et qui sont limités
en nombre de disciplines et donc de participants. On notera que d’autres rencontres sportives, les Océania,
spécifiques à chaque sport, sont organisées au niveau de la région, impliquant directement cette fois-ci
l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
7- Les organisations régionales
Doc. 1 : extrait de la page d’accueil du site Internet de la Communauté du Pacifique
Doc. 2 : page d’accueil du site Internet du Forum du Pacifique
Doc. 3 : quelques organisations régionales au sein du Pacifique
Commentaires
Les relations entre les micro-États océaniens sont insuffisamment développées. Ceci est la conséquence
directe de l’insularité : l’éloignement, l’isolement, l’omniprésence de la mer, l’exiguïté des territoires
auxquels il faut ajouter des ressources fragiles et non complémentaires rendent les échanges ou la
coopération difficiles. En fait, les îles et archipels de l’Océanie intertropicale sont plus tournées vers
l’extérieur (Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, France…) que vers elles-mêmes. Toutefois, de réels
efforts sont faits pour rapprocher ces pays. Les initiatives dans le domaine du sport et de la culture
(paragraphe précédent) vont dans ce sens. Elles sont le fait d’organisations régionales de mieux en mieux
structurées et donc de plus en plus efficaces.
La plupart de ces organisations se retrouvent dans le CORP, le Conseil des organisations régionales du
Pacifique, qui comprend le Secrétariat de la Communauté du Pacifique, le Secrétariat général du Forum, la
FFA, le PIDP, le PROE, la SOPAC, l’USP et quelques autres…
La CPS, ou Commission du Pacifique Sud, est la plus ancienne de ces institutions. Fondée en 1947, elle a
pris en 1998 le nom de Communauté du Pacifique. C’est la seule organisation qui comprend l’ensemble des
pays de la région (19 États et 8 territoires sous tutelle), indépendants ou non, francophones ou anglophones.
Son siège est à Nouméa. Il s’agit d’un organisme de coopération technique chargé de financer des
programmes de développement à partir de crédits provenant essentiellement de l’Australie, de la France, de
la Nouvelle-Zélande, des États-Unis, voire de l’Union européenne.
Le Forum des îles du Pacifique (ex Forum du Pacifique Sud) regroupe les chefs de gouvernement de tous
les pays indépendants ou en self gouvernement du Pacifique insulaire autour de l’Australie et de la Nouvelle-
Zélande. Créé en 1971, il est une véritable tribune dans laquelle chacun exprime ses vues sur l’évolution politique et les perspectives économiques de la région. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ont
pu y être invitées à titre d’observatrices. Les seize pays du Forum sont l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les
îles Cook, les États fédérés de Micronésie, Fidji, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, la PNG, les îles Marshall,
Samoa, les îles Salomon, Tonga, Tuvalu et le Vanuatu.
La Forum Fisheries Agency, ou Agence des pêches du Forum (FFA) a été créée en juillet 1979 dans le but
premier d’assurer la surveillance et la gestion des stocks de poissons dans les eaux territoriales des petits
pays du Pacifique. Le premier objectif poursuivi par la FFA, dont le siège est à Honiara (îles Salomon) est
d’aider les pays signataires à négocier leurs droits de pêche, puis de trouver les moyens pour faire respecter
les accords et assurer l’inviolabilité de leurs eaux territoriales. De fait, ce contrôle ne peut guère être assuré
qu’avec le concours des puissances extérieures (Australie ou Nouvelle-Zélande). Les récents progrès de la
télédétection permettent à présent de mieux surveiller la zone.
Le PIDP (Pacific Island Development Program ou Programme de développement des îles du Pacifique) est
une émanation de l’East-West Center, créé en 1960 par le Congrès étasunien dans le cadre de l’aide des
États-Unis aux pays d’Asie et du Pacifique. Le PIDP quant à lui a été créé en 1980. Il est officiellement
chargé de promouvoir la qualité de vie dans les îles du Pacifique en promouvant l’éducation et la recherche.
Il est essentiellement financé par les États-Unis.
Le PROE (Programme régional océanien de l’environnement), ou SPREP (South Pacific Regional
Environment Program) Le PROE est une émanation du Secrétariat de la Communauté du Pacifique. Il est
une organisation intergouvernementale chargée d’appuyer les efforts de protection et d’amélioration de
l’environnement du Pacifique insulaire et de favoriser son développement durable. Son siège est à Apia. Il
regroupe tous les pays de la CPS, ainsi que l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la France et les États-Unis.
La SPTO (South Pacific Tourism Organisation) est chargée de coordonner la promotion touristique pour les
pays du Pacifique.
La SOPAC (South Pacific Applied Geoscience Commission), est une organisation intergouvernementale
ayant pour objet l’aide au développement durable. Cette organisation, basée à Suva, est financée par
l’Australie, les îles Fidji, la France, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l’Irlande, l’Union européenne…
L’Université du Pacifique Sud (South Pacific University – SPU) est une création originale. Implantée en
1968 à Suva (Fidji), elle est l’émanation de douze États du Pacifique central qui, isolément et mis à part
Fidji, ne pouvaient prétendre à mettre en place une structure universitaire de ce calibre. Ces États contribuent
financièrement à son fonctionnement, fournissent des enseignants et y envoient leurs étudiants. L’Australie
et la Nouvelle-Zélande participent elles aussi à cette entreprise dans le cadre de leur aide technique par une
aide financière et l’envoi d’enseignants
En marge de ces différentes organisations, on peut encore citer l’APEC (Asia Pacific Economic
Cooperation), une alliance commerciale entre les grands pays d’Asie et d’Océanie et où l’on retrouve
l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la PNG.
++++
QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
Doc 1 : démographie et planification du développement à Niue
L’éducation est subventionnée par les pouvoirs publics et l’instruction est obligatoire de 5 à 16 ans. Plusieurs
étudiants font des études universitaires en Nouvelle-Zélande, aux îles Fidji, au Samoa ou en Australie. La
pénurie d’enseignants et la baisse du taux d’inscription dans les écoles posent problème, et des professeurs
ont été recrutés en Nouvelle-Zélande. … 51 % de la population active sont employés par les pouvoirs
publics.
Les programmes gouvernementaux en matière de population ont reçu l’appui de l’agence néo-zélandaise de
coopération (NZODA), de l’Agence australienne pour le développement international (AusAID), du Fonds
des Nations Unies pour la population (FNUAP), de l’UNICEF, du PNUD (Programme des Nations Unies
pour le Développement), de l’OMS et des fonds du gouvernement de Niue.
Aucun pays ne peut se permettre de mettre en valeur ses ressources humaines, puis de les perdre sous l’effet
des migrations dans une mesure aussi impressionnante qu’à Niue. Le problème qui se pose à Niue est que sa
population est trop modeste pour pouvoir appuyer une économie dynamique et diversifiée. L’île ne possède
que peu de ressources d’importance et il est peu probable que s’y développent des industries primaires ou
secondaires à cause de sa faible taille.
Brochure éditée par le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, 2002
Doc 2 : l’économie de Nauru
Après l’indépendance de 1968, le pays était voué à un brillant avenir économique. En effet, les énormes
gisements de phosphate exploités par les puissances coloniales étaient loin d’être épuisés. Ils ont assuré la
prospérité de l’île pendant 30 ans. C’est ainsi que le PIB du pays était près de trois fois supérieur à celui des
États-Unis.
Les dirigeants ne sachant pas trop où et comment investir l’argent ont décidé d’offrir aux Nauruans une
multitude d’avantages sociaux : pas de taxes, pas d’impôts, téléphone, électricité et logement financés par
l’État., études gratuites en Australie… La majorité des Nauruans ne travaillaient pas et l’on a fait venir de la
main d’œuvre des autres pays océaniens. Toutes ces dépenses ne suffisaient pas à éponger les bénéfices.
Aussi, le gouvernement a investi dans l’immobilier australien et néo-zélandais et s’est doté d’une flotte
aérienne de cinq Boeing 737 pour fonder Air Nauru. L’ensemble de cette flotte a pu être réquisitionné à
l’occasion pour permettre au président de partir en vacances avec sa suite.
Aujourd’hui, le paradis a disparu avec la fin de l’exploitation des phosphates. Les investissements
immobiliers se sont effondrés et l’île est victime de la folie des grandeurs de ses dirigeants. Le PIB ne vaut
plus que le quart de celui des États-Unis. Air Nauru s’est avéré être un véritable gouffre financier. Pour
essayer de remonter la pente, le pays se livre aujourd’hui au blanchiment d’argent. Pour seulement 25 000
dollars, on peut lancer une banque à Nauru. Ainsi, dans un bâtiment délabré on retrouve 400 sièges sociaux
de banques. On accepte aussi les réfugiés rejetés par l’Australie, que l’on interne sur place contre quelques
millions de dollars. Mais ces quelques mesures ne sont pas suffisantes pour maintenir l’économie en bonne
santé. Le gouvernement est lourdement endetté. L’eau et l’électricité sont rationnées. Le tiers de la fonction
publique a été remercié. L’unique appareil que possède encore Air Nauru est cloué au sol.
Nota : Nauru se livre aussi à la vente de faux passeports et monnaye son vote à l’ONU auprès de Taiwan.
Beaucoup de Nauruans sont retournés à la pêche.
Doc 3 : les pays océaniens à la recherché d’aides
Les îles du Pacifique :
Avec qui allons-nous dormir cette nuit ?
Une délégation chinoise a été accueillie par le Premier ministre samoan, Tuilaepa Sailele Malielegaoi, « Le
gouvernement et le peuple samoans souhaitent remercier la Chine pour son aide dans la construction des
installations sportives exceptionnelles réalisées pour les XIIIe Jeux du Pacifique qui se tiendront en août
2007 » a dit en substance le Premier ministre.
La Chine a envoyé également des techniciens et des entraîneurs pour ces Jeux. Mais le sport n’est pas le seul
domaine dans lequel la Chine accorde une assistance à ce pays de 180 000 habitants. Elle a construit
également plusieurs bâtiments gouvernementaux dans la capitale samoane, Apia.
La Chine apparaît comme un des grands acteurs en Polynésie, Mélanésie et Micronésie. Elle y offre son aide
financière et son assistance technique. Mais elle y met une condition : les pays aidés ne peuvent maintenir de
relations diplomatiques avec Taiwan. De son côté, Taiwan fait ce qu’il peut, dépensant annuellement des
dizaines de millions de dollars, pour acheter la reconnaissance des petits États du Pacifique contre la
cessation immédiate des relations des pays concernés avec la Chine.
Le choix des petits États du Pacifique n’est pas un choix idéologique. Il est uniquement motivé par des
intérêts financiers. La Chine et Taiwan pratiquent la « politique du chéquier ». À ce jour, Samoa, Tonga, les
îles Cook, Niue, Fidji, Vanuatu, les États fédérés de Micronésie et la Papouasie-Nouvelle Guinée, ainsi que
l’Australie et la Nouvelle-Zélande, sont avec la Chine, alors que Palau, les îles Marshall, Kiribati, les îles
Salomon, Nauru et Tuvalu sont avec Taiwan. Plusieurs nations jonglent avec ces alliances, allant vers le plus
offrant, comme le Kiribati qui est passé de la Chine à Taiwan.
Pour beaucoup de pays du Pacifique, l’aide étrangère est un business majeur et très lucratif, qui ne coûte pas
très cher à la puissance donatrice. Par exemple, 20 000 habitants
seulement habitent Palau, pays qui ne
produit quasiment rien. Or, le PNB par habitant de Palau est de l’ordre de 8 000 dollars par an,
essentiellement dû aux aides conjuguées des États-Unis, du Japon et de Taiwan. Bien qu’aucun document
officiel ne le prouve, il est raisonnable d’estimer que Taiwan participe pour la moitié à ce PNB par habitant
(4 000 dollars). Depuis 1999, Taiwan a donné environ 100 millions de dollars, se répartissant ainsi : 3
millions pour la construction d’un centre de conférences, 2 millions pour le Musée national, 15 millions pour
l’extension de l’aéroport, 20 millions pour la construction de la nouvelle capitale, Melekeck, 1 million pour
la rénovation des écoles…
Ces aides sont dangereuses. Elles provoquent la montée de la corruption au plus haut niveau (on achète les
dirigeants pour qu’ils changent de bord) et favorisent le maintien au pouvoir de systèmes féodaux, par
lesquels passe l’argent. Les récentes émeutes dans de nombreux pays de la région sont révélatrices de la
colère des populations conscientes de ne bénéficier que des bribes de cette aide qui ne fait que renforcer les
pouvoirs et la richesse de la minorité privilégiée qui gouverne.
Doc 4 : Samoa : les Jeux du Pacifique seront-ils une mine d’or ?
Les îles Samoa attendent beaucoup des retombées des Jeux du Pacifique…
Boutiques, restaurants, hôtels, agences de location de voitures et autres services se préparent à
accueillir ce que tout le monde considère comme la ruée vers l’or de la décennie. Plus de dix hôtels
ont été créés pour la circonstance ces six derniers mois, et ces hôtels affichent déjà complet, selon
l’Association samoane de l’hôtellerie...
Le plus grand pont d’Upolu (l’île principale où se trouve la capitale, Apia) a été élargi et refait à
neuf afin de supporter l’intensité du trafic prévue au moment des Jeux. Ce pont relie la ville au
grand complexe sportif Tuanaimato, où se dérouleront l’essentiel des compétitions.
La plupart des installations sportives sont prêtes, y compris le superbe centre nautique construit par
les Chinois, sûrement le plus beau centre de tout le Pacifique. À présent, Samoa n’attend plus que
les athlètes (près de 6 000) et l’argent qui arrivera avec. Il faut dire que Samoa a beaucoup investi
pour préparer ces Jeux, tant en ressources financières qu’humaines.
Mais est-ce que cette ruée vers l’or aura les prolongements attendus au-delà des 15 jours que vont
durer les compétitions ? Quand les athlètes retourneront chez eux, Samoa sera-t-il en mesure
seulement d’entretenir les installations créées pour les Jeux ? Quel sera le coefficient de remplissage
des hôtels créés pour la circonstance ?
Doc 5 : un regard sur les perspectives de développement pour 2005 - 2007
L’accueil des Jeux du Pacifique devrait relancer l’activité du bâtiment, avec entre autre la
construction du nouveau centre nautique, assurée par la République populaire de Chine. De même,
en 2005 commencera la construction des bâtiments de la National University of Samoa et de Samoa
Polytechnic, grâce à l’aide financière du Japon.
L’économie devrait être relancée par l’essor espéré du tourisme et l’accroissement des
« remittances ».
Le nombre de touristes s’accroît en moyenne de 3 % par an depuis 2001 (près de 100 000 touristes
en 2004). Mais un accroissement plus substantiel passe par un accord de joint venture entre la
compagnie samoane Polynesian Airline, qui connaît de gros problèmes financiers, et la compagnie
australienne Virgin Blue. Il passe aussi par l’accroissement de la capacité hôtelière induite par la
tenue des Jeux du Pacifique à Apia en août 2007 (entre autre, un hôtel de 140 chambres à Faleolo).
Quant aux transferts d’argent provenant de la communauté samoane expatriée (« remittances »), on
espère les voir s’accroître dans les années à venir. Ils représentent aujourd’hui 20 % du PNB du
pays, ce qui est considérable.
Les autres secteurs d’activité sont en crise. On espère re-ouvrir une petite entreprise de sous-
traitance de matériel automobile et une usine de traitement de noix de coco. On souhaite relancer les
activités d’une usine de jus de fruits, ainsi que la production de kava (à la suite d’un rapport
insistant sur ses vertus thérapeutiques), et enfin développer la pêche… Mais toutes ces activités
n’ont qu’un faible impact sur l’économie du pays.
Doc 6 : l’économie de Samoa
PNB / hab : 1 600 dollars US (2005, Banque mondiale)
Croissance annuelle : 3.4% (décembre 2006)
Inflation : 5.3% (février 2007)
Principales activités économiques : tourisme, pêche
Principaux partenaires commerciaux : Samoa américain es, Fidji, Japon, US, NZ, Australie
L’économie samoane est traditionnellement dépendante de l’aide internationale (pour 10 %) et des
remittances (pour 25 %). Les activités économiques propres au pays comptent pour 65 % du PNB.
Au premier rang de ces activités viennent l’agriculture et la pêche, qui fournissent 10 % du PNB mais
occupent les deux tiers de la main d’œuvre. L’industrie est dominée par une entreprise japonaise de sous-
traitance de matériel électrique pour une usine automobile installée en Australie. Au total, l’industrie compte
pour 16 % du PNB. Les services, et en particulier le tourisme, ont connu un fort développement ces dernières
années et assurent le complément du PNB.
Les îles Samoa affichent une balance commerciale très nettement déficitaire, compensée par les ressources
touristiques, les aides et les remittances. La croissance assez forte enregistrée en 2006 devrait se prolonger
en 2007. Elle est due aux chantiers qui ont été ouverts pour accueillir les XIIIe Jeux du Pacifique
(installations sportives de haut niveau, hôtels, bâtiments administratifs, infrastructure routière…).
Mais l’économie du pays demeure fragile. Elle est très sensible entre autre aux phénomènes climatiques. Lez
passage du cyclone Herta, en 2004, l’a profondément affectée et détruisant de nombreux bâtiments et
l’essentiel de la production agricole.
Doc 7 : la France et la région Pacifique
La France cherche à développer avec le Forum des Iles du Pacifique un partenariat privilégié lui permettant
de mettre en place un dialogue politique étroit et constructif avec le Forum, organisation politique régionale
du Pacifique. Sa contribution, à titre bilatéral et par le biais de son financement au Fonds Européen de
Développement, s’élève à plus de 27 millions d’€ par an.
La France est présente et active dans la région par ses collectivités
L’adoption de nouveaux statuts pour nos collectivités d’Outre-mer leur accordant une réelle autonomie dans
le cadre de la République, a montré aux États de la région notre volonté d’ouverture et nos efforts pour
mieux insérer nos collectivités dans la région et mener une politique régionale active : convention de
coopération Nouvelle-Calédonie/ Etat - Vanuatu ; intensification des liens entre la Nouvelle-Calédonie,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande, entre la Polynésie française et la Nouvelle-Zélande…
En complément, les moyens de l’Etat dans les collectivités oeuvrent au bénéfice de l’ensemble de la région.
Les forces armées françaises interviennent dans le cadre de l’accord FRANZ, de la surveillance des ZEE et
la lutte contre la pêche illicite, et à la formation des forces de sécurité des États Insulaires.
La France, État membre de l’UE, défend une stratégie globale de partenariat entre l’Europe et la
région :
Fortement impliquée dans le financement du FED, la France a pris l’initiative d’un dialogue avec la
Commission européenne sur la région Pacifique pour la coopération régionale et également par ses
Collectivités du Pacifique, d’autant que se profile l’échéance importante de la mise en place du 10ème FED
pour la période 2008-2013, dont les orientations et objectifs sont en train d’être décidés : réalisation des objectifs de développement du millénaire, énergie, préservation et exploitation durable des ressources
naturelles.
Les axes prioritaires de la coopération
Le montant annuel de l’aide bilatérale accordée par la France est d’environ 15 millions d’€. S’y ajoute la
quote-part de la France au Fonds européen de Développement pour le 9ème FED, soit 12,8 millions d’€ par
an. La France sera le deuxième contributeur du 10ème FED (2008-2013) après l’Allemagne. Les axes
prioritaires de la coopération, rappelés par le Président de la République, sont : le développement durable,
l’éducation, la formation des cadres, la santé, la bonne gouvernance et la sécurité. Ils complètent les objectifs
du Plan Pacifique.
La coopération vise à mettre en place des projets co-financés, destinés en particulier à assurer la formation de
cadres locaux. La coopération s’appuie sur les infrastructures en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française - universités, centres de recherches - au bénéfice de l’ensemble de la région. Les actions portent
notamment sur les domaines suivants :
Bonne gouvernance ;
Développement durable (action environnementale dans le cadre du PROE, actions dans le domaine
de la pêche avec la CPS, coopération agricole et rurale) ;
Santé et éducation ;
Audiovisuel (aide à la radiodiffusion en collaboration avec RFI, RFO, France Inter, CFI) ;
Infrastructures (modernisation d’aéroports secondaires et réhabilitation d’hôpitaux…) ;
Assistance à la lutte contre les catastrophes naturelles.
ACTUALISATION DES TABLEAUX STATISTIQUES
Document 1 : tableau de bord
(1) Évaluation 2006, en dollars US PPP (purchasing power parity). Données lissées en fonction des sources. Lorsque
les écarts sont trop importants, voir ci-dessous.
* 19 000 (NC), 700 (PNG), 1 200 (Kiribati), selon certaines sources.
Document 2 : données démographiques
(Année de référence : 2007 - estimations. Certains chiffres moins récents ont été extrapolés)
* 52 (Vanuatu), 60 (Marshall), selon d’autres sources ;
Documents joints
Une interface Nord/Sud : l’Océanie
PDF - 94 kio
Le dossier documentaire
PDF - 368.2 kio
Documents complémentaires
PDF - 51.3 kio
[1] Une fois pour toutes il convient de réaffirmer que l’Océanie, par définition, n’est pas un continent mais une partie du monde. Par contre, si continent il y a, on peut légitimement parler du continent
australien. Celui-ci a pour particularité d’être le moins vaste de tous les continents et de relever tout entier d’une même entité politique.
[2] PNG : Papouasie Nouvelle-Guinée
[3] ANTHEAUME B. - BONNEMAISON J. - Atlas des îles et Etats du Pacifique-Sud - GIP Reclus - Publisud - 1988 - 126 p.
Dans la même rubrique
Les cartes de la Nouvelle-Calédonie sur Gallica
Une storymap pour découvrir le site internet Gallica qui héberge de nombreuses ressources numérisées sur la Nouvelle-Calédonie.
Espace rural et espaces productifs agricoles en Nouvelle-Calédonie
Des ressources scientifiques et des aides à la mise en oeuvre de questions au programme du collège et du lycée.
La filière du nickel en Nouvelle-Calédonie
Des ressources scientifiques et des aides à la mise en oeuvre de questions au programme du collège et du lycée.