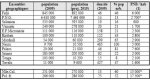L’Océanie depuis 1945
Contemporaine Oceanie_Pacifique Terminale
Mis à jour le lundi 17 mars 2025 , par
QUELLE EST LA SITUATION DE L’OCÉANIE INSULAIRE EN 1945 ?
Ce que nous disent les textes
Problématiques :
Quelles est la situation politique de l’Océanie insulaire en 1945 ?
Quels sont ses liens de dépendance avec les métropoles ?
Quelle est la situation économique et sociale de l’Océanie insulaire
en 1945 ? Peut-on parler de pillage des richesses ?
Quel a été le rôle de la Seconde Guerre mondiale dans la prise de
conscience des peuples océaniens colonisés
Quel est le contexte international après 1945 ? En quoi a-t-il pu
modifier la donne en matière de décolonisation ?
Notions et concepts, mots-clés :
Protectorat, territoire sous mandat,
condominium,
Conférence de Berlin,
les Mau, l’Union
française, le
Commonwealth
1. L’Océanie insulaire est un monde colonisé
La colonisation de l’Océanie s’étale dans le temps, de 1767 pour l’Australie et 1840 pour la Nouvelle-
Zélande aux décennies des années 1880 et 1890 pour l’essentiel des îles et archipels intertropicaux.
Quelques dates :
– Nouvelle-Zélande : 1840 (traité de Waitangi)
– Tahiti (protectorat : 1842, colonisation : 1880)
– Marquises : 1842
– Nouvelle-Calédonie : 1853
– Fidji : 1874
– Wallis et Futuna : protectorat en 1887-88
– Nouvelle-Guinée partagée entre les Anglais et les Allemands : 1884-89
– Cook, îles Sous-le-Vent : 1888
– îles de la Ligne : 1889
– condominium entre l’Angleterre, l’Allemagne et les États-Unis sur les îles Samoa : 1889-1899
– Gilbert et Ellice : 1892
– Salomon : 1893 – 1898
– partage des Samoa : 1899
– Tonga (protectorat) et Hawaii : 1900
– condominium franco-anglais aux Nouvelles-Hébrides : 1906
Jusque dans les années 1870 : une colonisation hésitante
Jusqu’au début des années 1880, et si l’on excepte l’Australie et la Nouvelle-Zélande, la colonisation,
n’a pas toujours été désirée par le colonisateur lui-même. En effet, on juge ces îles trop éloignées, trop
exiguës, sans grandes ressources et finalement sans grand intérêt. Les prises de possession sont alors
ponctuelles et sont imposées par les circonstances plutôt que par une volonté politique. On veut bien
entretenir des dépôts de charbon dans certains ports, voire des consulats, mais on ne souhaite pas aller
plus loin.
Les interventions des métropoles ont souvent été motivées par les graves problèmes rencontrés par
leurs ressortissants installés sur place. Ceux-ci sont des missionnaires, des marins, des commerçants…
Des missionnaires sont massacrés et la vie dans les ports devient dangereuse car échappant à toutes les
lois… La nécessité d’un contrôle accru des individus (des Blancs en priorité) ou de pacification de
certains lieux (protection des missions) a pu alors amener la France, l’Angleterre et quelques autres à
intervenir, après bien des hésitations. Parfois, ce sont les militaires qui prennent la main, sans
forcément avoir recueilli l’aval de leur gouvernement, comme Dupetit-Thouars à Tahiti qui met la
France devant le fait accompli du Protectorat. En d’autres lieux, ce sont les chefferies locales qui
demandent à être « protégées », en prenant le parti d’une puissance extérieure contre une autre. C’est
ainsi que la monarchie fidjienne fait appel à l’Angleterre (qui ne veut pas, dans un premier temps)
pour être protégée, contre les États-Unis. À Tahiti, Pomare IV demandera en vain à l’Angleterre la
protection contre l’installation des Français. De son côté, la France refuse la demande de protection de
la reine de l’île de Pâques.
De 1884 à 1900 : le marché colonial a bien eu lieu. C’est la curée
La conférence de Berlin (1884-1885) marque comme on le sait le début du partage colonial. Le
Pacifique n’échappe pas à cette dynamique. Les puissances européennes, les États-Unis et le Japon s’y
lancent dans des conquêtes tous azimuts. Les Allemands ciblent plutôt la Micronésie qu’ils disputent
aux Japonais. Les Anglais s’installent en Mélanésie et en Polynésie centrale. Les Français et les
Américains se livrent à une colonisation plus ponctuelle. Quoi qu’il en soit, toutes ces puissances
entrent bientôt en concurrence et se voient contraintes de s’entendre pour satisfaire leurs appétits de
conquête sans risquer le conflit ouvert. Le grand marché colonial a bien eu lieu, en Océanie aussi.
C’est ainsi que
- la Nouvelle-Guinée orientale est partagée entre l’Angleterre et l’Allemagne ;
- aux îles Samoa, une convention tripartite signée en 1899 donne Tutuila aux États-Unis et
Savai et Upolu à l’Allemagne. En compensation l’Allemagne abandonne à l’Angleterre ses prétentions
sur Tonga et sur la partie nord des îles Salomon (sauf Bougainville) ; - la France doit accepter de partager les Nouvelles-Hébrides sous la forme d’un condominium
franco-anglais en échange de la conquête des îles Sous-le-Vent…
La situation en 1945
En 1945, les acteurs ont changé en partie :
- l’Allemagne et le Japon, qui lui a succédé sur ses territoires confisqués après la Première
Guerre mondiale, ont disparu du paysage océanien ;
-* l’Angleterre est présente aux îles Gilbert et Ellice ou à Fidji, mais elle s’est effacée en grande
partie au profit de ses satellites, l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, qui ont reçu de la SDN, puis des
Nations unies, la tutelle de certaines colonies comme Samoa ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée ; - la France est présente en Nouvelle-Calédonie, dans les ÉFO et à Wallis-et-Futuna, ainsi
qu’aux Nouvelles-Hébrides, en condominium avec l’Angleterre ; - les États-Unis sont présents en Micronésie (récupérée sur les Japonais) et aux Samoa
américaines.
2. L’Océanie insulaire en 1945 : un monde exploité ou abandonné ?
L’Océanie insulaire en 1945 est donc partagée entre les empires coloniaux anglais, étatsunien et
français. Chaque métropole essaie de tirer le maximum de profit de ses colonies océaniennes. Deux
domaines au moins sont privilégiés : les plantations et les mines.
Les plantations
(lire à ce sujet le numéro spécial du JSO n° 82-83 (1986) : Les plantations dans le Pacifique Sud)
Les plantations sont surtout présentes en Mélanésie où les îles, vastes et collinéennes, sont plus
favorables à ce type de mise en valeur mangeur de terres. Encore estime-t-on que cet espace n’est pas
suffisant par rapport aux possibilités offertes par les continents africain ou asiatique. On se heurte par
ailleurs aux problèmes fonciers et à la difficulté de recruter des travailleurs océaniens, ce qui a amené
les Anglais à faire venir de la main d’œuvre indienne sur Fidji ou les Français de la main d’œuvre
vietnamienne aux Nouvelles-Hébrides ou en Nouvelle-Calédonie, ainsi que de la main d’œuvre
chinoise sur Tahiti. Par ailleurs, il s’avère que ces plantations européennes, dont la plupart sont peu
étendues, ne sont pas spécialement rentables et beaucoup font faillite. De fait, il se développe parallèlement de très nombreuses plantations autochtones qui résistent mieux aux crises. Leur impact
économique, en 1945, est souvent plus important que les plantations européennes. On les trouve
surtout dans les cocoteraies et la production de coprah, qui touche l’ensemble des archipels océaniens.
Ainsi, les Néo-Zélandais ont créé à Samoa le New Zealand Reparations Estates, société agricole et
commerciale publique, qu’ils transfèrent en 1953 au peuple samoan. La société gérait des plantations
de cocotiers et de cacaoyers. Aux Nouvelles-Hébrides, l’État français s’est constitué un domaine
foncier très vaste, géré entre deux-guerres par la Société française des Nouvelles-Hébrides, mais qu’il
a revendu en partie à des intérêts privés (colons ou sociétés comme la banque Indosuez). Après 1945,
les plantations européennes sont peu importantes, mises à part les Plantations Réunies des Nouvelles-
Hébrides qui produisent du coton sur de vastes espaces. Des plantations de cacaoyers se sont aussi
multipliées, en particulier sur Efaté (Vaté) et Espiritu Santo (Santo). Aux plantations il faut ajouter de
grands domaines d’élevage, devenus plus rentables. À Fidji, la production sucrière est aux mains
d’une compagnie australienne, la Colonial Sugar Refining Company qui a redistribué sous forme de
contrats de fermage la quasi-totalité de son domaine à de petits planteurs privés, le plus souvent
Indiens. Par contre, elle garde toute la structure industrielle de raffinage et les structures de transport et
d’exportation, ainsi qu’un grand domaine d’élevage. En Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Salomon,
on relève beaucoup de plantations autochtones (cacao, café, palmier à huile) aux côtés des grandes
sociétés australiennes, présentes elles aussi.
Structure des plantations au Vanuatu
L’archipel comptait en 1929, 797 Français et 205 Britanniques, 69 propriétés françaises et 16 britanniques, plusieurs de
celles-ci étant d’ailleurs gérés directement par la maison Burns Philps. En 1934, la tendance était à la baisse : 763 Français et
190 Britanniques… En 1960, la colonisation française se composait de 90 propriétés, les plantations anglaises étant tombées
au nombre de 10. Sur les 90, 62 employaient de 1 à 25 salariés, 27 de 26 à 100 et une seule (les Plantations Réunies des
Nouvelles-Hébrides) plus de 100…
On estimait déjà en 1939 que près du tiers du coprah de l’archipel provenait des plantations mélanésiennes. En 1952, la
production, qui atteignait 27 000 tonnes, était pour plus de la moitié aux mains des Mélanésiens…
Les ressources minières
Les ressources minières sont exploitées dans tout le Pacifique.
Les atolls polynésiens et micronésiens offrent trois sites riches en phosphates : Makatea, Ocean
(Banaba) et surtout Nauru. La Compagnie française des Phosphates de l’Océanie (CFPO) exploite le
gisement de Makatea, la Commission britannique des Phosphates (à capitaux anglais, australiens et
néo-zélandais) exploite ceux de Ocean et de Nauru. Si on juge que Makatea et Ocean ont des
ressources limitées à l’horizon des années 1960 – 1970, Nauru est mieux dotée et l’on sait en 1945 que
l’on a des réserves pour plus de 50 ans, à un rythme d’exploitation de plus de un million de tonnes par
an (contre 300 000 à 500 000 tonnes par an pour les deux autres sites).
La Mélanésie là aussi dispose de meilleurs atouts : nickel en Nouvelle-Calédonie, or à Fidji, immenses
gisements d’or et de cuivre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, malheureusement situés dans des endroits
difficiles d’accès ou politiquement instables, et non encore exploités en 1945 . Ces gisements sont aux
mains de sociétés australiennes (Emperor Mining Company pour l’or de Fidji) ou de la société
française Le Nickel pour la Nouvelle-Calédonie. On découvrira un important gisement de manganèse
(exploité par la CFPO) à Forari (île de Vaté) aux Nouvelles-Hébrides en 1959.
Si la Nouvelle-Calédonie représente un cas à part, puisqu’étant exploitée par des intérêts coloniaux
calédoniens et non métropolitains, il n’en est pas de même des autres gisements. La CFPO à Makatea
jusqu’en 1945 a pillé littéralement le minerai, sans que les ÉFO n’en recueillent un quelconque
bénéfice. La main d’œuvre était importée dans sa quasi-totalité et rien ne transitait par Papeete. La
situation évoluera plus favorablement après 1945, avec une meilleure prise en compte de la réalité
locale, au niveau des emplois, de la formation et des retombées financières. Sur Ocean, ce fut bien
pire, dans la mesure où l’on a déplacé de force les populations autochtones, les Banabans, sur l’île de Rabi (archipel des Fidji), en leur accordant une indemnité dérisoire, de manière à piller l’île dans son
intégralité, sans contraintes.
Nauru, Ocean…
En définitive, l’extraction de Nauru et de Ocean a été organisée jusque vers 1960 dans une optique essentiellement favorable
à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande. On n’a pas voulu, ou su, saisir les possibilités offertes par l’exploitation minière pour
organiser au sein de la société micronésienne un pôle de développement économique. Le bilan de plus d’un demi-siècle
d’industrie minière est fort décevant puisque le sort de quelques milliers d’autochtones n’a même pas pu être amélioré de
façon durable. Les profits accumulés depuis l’origine auraient pu servir à une promotion sociale… L’avenir de la Micronésie
aurait pu être totalement transformé alors qu’on n’a recherché que la solution facile, mais combien inhumaine, de la
transplantation des populations restées attachées à leur île tout autant que les autres Micronésiens, Mélanésiens ou
Polynésiens.
L’Océanie insulaire est aussi un espace marginalisé, abandonné
L’exploitation coloniale ne touche que certaines îles, ou certains littoraux. Et encore, le colonisateur
n’y trouve pas un intérêt majeur, du fait d’un espace somme toute restreint et de populations que l’on a
du mal à mettre au travail plus ou moins forcé. Beaucoup d’atolls polynésiens ou micronésiens sont
délaissés. Plus encore, l’intérieur de nombreuses grandes îles mélanésiennes n’a jamais été colonisé.
On y retrouve des populations qui peuvent être importantes et qui se trouvent complètement en marge
de la civilisation occidentale et des effets de la colonisation. Ce monde à part a traversé le siècle à son
rythme propre, en-dehors de toutes les problématiques du temps. Pas plus que par la colonisation, il ne
sera concerné par la décolonisation, dont il ne percevra pas forcément les effets, positifs ou négatifs.
3. Touchée par la guerre, l’Océanie insulaire commence à s’interroger sur son avenir
Les mouvements de revendication indépendantistes ont été très peu nombreux et peu influents avant
guerre. Le plus virulent fut le Mau de Samoa, un mouvement non-violent qui s’est longuement opposé
à l’occupation néo-zélandaise. Ailleurs, il s’est le plus souvent agi de sautes d’humeur, vite réprimées
par le colonisateur et souvent sans lendemain, faute de leader charismatique.
La Seconde Guerre mondiale, qui a touché de plein fouet l’Océanie, a contribué à la déstabilisation des
sociétés traditionnelles directement concernées et provoqué une amorce de remise en cause du fait
colonial. On est loin toutefois des grands mouvements de contestation qui sont nés au même moment
en Asie ou en Afrique. Cette prise de conscience prend ses sources pour trois raisons :
- la Micronésie et une partie de la Mélanésie ont été occupées par les troupes japonaises, qui ont
montré leur supériorité militaire sur le colonisateur anglais ou ses séides australiens et néo-zélandais.
Cela laissera des traces dans les esprits. D’autant que le sauveur s’affiche clairement : les États-Unis
qui ont assuré la reconquête ;
- les troupes américaines ont littéralement envahi le Pacifique. Elles ont installé leur quartier général à
Nouméa et se sont ménagées des bases arrière aux Nouvelles-Hébrides (Vaté, Santo), à Wallis, à Fidji,
à Samoa (Upolu), aux ÉFO (Bora Bora)… Partout, les Américains sont arrivés avec leurs dollars, leurs
habitudes vestimentaires et culinaires, leur mode de pensée, leur comportement décontracté, voire
amical avec les populations océaniennes. On a vu des GI’s noirs avoir apparemment les mêmes droits
que les Blancs ;
- beaucoup de jeunes adultes se sont engagés dans les forces alliées et ont combattu auprès des
Anglais, des Français, des Américains. Ils ont conscience d’avoir participé à la victoire contre
l’Allemagne et le Japon. Leur équipée, en Europe en particulier, leur a ouvert les yeux sur d’autres
réalités. À leur retour, ils ne sont plus prêts à accepter le fait colonial et vont demander des réformes,
voire nourrir les rangs des mouvements indépendantistes, cependant peu développés dans le Pacifique,
au contraire de l’Asie ou de l’Afrique. Dans les ÉFO par exemple, ils fondent l’Union des Volontaires,
qui se rapproche vite de Pouvanaa a Oopa.
La Seconde Guerre mondiale et les origines du Règne Maasina
Jonathan Fifi’i est né en 1921. Quand la guerre éclata, en, 1942, il fut recruté en tant que sergent… Une fois la guerre
terminée, il devint le chef du Règne Maasina pour la région de Kwaio. Il fut arrêté en 1947, et en 1948, fut condamné ainsi
que huit autres leaders de ce mouvement, à six ans de prison.
Ils furent tous relâchés en 1950, après quoi Fifi’i aida à la mise en place du Conseil de Malaita pour lequel il travailla. En
1952, il participa à la mise en place d’une école et travailla pour le Conseil du gouvernement ainsi que pour le Conseil
législatif des îles Salomon. .. Il représenta l’est de Kwaio au Parlement national jusqu’en 1980.
Pour Fifi’i, la route de l’indépendance pour les Salomon commença dans les années 1940 avec le mouvement du Régne
Maasina.
Ce mouvement apparut en 1944-1945 sur l’île de Malaita. Ceux qui étaient impliqués dans ce mouvement
refusaient de payer leurs impôts ou de travailler dans les plantations européennes... Les objectifs du mouvement incluaient
l’augmentation des salaires, l’amélioration des conditions de travail, une meilleure utilisation des impôts payés par les
autochtones et la possibilité d’avoir leur mot à dire auprès du gouvernement… Une hiérarchie de chefs fut mise en place pour
superviser les projets d’intérêt public s tel que le jardinage, la récolte des impôts pour le mouvement, la codification des
règles de la coutume dans la nouvelle société… Le gouvernement riposta en arrêtant les leaders du mouvement ainsi que
plusieurs milliers de sympathisants…
Des analyses récentes montrent qu’une longue période d’insatisfaction liée à l’ensemble de la politique coloniale et
remontant à l’avant-guerre est en fait à l’origine du Règne Maasina… Il est clair que l’expérience de la guerre eut un effet
catalyseur sur l’action anti-coloniale, mais la guerre n’a pas été le point de départ des ressentiments des Salomonais.
Comme Fifi’i l’explique, les événements de Guadalcanal eurent des répercussions profondes sur la conscience politique des
Salomonais… Selon les officiers britanniques de Guadalcanal, les soldats américains se comportaient avec les Salomonais
comme ils l’entendaient. Ils développèrent des relations amicales et décontractées avec eux. Ils leur offrirent des salaires
relativement élevés et des choses apparemment extravagantes.
Ce qui fut le plus mal perçu, c’est que les Américains
critiquaient les autres Blancs de façon ouverte. La plupart des soldats américains avaient peu de respect pour les coloniaux
britanniques… Les Salomonais découvrirent à travers ces attitudes un nouveau monde plein de possibilités passionnantes. Ils
étaient déjà insatisfaits de leur situation avant-guerre, alors comment auraient-ils pu s’en accommoder après ces évènements ?
De nombreux Salomonais ne remarquèrent pas la ségrégation raciale pratiquée par les Américains, ni le racisme qui était sans
aucun doute présent parmi les troupes américaines en 1942…
4- Au lendemain du conflit, le contexte international a changé, et les colonisateurs aussi
La Seconde Guerre mondiale a sonné le glas de la colonisation traditionnelle qui a vu son apogée dans
l’entre-deux-guerres. Plus rien ne peut être comme avant. Les empires coloniaux ont beaucoup souffert
et la France et l’Angleterre ont une dette vis-à-vis de leur colonie, dans le Pacifique comme ailleurs.
Très tôt, la France de la Ive République a fait évoluer les colonies de son empire vers des territoires
d’outre-mer au sein de ce qu’elle a appelé l’Union française. Les termes colonie et empire colonial
disparaissent. Ce n’est pas neutre, même si cela ne résout pas tout, loin de là. Les ex-colonies du
Pacifique accèdent donc à la citoyenneté, immédiate pour la minorité de Polynésiens qui ne l’avait pas
déjà, progressive pour les populations mélanésiennes de Nouvelle-Calédonie. Ces territoires envoient
désormais des représentants aux différentes assemblées métropolitaines. Mais on reste dans l’idée du
maintien de l’Union française au sein de la République.
Du côté anglais, le problème se pose en d’autres termes. Il apparaît que l’on ne conservera pas les
colonies bien longtemps. Mais on dispose d’une structure intermédiaire dans laquelle ces colonies
pourront se glisser le moment venu : le Commonwealth. L’émancipation progressive des possessions
anglaises du Pacifique est une idée qui suit son chemin et qui a même été développée avant-guerre, si
l’on en juge par la facilité avec laquelle l’Angleterre a confié les mandats de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée ou de Samoa à ses relais océaniens, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, dès 1919.
Le même cas de figure se produit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale lorsque l’ONU place
sous mandat allié Nauru, Samoa et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ainsi qu’une grande partie de la
Micronésie (récupérée par les États-Unis).
C’est l’occasion également pour la communauté internationale, par le biais de l’ONU ou du monde
communiste, de rappeler la nécessaire émancipation des peuples colonisés, à commencer bien sûr par
les territoires sous mandat.
Conclusion
Après 1945, l’histoire est en marche. Le problème de l’émancipation de l’Océanie insulaire est posé.
Mais ne se pose-t-il pas plus pour les colonisateurs que pour les colonisés ?
++++
COMMENT S’EST EFFECTUÉE L’ÉMANCIPATION DES PEUPLES COLONISÉS DE L’OCÉANIE INSULAIRE ?
Ce que nous disent les textes
- ES/L/S : on analyse l’émancipation des peuples dominés (approche générale + contextualisation) et l’on montre
comment le processus de décolonisation du Pacifique s’insère dans le processus global. - ST2S : on montre pourquoi et comment certains États d’Océanie intertropicale ont accédé à l’indépendance (B - étude
de cas)
Problématiques :
Quels sont les principales caractéristiques de l’émancipation des colonies
océaniennes ?
L’émancipation coloniale s’est-elle déroulée différemment en Océanie par rapport à
l’Afrique ou à l’Asie ?
Les modalités de l’émancipation on t-elle été les mêmes dans toutes les colonies
océaniennes ? Peut-on établir une typologie de ces émancipations ?
Notions et concepts, mots-clés :
Autonomie, indépendance
association, territoire sous
mandat, conseil de tutelle,
statut de Westminster,
troisième vague de
décolonisation, Walter Lini
L’émancipation des peuples colonisés de l’Océanie insulaire s’inscrit dans le mouvement plus vaste de
décolonisation qui a touché le monde après la Seconde Guerre mondiale. On a pris l’habitude de parler d’une
première vague asiatique et d’une deuxième vague africaine, avant d’évoquer les émancipations tardives
(Mozambique par exemple), en oubliant consciencieusement les îles océaniennes. On pourrait sans doute
parler d’une troisième vague de décolonisation, ou d’émancipation, qui concernerait plus particulièrement
l’Océanie, si l’on s’en remet au découpage en parties du monde.
Mais cette décolonisation a ses caractères propres et il peut être intéressant d’analyser en quoi elle se
démarque du mouvement général, avant d’en dresser une typologie et d’analyser dans le détail quelques cas.
I- Quels sont les caractères généraux de l’émancipation des peuples colonisés en Océanie ?
Une émancipation tardive et cependant précipitée
Le premier pays océanien à accéder à l’indépendance est Samoa, en 1962, au moment où s’achève
l’émancipation des colonies anglaises et françaises du continent africain. Il faut ensuite attendre 1968 et
Nauru pour voir le deuxième pays océanien insulaire accéder à l’indépendance. Ensuite, ce seront les îles
Fidji (1970), la Papouasie-Nouvelle-Guinée (1975), les îles Salomon et Tuvalu (1978), le Kiribati (1979), le
Vanuatu (1980), et bien plus tard encore les ex-TTIP étatsuniens (îles Marshall et États Fédérés de
Micronésie en 1990, îles Palaos en 1994)… La troisième vague de décolonisation est bien (entre autres, ou
aussi) océanienne.
Mais cette décolonisation tardive a aussi été très rapide. Elle est en effet passée par une période d’autonomie
souvent courte : deux ans pour les Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou le Kiribati, trois ans pour
Nauru, quatre ans pour Tuvalu, les îles Marshall et les États Fédérés de Micronésie, cinq ans pour Fidji, six
ans pour le Vanuatu… Le colonisateur a donc précipité les choses.
Une émancipation plus imposée que demandée
Il s’avère effectivement que, si l’on excepte Samoa, les autres accès à l’indépendance ont plus été imposés
par le colonisateur que par le colonisé. Plus exactement, les peuples colonisés ne souhaitaient pas forcément
une indépendance aussi rapide, et encore moins bradée. C’est donc à une indépendance « par le haut » que
l’on a affaire. Il est clair que l’Angleterre voulait se débarrasser au plus vite de ses colonies, peu soucieuse
des problèmes que pouvait occasionner un tel lâchage. Les îles Gilbert ne sont plus intéressantes dès lors que
l’on a épuisé le gisement de l’île Ocean (en 1978), on leur accorde illico leur indépendance sous le nom de
Kiribati (1979). Le problème ethnique fidjien, provoqué par l’immigration de masse de la main d’œuvre
indienne, devient inquiétant, on s’empresse de donner leur indépendance aux îles Fidji, en leur laissant en
héritage une Constitution anti-démocratique avec laquelle le nouveau pays devra se débrouiller…
Une émancipation globalement pacifique
Si ces émancipations ont été finalement précipitée, elles ne se sont pas accompagnées de violences, mis à
part au Vanuatu. Ailleurs, la faible conscience politique des populations océaniennes et la volonté du
colonisateur de se débarrasser de ses colonies ont désamorcé toute velléité de violence. Seul le Vanuatu
échappe à cette logique, mais ceci est étroitement lié au fait qu’il s’agit là d’un condominium franco-anglais
dans lequel chaque groupe veut prendre le dessus. Les violences que l’on a connues au Vanuatu sont
postérieures à l’accès à l’indépendance et le résultat de la lutte entre les communautés francophone et
anglophone, ainsi qu’à la farouche détermination du leader indépendantiste Walter Lini.
Une émancipation incomplète
Tous les pays océaniens n’accèdent pas à l’indépendance, ce qui fait de la région une exception. Ils
connaissent en fait toutes les variantes de l’autonomie. Très peu sont sous administration directe. On oubliera
les deux ou trois dizaines d’habitants de l’île de Pitcairn. On se souviendra mieux des Samoa américaines,
voire de Guam.
Ailleurs, on expérimente toutes les formes de l’autonomie, y compris dans les territoires français où celle-ci
est arrivée à un stade qui la rapproche du système d’indépendance – association anglais que connaissent par
exemple les îles Cook ou Niue.
Décolonisation
Trois mouvements distincts de décolonisation se sont produits dans le Pacifique insulaire.
Le premier, de 1957 à 1963, fut amorcé par la France par le biais de l’application de la loi-cadre…
Le second, de 1962 à 1970, vit quatre États accéder à l’indépendance. Les Samoa occidentales l’obtinrent en 1962 pour l’avoir
revendiquée au conseil de tutelle des Nations unies… Il en fut de même pour Nauru en 1970. La même année, le royaume de Tonga,
protectorat britannique depuis 1900, se voit restaurer par Londres son indépendance et établit la monarchie constitutionnelle en 1975.
Sous l’impulsion de Ratu Mara, la Grande-Bretagne accorde aussi aux îles Fidji l’indépendance et le statut de dominion, membre du
Commonwealth en 1970. En juillet 1963, les îles Cook choisissent l’autonomie interne avec rétention de la citoyenneté néo-
zélandaise pour leurs ressortissants, ainsi qu’un chef d’État commun, la reine d’Angleterre (décision appliquée en 1965)
Le troisième, de 1975 à 1980, débuta par l’indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sous tutelle de l’ONU et administrée par
l’Australie. Ce pays choisit la voie de l’indépendance qui lui fut accordée en 1975 après deux années et demie d’autonomie interne.
Londres poursuivit son retrait du Pacifique en accordant de sa propre volition l’indépendance à ses colonies et protectorats insulaires.
Les Salomon et les Ellice y accédèrent en 1978, Kiribati (Gilbert) en 1979. Le condominium des Nouvelles-Hébrides obtint la sienne
dans la difficulté et les troubles en 1980 pour former la république de Vanuatu.
À l’évidence, la Grande-Bretagne s’est retirée du Pacifique parce qu’elle n’y avait plus rien à y faire. Pourquoi en effet vouloir
conserver une poussière d’îles sans intérêt économique réel ? Déjà, au XIXème siècle elle s’était reposée sur ses deux satellites pour
leur confier l’administration coloniale de certaines îles dont elle n’avait pris possession que pour empêcher une autre puissance
européenne de s’y implanter. Australiens comme Néo-Zélandais souhaitaient d’ailleurs jouer ce rôle de second couteau colonial.
Nota : l’auteur ne pouvait parler de la quatrième vague de décolonisation des années 1990, l’article datant de 1986. Cette vague a
concerné les ex-possessions américaines des îles Palaos, des îles Marshall et des États Fédérés de Micronésie.
II- Vers une typologie des accessions à l’indépendance
Une seule indépendance s’est accompagnée de troubles sérieux : celle du Vanuatu
Le Vanuatu, enjeu des rivalités franco-anglaises
Au cours des années soixante, un mouvement autochtone — le Nagriamel — revendiqua les terres sur lesquelles voulaient s’étendre
les colons européens déjà installés. Par la suite, les Nouvelles-Hébrides bénéficièrent d’institutions telles que le Conseil consultatif en
1957, qui mèneront à l’autonomie en 1975. Une pétition fut déposée aux Nations unies en 1971 par le leader du mouvement, Jimmy
Stevens, revendiquant l’indépendance du pays. La même année, le pasteur Walter Lini (1942-1999) fonda le Parti national des
Nouvelles-Hébrides, qui devint plus tard le Vanua’aku Pati, un mouvement essentiellement anglophone. Dès lors, le désaccord entre
les anglophones (majoritaires) et les francophones (minoritaires) s’accrut, mais une trêve permit l’adoption d’un projet de Constitution
en septembre 1979. En novembre de la même année, les élections furent remportées par le parti anglophone de Walter Lini, qui
devint Premier ministre. Les francophones des îles Espiritu Santo (Santo) et Tanna tentèrent alors de faire sécession (sous la conduite
de l’anglophone Jimmy Steven).
L’indépendance fut proclamée le 30 juillet 1980, les Nouvelles-Hébrides devenant officiellement la république de Vanuatu. Le pays
fut aussitôt placé sous les feux de l’actualité internationale en raison de la grave crise politique qui résultait du désaccord entre la
majorité anglophone et la minorité francophone. De nombreux francophones décidèrent de fuir en Nouvelle-Calédonie alors que la
révolte sécessionniste se prolongeait sur les îles Santo et Tanna*…
* En mai 1980, des affrontements eurent lieu à Tanna entre partisans de Lini et francophones… Sur Santo, les francophones prirent Luganville et
proclamèrent la République indépendante de Vemarana et Lini ordonna le blocus de l’île. Dans le même temps, d’autres sécessionnistes, menés par Jimmy Steven font sécession dans les îles du Nord. Lini ne put reprendre le contrôle du pays qu’avec l’appui militaire de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée soutenue par l’Australie. Il réussit à faire arrêter et condamner Stevens, ainsi que près de 2 000 « sécessionnistes ».
La fin du rêve
L’indépendance de Vanuatu survenue en juillet 1980 fut précédée par quelques années de réelle tension. La contestation locale des
terres aliénées par la colonisation se mua en revendication politique. Les plantations étaient d’autant plus vulnérables qu’elles étaient
de petite taille, isolées et tenues par un seul colon. Constamment harcelées, les dernières plantations d’Epi, Ambrym, Pentecôte, ou
de la côte Est de Malakula furent alors progressivement abandonnées. La tentative de sécession du mouvement Nagriamel à Santo en
1980 et le soutien que lui apportèrent la plupart des colons, européens ou métis, de la ville de Luganville provoquèrent lors de la
reprise de la ville par le gouvernement de Vanuatu, l’expulsion immédiate de ces derniers vers la Nouvelle-Calédonie : 124 planteurs
ou assimilés de Santo furent alors interdits de séjour au Vanuatu…
À l’indépendance, toutes les terres des planteurs furent déclarées propriétés mélanésiennes et patrimoine inaliénable des propriétaires
coutumiers.
Certaines indépendances étaient programmées : celles qui concernent les territoires sous mandat
Pour de nombreux pays de la région, il était dans l’ordre des choses qu’ils accèdent à l’indépendance. Ce
sont les pays placés sous mandat de la SDN (Papouasie-Nouvelle-Guinée et Nauru sous mandat australien,
Samoa sous mandat néo-zélandais, Micronésie sous mandat japonais), puis sous tutelle des Nations-unies
(les mêmes, sauf pour la Micronésie enlevée au Japon pour être confiée aux États-Unis).
On n’est plus, théoriquement, dans la logique coloniale et les attendus de l’article 76 de la Charte des
Nations unies sont très clairs à ce sujet. Il s’agit non pas de permettre l’exploitation de ces anciennes
colonies, mais d’en assurer le développement afin de les conduire progressivement à l’indépendance. La
réalité, en particulier en ce qui concerne la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sera toute autre. Par contre, Samoa,
après la mauvaise expérience de l’Entre-deux-guerres où la Nouvelle-Zélande s’était fort mal conduite, est
effectivement accompagné par son pays-tuteur vers l’indépendance, acquise dès 1962. La Micronésie sous
tutelle étasunienne a quant à elle suivi des chemins variés : indépendance longuement accompagnée pour les
Palaos, les Marshall et les États Fédérés de Micronésie, une plus ou moins grande autonomie pour les
Mariannes du Nord et Guam.
Article 76
Conformément aux buts des Nations Unies, énoncés à l’Article 1 de la présente Charte, les fins essentielles du régime de tutelle sont
les suivantes :
1- Affermir la paix et la sécurité internationales ;
2- Favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires sous tutelle ainsi que le développement de leur
instruction ; favoriser également leur évolution progressive vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance, compte
tenu des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations, des aspirations librement exprimées des populations
intéressées et des dispositions qui pourront être prévues dans chaque accord de tutelle ;
3- Encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou
de religion, et développer le sentiment de l’interdépendance des peuples du monde
De nombreuses indépendances ont été bradées : Tuvalu, Kiribati, les îles Salomon, voire Fidji
Un certain nombre de colonies ont vu leur accès à l’indépendance précipité par le colonisateur. C’est le cas
de la plupart des colonies britanniques : Fidji en 1970, les îles Salomon et Tuvalu en 1978, le Kiribati en
1979 et le condominium néo-hébridais en 1980 (voir ci-dessous).
Le désengagement anglais en Océanie était en quelque sorte annoncé depuis bien longtemps :
- déjà, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni avait laissé les mandats de la
SDN sur les anciennes colonies allemandes (Samoa, Nauru et la Papouasie-Nouvelle-Guinée) à ses relais
océaniens, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Un premier signe ; - par ailleurs, la création (au XIXe siècle) puis le développement du Commonwealth à partir de 1931
(Statut de Westminster), puis de 1947 permet d’offrir une alternative souple aux colonies qui accèdent à
l’indépendance. Les nouveaux États demeurent ainsi dans le giron britannique au sein d’une sorte de
communauté d’intérêts très informelle. Devenir indépendant ne signifie donc pas couper brutalement les
liens… De fait, toutes les anciennes colonies britanniques d’Océanie ont adhéré au Commonwealth dès leur
accession à l’indépendance, à l’exception de Samoa, qui ne le fait qu’en 1970 (indépendance en 1962) ; - enfin, il faut bien reconnaître que le Royaume-Uni a été durement touché par la guerre et ne peut se
permettre d’entretenir un empire devenu coûteux. La crise de 1973 ne fait que précipiter les choses…
Ce désengagement rapide n’était pas souhaité par les colonies concernées qui aurait apprécié un meilleur
accompagnement vers l’émancipation. De fait, les Anglais ont laissé au moins derrière eux, sans trop d’état
d’âme, deux situations très difficiles : le Kiribati dont ils viennent d’achever l’exploitation de la seule
richesse minière, et Fidji qu’ils laissent en proie à des conflits ethniques larvés entre Mélanésiens et Indiens.
Kiribati et Banaba
Les îles Gilbert ont obtenu leur indépendance en 1979 et ont pris le nom de Kiribati. Cette indépendance fut précipitée par les
Anglais qui venaient d’achever l’exploitation des phosphates de l’île de Banaba (ou Ocean). Banaba était la seule source de richesse
minière du pays, uniquement composé d’atolls par ailleurs. Kiribati fit procès à l’Angleterre pour l’avoir pillé de ses ressources et
pour avoir déplacé sans indemnité la population de Banaba vers l’île fidjienne de Rabi. Ce déplacement avait été rendu « nécessaire »
par le souci de la compagnie phosphatière d’exploiter l’île dans ses moindres recoins.
Fidji, le lourd héritage
Voir dossier Fidji.
Un pays à part : Tonga
Tonga est sans doute à mettre à part dans cet inventaire, dans la mesure où le pays n’a jamais été vraiment
colonisé. En 1970, ce n’est pas une colonie mais un Protectorat qui accède à l’indépendance. De fait, la
constitution de Tonga date de 1875 et elle n’a pas été remaniée depuis.
LES ÉTATS INDÉPENDANTS DE LA ZONE PACIFIQUE
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
En 1884, l’Allemagne annexe le nord-est et le
Queensland le sud-est, qui passe sous
protectorat britannique en 1888. En 1902, le
sud-est passe sous contrôle australien et est
nommé Papouasie. Le pays est envahi par les
Japonais en 1942 et est le siège de violents
combats par la suite. En 1946, l’Australie
récupère les deux territoires sous mandat.
L’autonomie est accordée en 1963 et
l’indépendance en 1975.
EX-TTIP
Les îles Marshall dès 1885, Palau (ex-colonie espagnole achetée par
l’Allemagne) et les États Fédérés de Micronésie à partir de 1899 sont sous
protectorat allemand jusqu’en 1914. Elles sont occupées par le Japon de 1914 à
1920 puis passent sous tutelle japonaise de 1920 à 1944. En 1947 les trois
entités sont confiées à la tutelle des États-Unis et deviennent les TTIP (avec les
Mariannes du Nord). Accèdent à un statut d’indépendance association en 1986
et deviennent indépendants en 1990-91 pour les Marshall et les EFM, en 1994
pour Palau.
NAURU
Nauru est rattaché à l’empire colonial allemand en
1888 au sein du protectorat des îles Marshall..
L’exploitation de ses phosphates commence en 1907.
Les Australiens s’en emparent dès 1914 et l’île passe
sous mandat conjoint australo-néo-zélandais et anglais.
Elle est occupée par les Japonais de 1942 à 1945, puis
passe sous administration des Nations unies en 1947.
Un gouvernement local est institué dès 1951. En 1965,
Nauru accède à l’autonomie avec la création d’un
Conseil législatif et exécutif. L’indépendance est
proclamée en 1968.
SALOMON
Les îles Buka et Bougainville sont rattachées au
protectorat allemand de Nouvelle-Guinée en
1886. En 1893, l’Angleterre établit un protectorat
sur le reste de l’archipel. En 1942-44, violents
combats entre les forces alliées et les Japonais
sur Guadalcanal. L’autonomie de l’archipel est
instaurée en 1960 et l’indépendance est
proclamée en 1978.
KIRIBATI ET TUVALU.
Les îles polynésiennes des Ellice (futures
Tuvalu) ont été placées sous protectorat
britannique en 1862 et les îles
micronésiennes des Gilbert (Tungaru) en
1892. Elles sont réunies en 1916 pour
former la colonie des îles Gilbert et
Ellice à laquelle les îles Christmas sont
rattachées en 1919 et les îles de la Ligne
en 1971. Occupées par les Japonais en
1942, libérées par les alliés en 1943. Dès
1974, le gouvernement britannique laisse
entendre qu’il souhaite se séparer de cette
colonie en lui accordant une première
constitution. Les habitants des Ellice,
minoritaires, craignent d’être
marginalisés dans un futur État
indépendant. Par un référendum tenu en
1974, ils réclament à 92 %, et obtiennent
donc, d’être séparés des îles Gilbert et
accèdent à l’indépendance en 1978 sous
le nom de Tuvalu. De leur côté, les îles
Gilbert (+ les îles Christmas et de la
Ligne) accèdent à l’autonomie en 1977,
puis à l’indépendance en 1979 sous le
nom de Kiribati.
VANUATU
Anglais et Français sont présents sur l’archipel dès
1888. Ils fondent un condominium en 1906. Les
forces américaines s’y installent en 1942-44 (100 000
hommes à Espiritu Santo). L’autonomie est accordée
en 1974 et l’indépendance proclamée en 1980, dans la
confusion et les menaces de guerre civile.
SAMOA
Colonie allemande jusqu’en
1914, puis placée sous mandat
néo-zélandais en 1919, tutelle
reconfirmée par l’ONU en
1947. Accède à l’autonomie
en 1957 pour être le premier
État océanien insulaire à
accéder à l’indépendance en
1962
TONGA
Les îles Tonga sont un cas à
part. Elles étaient un royaume
puissant avant l’arrivée des
Européens. Convoitées par
l’Angleterre, elles ont réussi à
échapper à la colonisation en
acceptant un traité de protectorat
avec l’Angleterre en 1900. Ce
traité a été dénoncé en 1970.
FIDJI
Fidji devient colonie britannique en 1874. Les Anglais y font venir des
travailleurs indiens pour les plantations de coton puis de canne à sucre
entre 1878 et 1920. En 1963, Fidji accède à l’autonomie, avec la mise en
place d’un conseil exécutif, qui devient conseil des ministres en 1965 et
d’un conseil législatif à majorité locale. La colonie accède à
l’indépendance en 1970
++++
LA CONFRONTATION AUX DÉFIS POLITIQUES
Le chemin difficile vers des gouvernances démocratiques de type occidental et vers la
construction d’États-nations
Ce que nous demandent les textes :
- L/ES : on dresse un tableau des statuts particuliers des États de l’Océanie intertropicale dont plus de la moitié sont
aujourd’hui indépendants. - STG : les nouveaux États doivent compter avec l’héritage colonial et les conditions difficiles dans lesquelles ils
accèdent à l’indépendance. On montre qu’ils sont confrontés à des difficultés politiques (démocratie, construction d’un
État-nation…) (A- contextualisation) - S T2S : (pour l’Afrique subsaha rienne) on étudie les défis politiqu es représentés par l’intégration nationale et par le
choix et la mise en œuvre d’un type de régime et d’un mode d e gouvernement / on montre quelles sont les difficultés
auxquelles les États (océaniens) ayant accédé à l’indépendance sont confrontés aujourd’hui (B- étude de cas)
Problématiques :
Sur quelles bases les pays indépendants ont-ils construit leur vie politique ?
Sur quels héritages ?
Coutume et pratiques coloniales sont-elles des freins à la construction d’États
démocratiques ?
Quel mode de gouvernement ont choisi les pays qui ont accédé à l’indépendance ?
Peut-on parler de démocraties limitées ?
Y a-t-il un véritable exercice de la démocratie dans les États insulaires indépendants
en Océanie ?
Comment ont évolué les premières constitutions océaniennes ?
La construction des États-nations est-elle possible (envisageable) dans les pays
insulaires indépendants d’Océanie ?
Notions et concepts, mots-clés :
Indirect rule, Big man,
« Premier »,
système unicaméral, bi-
caméral,
Congrès, tama ’aiga, matai, fono
État-nation,
Tupou IV, Michael Somare,
Ratu Sir Kamisese Mara,
le colonel Rabuka
L’Union européenne définit sa stratégie vis-à-vis des petits États du Pacifique
Forte de son expérience, l’UE aidera à la prévention et à la stabilisation dans les situations d’après-conflit et à l’instauration d’une
bonne gouvernance, avec le renforcement d’institutions crédibles. Elle encouragera un meilleur respect des normes internationales en
matière de main-d’œuvre ainsi que dans la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Cette déclaration de l’Union européenne, qui pourvoit largement à l’aide des pays dits ACP, laisse planer un
doute sérieux sur la bonne gouvernance des petits États indépendants de l’Océanie insulaire. Qu’en est-il
exactement ?
1- Héritage ancestral, héritage colonial, autant d’écueils à surmonter
L’héritage ancestral
Avant la colonisation, les pays océaniens avaient leur propre organisation politique et sociale, plutôt éclatée
en Mélanésie, davantage hiérarchisée en Polynésie. Le colonisateur anglais, dans le cadre de l’Indirect rule, a
largement utilisé les chefferies comme relai pour asseoir sa domination. Celles-ci, confortées par la
colonisation, sont tout naturellement apparues incontournables au moment des indépendances. Les chefferies
et les royaumes ancestraux pèsent encore de nos jours de tout leur poids sur la vie politique et institutionnelle
des États océaniens indépendants. Ils ont une existence officielle dans certains cas, officieuse dans d’autres.
En tout cas, ils sont toujours respectés voire redoutés et l’installation des pratiques démocratiques a toujours
dû composer avec cet héritage qui n’a rien, lui, de démocratique puisqu’il fonctionne sur le pouvoir du chef,
ou des Anciens, qui n’est pas issu des urnes.
Les effets de l’indirect rule
Dans les territoires d’influence anglo-saxonne, la pratique de l’indirect rule a laissé le plus souvent les sociétés autochtones évoluer
en fonction de la dynamique sociale interne. Les groupes en sont peu à peu venus à la prise de conscience d’intérêts collectifs face
aux influences extérieures et ils ont réagi dans le cadre de leurs traditions. C’est ainsi que le royaume de Tonga a pu rester en marge
des soucis politiques en assouplissant légèrement son organisation féodale strictement hiérarchisée.
Cette évolution, qui est très conforme aux tendances et aux principes de la colonisation anglaise, peut se trouver freinée, soit par le
manque de ressources dans des archipels trop peu peuplés ou trop dispersés, soit par la tension menaçante entre groupes hostiles et
rivaux comme aux îles Fidji. Et encore, malgré ces grandes difficultés, l’administration britannique ou néo-zélandaise s’efforce-t-elle
de mettre partout en place des assemblées locales dans lesquelles toutes les tendances peuvent trouver un exutoire à leurs ardeurs
belliqueuses…
Vie sociale et organisation politique
La vie sociale mélanésienne s’organise dans le cadre restreint de la vallée, de la petite région, de l’île. Chaque communauté respecte
la « coutume », c’est-à-dire l’ensemble des pratiques communes au groupe. … Profondément socialisé, l’espace commun d’activité
est codé… Il est traversé de « sentiers d’alliance » en direction des tribus voisines. Les décisions sont prises par consensus, les
hiérarchies sociales sont légères et réversibles. Le big man de Nouvelle-Guinée s’impose par ses attitudes et ses activités. Il a bien
plus de devoirs que de droits.
Dans l’organisation politique polynésienne, les unités de base étaient plus vastes qu’en Mélanésie et les relations sociales bien plus
hiérarchisées, des aristocrates aux gens du commun et aux esclaves. À l’inverse du big man mélanésien, le chef polynésien (que les
Blancs désignèrent très vite par « roi ») disposaient d’une autorité permanente, institutionnelle. L’espace polynésien était tout aussi
socialisé qu’en Mélanésie, mais selon une autre polarité politique. À Samoa, à Tonga, les anciennes aristocraties polynésiennes sont
restées en place à l’époque coloniale. La monarchie tongienne et les princes de Samoa continuent de contrôler l’appareil d’État
depuis le retour de ces pays à l’indépendance.
Exécution sommaire au Samoa
Près du village de Lona, un Polynésien revenu en son village après vingt années passées à Auckland, M. Nuutai Mafulu Matautia, a
été exécuté d’une balle de révolver tirée entre les deux yeux.
Cette exécution avait été décidée cinq jours auparavant par le conseil des chefs (fono) qui avait constaté que la victime, qui était chef
de famille, avait refusé de se plier à l’autorité coutumière (en l’occurrence il avait refusé de s’acquitter d’une cotisation sportive).
L’exécution s’est faite en présence de sa femme et de ses cinq enfants.
Un avocat d’Apia a indiqué que les chefs traditionnels qui ont ordonné cette exécution ont agi selon la constitution des samoa qui
leur accorde le droit de faire ce qu’ils veulent. L’avocat a affirmé que rien ne s’opposait à ce que le meurtrier soit traduit en justice,
mais que néanmoins il a agi légalement selon le droit de vie ou de mort accordé au fono de chacun des villages, selon un acte
constitutionnel.
La constitution des Samoa est basée sur des principe s chrétiens, mais aussi sur des traditions samoanes. Car le gouvernement a
délégué en 1990 ses pouvoirs aux villages, selon le Village Fono Act* qui valide leurs pouvoirs. Il en résulte que la loi peut être
évoquée pour justifier les actes de brutalité…
En 1980, et au nom de la coutume, un homme qui avait vécu auparavant en Nouvelle-Zélande est retourné dans son village où le fono
exige que tout le monde aille à l’église le dimanche. L’homme a refusé. En représailles, il a été banni de son village, tous ses cochons
et ses récoltes ont été détruits sur décision du fono.
* Le Village Fono Act est un conseil des chefs au niveau du village. Cette structure qui existait avant l’arrivée des Européens, a été
réintroduite et légalisée en 1990. Elle permet aux matai réunis en conseil de prendre toutes les décisions qu’ils jugent utiles au bon
fonctionnement de la communauté villageoise, Le conseil peut décider de châtiments corporels, d’amendes ou de travaux d’intérêt
public, avec comme seule limite le respect de la coutume. Une interprétation extensive peut lui donner le droit de vie ou de mort…
Un bûcher pour le pasteur
Selon la radio australienne ABC, un membre de l’Église des Saints des Derniers Jours nommé Lotembio a failli être brûlé vif dans un
village des Samoa. La police est intervenue avant que ne soit exécutée la sentence des chefs coutumiers. Ils avaient prononcé son
expulsion du territoire, pour une raison que l’on ne connaît pas. Il était attaché à un poteau sur la place du village au moment de
l’intervention de la police.
Les chefs coutumiers ont déclaré que la sentence était cependant maintenue à son égard.
L’héritage colonial
L’héritage colonial est d’une grande complexité et ne manque pas de contradictions.
C’est le colonisateur sur le départ qui va se trouver soudainement en charge de la mise en place de nouvelles
institutions fondées sur la démocratie et l’État-nation. Ce même colonisateur qui, pendant toute la période
coloniale, a pratiqué le racisme ouvert, l’acculturation militante (par la religion entre autre) et finalement la
négation de l’individu privé des droits les plus élémentaires, sauf sur les toutes dernières années qui ont
précédé l’indépendance. Comment, par exemple, à Fidji, expliquer aux Mélano-Fidjiens qu’il faut accorder
les mêmes droits aux Indo-Fidjiens dans la Constitution de 1970, alors qu’ils sortent d’un contexte colonial
où l’égalité des droits n’existait pas ? Les Anglais n’y ont pas réussi.
Quant à l’État-nation, existant dans certaines sociétés polynésiennes, il n’a pas résisté au partage colonial. Ce
dernier ne s’est pas fait, en Océanie comme en Afrique, en fonction des découpages politiques ou ethniques
traditionnels.
Qu’on en juge plutôt :
- regroupement par les Anglais des îles Gilbert, micronésiennes, et Ellice, polynésiennes ;
- rattachement par les Français des îles Marquises à Tahiti, alors que les îles Cook, laissées aux
Anglais étaient beaucoup plus proches par la distance, la langue et la culture ; - partage entre Allemands et Étatsuniens des Samoa ;
- partage entre Anglais et Allemands de la Papouasie ;
- administration partagée entre Anglais et Français des Nouvelles-Hébrides ;
- importation de main d’œuvre indienne à Fidji.
- regroupement artificiel d’îles mélanésiennes qui n’avaient rien en commun (Salomon, Vanuatu…)
Or, mise à part la séparation entre Kiribati (ex-Gilbert) et Tuvalu (ex-Ellice), toutes les autres atteintes aux
nations originelles ont été maintenues. L’idée de nation est donc à (re)construire sur des bases plus ou moins
artificielles.
2- Quel mode de gouvernement choisir ?
La rédaction de la Constitution des premiers États indépendants s’est faite sous la responsabilité du pays
colonisateur ou des instances internationales. Partout, le choix a été fait en faveur d’institutions
démocratiques. Mais les particularismes locaux ont pu conduire à des textes peu conformes avec le plein
exercice de la démocratie de type occidental.
Partout, le choix de la démocratie, mais sous des formes de gouvernance différentes
Si le choix démocratique n’a généralement pas posé de problème, les formes de gouvernance ont beaucoup
varié d’un pays à un autre, généralement en fonction de leur passé colonial : monarchie parlementaire
reconnaissant la reine d’Angleterre comme chef de l’État, monarchie parlementaire reconnaissant un roi
local, République… Autant de choix qui ne sont pas anodins.
Au niveau de l’exécutif, on pourra distinguer plusieurs cas de figure :
- les pays micronésiens, qu’ils soient ex-possessions des États-Unis (Palaos, Marshall, ÉFM) ou de
l’Angleterre (Kiribati, Nauru), ont tous opté pour le système républicain, avec un Président plutôt fort, qui
est chef de l’exécutif, selon les principes de la Constitution des États-Unis ; - les ex-colonies britanniques mélanésiennes sont partagées entre la monarchie parlementaire
reconnaissant la reine d’Angleterre comme chef de l’État (Papouasie-Nouvelle-Guinée, îles Salomon,
Tuvalu, Fidji jusqu’en 1987), et la République (Vanuatu, Fidji depuis 1987). Mais dans l’option républicaine,
le Président n’a qu’un pouvoir représentatif, au contraire des systèmes micronésiens. Dans tous les cas, la
réalité du pouvoir est détenue par un Premier (Premier ministre) ; - les deux pays polynésiens (Tonga et Samoa) qui ont opté (ou conservé en ce qui concerne Tonga)
pour une monarchie locale (roi de Tonga, tama aiga de Samoa) qui correspond aux structures politiques
préexistantes à la colonisation.
Au niveau du législatif, les choses sont beaucoup plus compliquées, mais on peut dégager des constantes :
- Tonga et Fidji sont des cas à part, dans lesquels le chef de l’exécutif, non élu (roi à Tonga et
dictateur à Fidji) concentre l’essentiel des pouvoirs entre ses mains ; - on a presque partout un système unicaméral. Seules les Palaos et Fidji font exception avec une
chambre des délégués ou des représentants et un Sénat ; - le chef de l’exécutif, qu’il soit le Président ou le Premier ministre, est élu au suffrage indirect, par
le Parlement ; - l’assemblée législative, souvent appelée Parlement, est composée de membres généralement élus
pour quatre ans. Mais dans bien des cas ces membres élus côtoient des membres de droit, comme à Kiribati
ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. À Tonga, ces membres de droit, associés aux députés issus de la
noblesse, sont majoritaires. À Samoa, les députés ne peuvent être que des matai (des chefs de clan) ; - aux côtés des institutions démocratiques de type occidental co-existent souvent des structures
traditionnelles : Conseil des Chefs aux Palaos ou à Fidji, Conseil National des Chefs au Vanuatu par
exemple.
Le pouvoir judiciaire quant à lui est indépendant, à l’exception des Tonga, où il est étroitement lié à la
famille royale.
On notera enfin que les anciennes colonies britanniques (ou sous mandat australien ou néo-zélandais) ont
toutes rejoint le Commonwealth. Seule Fidji en est aujourd’hui écartée (suspensions successives de 1987 à
1997, de 2000 à 2001 et depuis 2006), mais par la volonté de l’Angleterre afin de protester contre les
atteintes à la démocratie dans ce pays.
Les premières constitutions ont-elles toujours été des modèles de démocratie ?
Dans les discussions qui ont accompagné la rédaction des premières Constitutions, le colonisateur a souvent
plié devant les exigences des futurs États qui mettaient en avant leurs problèmes spécifiques et (ou) le respect
de leur fonctionnement coutumier. Les règles élémentaires de la démocratie ont parfois été malmenées, avec
la bénédiction de l’Occident. On citera trois exemples.
Fidji, ou comment empêcher les Indiens d’arriver au pouvoir ?
La situation de Fidji a été rendue complexe par la politique migratoire du colonisateur anglais, qui y a
installé des milliers de travailleurs indiens. À la veille de l’indépendance, les deux communautés,
mélanésienne et indienne, se retrouvent à parité. Les Mélanésiens, s’estimant chez eux, ne veulent pas courir
le risque d’abandonner le pouvoir aux Indiens, qui détiennent déjà une bonne partie du commerce et qui
contrôlent les milieux d’affaires. Ils font donc pression sur les Anglais afin que la Constitution du nouvel
État indépendant leur permette quoi qu’il arrive de se maintenir au pouvoir.
Afin de préserver les droits des Mélano-Fidjiens, la Constitution de 1970 a imaginé un montage compliqué conduisant à élire à
l’Assemblée un nombre égal d’Indo-Fidjiens et de Mélano-Fidjiens. À ces représentants, s’ajoutaient 8 sièges réservés aux “autres
races” (Européens pour l’essentiel), réputées être du côté des Mélano-Fidjiens. Ainsi, en toute logique, les Mélano-Fidjiens étaient
sûrs de conserver la majorité législative, donc gouvernementale, à moins que ne naissent des dissensions au sein du parti de
l’Alliance, le parti Mélano-Fidjien et qu’un groupe mélanésien s’allie aux députés indiens (ce qui se produisit en 1987). Vue ainsi, la
Constitution de 1970 ne peut être considérée comme garantissant le bon exercice de la démocratie, puisque son objet était bien
d’interdire l’accès au pouvoir à une partie de la population.
À l’issue de la seconde conférence institutionnelle, qui s’est tenue à Londres en avril-mai 1970, il fut annoncé que Fidji accèderait à
l’indépendance le 10 octobre 1970… En même temps furent dévoilées les dispositions de la nouvelle Constitution. Il était prévu deux
chambres : le Sénat, ou chambre haute et la Chambre des Représentants, ou chambre basse… La Chambre des Représentants
(l’ancien Conseil législatif) était composée de 52 membres : 22 Fidjiens, 22 Indiens et 8 « sièges généraux » (autres ethnies, en fait).
Douze Fidjiens, douze Indiens et trois « Représentants généraux » étaient élus sur des listes « ethniques » (chaque communauté vote
pour des députés de sa communauté), pendant que dix Fidjiens, dix Indiens et cinq « Représentants généraux » sont élus sur des listes
nationales (par l’ensemble de la population)…
Tonga, une monarchie quasi-absolue
Tonga n’a jamais été annexé et la famille royale des Tupou dirige le pays depuis plus d’un siècle au moment
où le pays accède à l’indépendance, en 1970. À cette date, le pays est régi par la constitution de 1875 qui n’a
pas été modifiée. Officiellement, il s’agit d’une monarchie constitutionnelle, mais de fait c’est le roi qui a
tous les pouvoirs.
Les protestations n’ont cessé de se multiplier depuis quelques mois, contre un gouvernement entièrement contrôlé par la famille
royale et qui, selon ses opposants, considère Tonga comme le domaine privé de la Couronne sans aucun égard pour son peuple. Il est
vrai que l’actuel souverain, le roi Taufa’ahau Tupou IV, sur le trône depuis la mort de sa mère, la reine Salote, en 1965, dirige le
royaume selon les règles les plus arbitraires de la monarchie absolue, son bon plaisir et l’adaptation des lois au gré des circonstances.
Il est soutenu en cela par sa famille qui détient la plupart des postes clés du régime, au gouvernement en particulier. L’assemblée
législative est dominée par les douze ministres nommés par lui, qui en sont membres de droit et par les neuf représentants des trente-
trois familles nobles du pays. L’ensemble du peuple est représenté par neuf députés seulement, élus au suffrage universel par les
Tongiens de plus de 21 ans.
Deux députés du mouvement pro-démocrate de Tonga ont été arrêtés et pour avoir écrit dans la presse des articles jugés séditieux par
le gouvernement. Pour l’un des deux hommes, Akilisi Pohiva, il s’agit du second séjour en prison cette année. La police, munie d’un
mandat d’arrêt signé par le ministre de la justice, Tevita Tupou, a effectué une descente à leur domicile et emmené les deux hommes.
M. Tupou avait ces derniers mois été pris pour cible par M. Pohiva qui estimait que le ministre avait commis une faute en se rendant
aux Jeux olympiques d’Atlanta en pleine session parlementaire et sans la permission de l’assemblée. M. Pohiva demandait sa démission. La publication de ce projet de motion a valu aux deux hommes une condamnation de 30 jours de prison. Après 26 jours,
néanmoins, la Cour Suprême, estimant anticonstitutionnelle la sentence, a fait relâcher les deux hommes…
Samoa : le pouvoir aux chefs ?
Le chef d’État (O le Ao O le Malo) exerce peu d’autorité réelle ; le gouvernement est dirigé par le Premier
Ministre. Toutefois, le Fono (Parlement) ne peut adopter une loi sans l’approbation du O le Ao O le Malo.
Le système parlementaire est constitué d’une Assemblée Législative appelée également ’’grand fono. Elle se
compose de 49 membres élus pour un mandat de 5 ans. La constitution de 1960 avait prévu que sur ces 49
parlementaires, 47 étaient des matai désignés par consensus par les matai (chefs de famille), membres des
fono des 11 districts du pays, les deux autres étant élus au suffrage universel par les "non-Samoans"
(Européens, métis, Chinois…) installés dans l’archipel de longue date.
Des systèmes politiques nés d’influences variées
Les pays du Pacifique ont su combiner les concepts politiques traditionnels et importés sans trop traumatiser leurs sociétés.
La principale influence extérieure sur les systèmes politiques du Pacifique est britannique. Les autres puissances qui ont eu une
incidence sur les systèmes de gouvernement sont la France et les États-Unis. L’influence américaine s’est accrue en raison du rôle
décisif qu’ont joué les forces armées en expulsant les Japonais de la région au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Dans la pratique, ces influences extérieures se retrouvent dans les modèles de gouvernement actuellement en place. On trouve des
aspects du style de gouvernement de Westminster en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux îles Salomon et à Tuvalu sont des monarchies
constitutionnelles dont la reine d’Angleterre est le chef et dont le Premier ministre est choisi par le corps législatif. Au Vanuatu et au
Samoa, on trouve également des gouvernements parlementaires dont le chef d’État n’a pas de pouvoir exécutif, alors que Tonga, qui
n’a jamais été colonisée, est une monarchie constitutionnelle sur le modèle britannique, à la différence notable près que le Roi
conserve une influence considérable sur la politique. Les Fidji avaient un Parlement bicaméral et la reine Elisabeth comme chef de
l’État, mais à la suite du coup d’État militaire de 1987, le pays a adopté une constitution républicaine avec une seule chambre
législative.
Les influences des anciens pouvoirs métropolitains sont visibles ailleurs. A Nauru par exemple, qui était un territoire placé sous la
tutelle de l’ONU et administré par l’Australie, le vote est obligatoire. L’Australie connaît aussi ce système. Dans les îles plus
septentrionales qui sont ou oint été administrées par les États-Unis, la Constitution américaine se reflète dans la stricte séparation du
pouvoir en trois branches (exécutif, législatif et judiciaire)… Le chef de l’exécutif est élu par le peuple partout, sauf dans les États
Fédérés de Micronésie, et le vocabulaire politique comprend des termes comme Congrès, Sénat et Cour Suprême.
Kiribati possède un système constitutionnel intéressant qui semble être un amalgame des systèmes britanniques et américain. Le
législatif est élu et désigne le Président en son sein. Celui-ci à son tour désigne le ministres parmi les membres élus de l’assemblée.
Le Président, qui est donc à la fois chef de l’État et du gouvernement, peut occuper ce poste au maximum pendant trois mandats de
quatre ans.
3-Maintenir ou améliorer le fonctionnement démocratique des institutions ?
Sans doute faut-il rappeler que les institutions démocratiques qui ont été mises en place au moment des
indépendances ont été globalement respectées, au moins dans la forme. Ainsi, mis à part à Fidji, les
gouvernements successifs ont été mis en place à la suite d’élections libres. Ceci a pu occasionner, dans
certains pays, une grande instabilité gouvernementale, qui peut être considéré comme le signe du bon
fonctionnement de la démocratie ( ?).
Le contexte océanien freine le jeu démocratique
Les choses sont cependant beaucoup plus compliquées. En effet, dans la plupart de ces pays, seule une
minorité, généralement issue des chefferies coutumières, détient la réalité du pouvoir. On a vu qu’à Samoa,
seuls les chefs de clans, les matai, peuvent accéder aux fonctions électives et qu’à Tonga, une partie des
sièges sont réservés à la noblesse et échappent au suffrage universel. D’une manière générale, les élus
demeurent jusqu’à aujourd’hui très dépendants des structures coutumières en place ou sous-jacentes. Enfin,
au fil des années, on peut poser la question du débat politique, souvent inexistant. Les clivages politiques en
effet ne se dessinent pas selon les idées mais selon les liens familiaux ou les appartenances à des clans.
L’instabilité aux Salomon ou au Vanuatu, par exemple, est très étroitement liée à ce phénomène. Chaque île
vote pour son ou ses candidats et aucun n’a jamais la majorité. Des alliances, qui se font et se défont, sont
alors nécessaires.
Le pouvoir des chefs… Parfois remis en cause mais toujours une réalité.
Avant que les puissances coloniales n’entrent en scène, il existait déjà des cultures et des systèmes indigènes bien établis…
L’organisation traditionnelle de la plupart des îles du Pacifique est centrée sur le village… Au niveau du développement
institutionnel indigène, l’unité du village est donc capitale et les chefs locaux jouent un rôle déterminant dans le processus
décisionnel… Il et bon de souligner que pour de nombreux insulaires du Pacifique, le chef de village et le conseil demeurent des
autorités beaucoup plus palpables que celles de la capitale nationale. Toutefois, même au niveau national, les institutions
traditionnelles ont reçu un rôle à jouer dans de nombreux pays. En effet, il y a peu, 45 des 47 membres de l’assemblée législative des
Samoa occidentales ont été choisis par les matai (chefs de clans). Ce n’était pas aussi anti-démocratique que cela, étant donné que les
matai eux-mêmes étaient choisis par l’aiga (la famille étendue). En 1990, ce système a été remplacé par le suffrage universel. A
Tonga, les 33 nobles élisent sept de leurs pairs à l’assemblée législative et sept autres personnes choisies sont élues par le peuple. De
plus, le Premier ministre et les membres du cabinet choisis par le Roi sont également membres de l’assemblée. Aux Fidji, la
nouvelle Constitution reconnaît expressément le Bose Levu Vakaturaga (Grand Conseil des Chefs) et lui confère des pouvoirs
considérables. Vanuatu possède un Conseil national des Chefs, responsable de la supervision des questions coutumières et
traditionnelles, alors que dans les îles Marshall existe un organe similaire appelé l’Iroij.
Même dans les pays qui n’intègrent pas formellement d’éléments coutumiers dans leur Constitution nationale (Papouasie-Nouvelle-
Guinée, îles Salomon…) il est important pour les hommes politiques élus de se replonger dans leurs racines. Négliger les obligations
et les traditions coutumières se traduirait certainement par une punition au niveau des urnes.
Où l’engagement politique conduit à des constats démentis par l’histoire
Si depuis l’indépendance les crises politique s n’ont pas épargné les États insulaires, si des gouvernements sont tombés, c’est à la suite
d’élections générales ou d’un vote du Parlement. Ces crises s’y sont résolues sans violence, sans arrestations, évidemment sans coup
d’État militaire puisque l’armée n’existe pas, sauf à Tonga, à Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Pacific way est une
réalité….*
* Dès 1987, Fidji connut deux coups d’État, puis un troisième en 2000 et vit aujourd’hui dans l’illégalité constitutionnelle la plus
totale, rejeté par la communauté des nations. Par ailleurs, les îles Salomon ont connu une véritable guerre civile à partir de 1999 et
la Papouasie a dû essuyer une véritable guerre civile sur l’île de Bougainville à laquelle elle a fini par accorder l’autonomie. Le
royaue des Tonga enfin a connu une période insurrectionnelle en 2006-2008 (voir ci-dessous).
Des expériences variées
- Kiribati : la stabilité.
Le Kiribati représente un cas exceptionnel de stabilité politique dans le petit monde des pays indépendants du Pacifique.
Les Présidents successifs o nt souvent été réélus, d ans les limites imposées par la Constitutio n (3 mandats) : Ieremia
Tabai (de 1979 à 1991), Teburoro Tito (de 1994 à 2003), Anote Tong (de 2003 à aujourd’hui – 2009.
Voir fiche Kiribati
- l’évolution positive de Samoa ?
Le système matai aux relents de féodalisme a évolué à partir de 1990 vers un fonctionnement plus
démocratique. À cette date en effet, le collège électoral est élargi à l’ensemble de la population adulte de plus
de 21 ans, hommes et femmes, tout en conservant le monopole des matai quant à la possibilité de se
présenter aux élections (l’archipel compte aujourd’hui un peu plus de 25 000 matai, dont 5% de femmes).
Mais cette réforme s’accompagne parallèlement du renforcement du pouvoir des matai dans leur village, par
la promulgation du Village Fono Act..
Mais du chemin reste à faire…
- les îles Tonga à la croisée des chemins
Le problème tongien
Tonga est une monarchie dite constitutionnelle qui a longtemps vécu sous un régime fort, la dynastie des Tupou considérant le
royaume comme son bien personnel et se livrant à tous les passe-droits dans un pays très pauvre.
En 2003, le gouvernement aux mains de la monarchie fit voter une loi réduisant la liberté de la presse, au motif de protéger l’image
de la monarchie et en regard de la tradition tongienne. Dès 2004, plusieurs journaux furent interdits, ce qui provoqua des
manifestations dans les rues de Nuku Alofa. Les manifestants demandaient aussi la démocratisation du système électoral.
En 2005, le gouvernement doit négocier plusieurs semaines avec des fonctionnaires grévistes alors que l’on discute par ailleurs de la
réforme de la constitution. Le 11 février 2006, le Premier ministre, un prince proche du roi, démissionne. Il est remplacé par le
ministre du travail, Feleti Sevele. En 2006, le vieux roi Tupou IV décède et il est remplacé par son fils, Tupou V, ce qui donne un
espoir de changement, espoir vite déçu. Une manifestation est organisée en novembre 2006 pour dénoncer les retards dans la réforme
constitutionnelle. La manifestation tourne à l’émeute. Des voitures, des magasins, des bâtiments publics sont brûlés. Plus de 60 % du
centre-ville est détruit et on compte six victimes. En juillet 2008, le roi Tupou V annonce qu’il renonce à la plupart de ses
prérogatives et laisse le pouvoir au Premier ministre en attendant que soient organisées des élections démocratiques en 2010…
- les Salomon, le Vanuatu, Tuvalu, Samoa, des démocraties trop vivantes ?
Dans beaucoup de pays océaniens indépendants, l’instabilité politique est de mise, mais se déroule dans les
règles du jeu démocratique. Toutefois, ces règles sont souvent dévoyées. En effet, la succession des hommes
au pouvoir est plus souvent le fruit de querelles personnelles que le résultat d’un débat d’idées. Le débat
démocratique n’a donc pas vraiment lieu. On peut prendre quelques exemples : - Samoa (succession des Premiers ministres), de 1970 à 1985 :
- 1970 : Tupua Tamasese Lealofi IV
- 1973 : Fiame Fauminua Mata’afa Munilnu’u II
- 1975 : Tupua Tamasese Lealofi IV
- 1976 : Tupua Tamasese Tupuola Tufuga Efi (neveu du précédent)
- 1979 : Va’ai Kolone (accusé de fraude électorale en 1982)
- 1982 : Tupua Tamasese Tupuola Tufuga Efi
- 1982 : Tofilau Eti Alesana
- 1985 : Va’ai Kolone
- Tuvalu : succession des Premiers ministres de 2000 à 2009
- Lagitupu Tuilimu : 2000/2001
- Faimalaga Luka : 2001
- Koloa Talake : 2001-2002
- Saufatu Sopoanga : 2002-2004
- Maatia Toafa : 2004-2006
- Apisai Ielemia : depuis 2006 (en fonction en 2009)
- les tentations totalitaires : Tupou, Lini, Rabuka…
La démocratie a parfois été mise à mal après les indépendances. En trois occasions au moins, dans trois pays
différents.
- Le cas des Tupou à Tonga est à mettre à part. Il précède de loin l’indépendance. Les Anglais ont couvert en
1865 la rédaction d’une constitution anti-démocratique qui garantissait à la famille royale des pouvoirs très
étendus qui lui permettaient de régner sans partage sur le pays. Ce n’est que très récemment que les Tongiens
ont réagi en demandant, non sans utiliser la violence, un véritable accès du peuple aux affaires de l’État. - Le pasteur Walter Lini (voir dossier plus loin) a dirigé le Vanuatu, dans les premières années de
l’indépendance, d’une main de fer. Dans son souci de briser l’opposition il a multiplié les arrestations (dont
le Président de la République, George Sokomanu), les expulsions (dont la plupart des colons francophones et
deux ambassadeurs de France) et les confiscations (des biens des ressortissants francophones), s’est coupé
volontairement des puissances occidentales (à la manière d’un Sékou Touré en Guinée), s’est montré
hyperactif dans le mouvement des non-alignés et a entretenu des liens douteux avec Cuba et la Libye… Ce
bras de fer avec l’Occident (il réglait ses comptes vis-à-vis des deux anciennes puissances coloniales du
condominium et leurs alliés occidentaux) a eu pour première conséquence de priver le tout jeune pays
d’aides pourtant fort utiles à son développement. Les extraits ci-dessous ne doivent pas faire illusion. Le
Vanuatu s’est mis lui-même dans les difficultés et sa politique tous azimuts ressemble plutôt aux gestes
désespérés et inefficaces du nageur qui se noie. Son bilan économique a été désastreux.
Un proche de Walter Lini essaie de justifier la politique de son président
La stratégie du gouvernement dirigé par le Vanua’aku Pati de 1980 à 1991 repose sur la conviction que, dans le but d’être son propre
maître et de protéger son indépendance il est essentiel de mener une politique étrangère indépendante… Nous devînmes membres de
plusieurs organisations indépendantes du Pacifique Sud et au-delà : le Forum du Pacifique Sud, la Commission du Pacifique Sud, les
Nations unies, le Commonwealth, l’Agence de Coopération culturelle (ACCT)… Nous devînmes également membres du Mouvement
des Non-alignés…
Ces rapports établis entre Vanuatu et d’autres États se révélèrent importants, comme par exemple en 1987, alors que le gouvernement
français avait décidé d’interrompre ses accords d’aide à notre pays* et que nous fûmes contraints de faire venir d’ailleurs des
professeurs francophones pour enseigner au lycée Antoine de Bougainville. Grâce à nos contacts avec l’ACCT et le mouvement des
Non-alignés nous fûmes en me sure d’obtenir l’aide qui nous était nécessaire. Il en résulta que nous dûmes recruter des professeurs de
l’île Maurice et de Tunisie pour combler le vide laissé par le retrait de l’ancienne assistance technique fournie par la France…
Les États-Unis et l’URSS furent les derniers pays avec lesquels Vanuatu établit des relations diplomatiques… Nous voulions ainsi
sauvegarder notre situation de non-alignement…
Cuba fut l’un des rares pays désireux de soutenir la cause de notre pays aux Nations unies… Nous jugions donc le moment propice à
l’établissement de relations diplomatiques avec Cuba sans pour cela approuver ce que Cuba faisait…
Les rapports de Vanuatu avec la Libye émergèrent de contacts particuliers établis par Barak Sope, l’ancien secrétaire général du
Vanua’aku Pati… Dans l’ensemble, le gouvernement ne fut jamais complètement satisfait de ces liens avec la Libye… Il n’accepta
jamais l’action politique qui en résulta. Une délégation libyenne fit soudain irruption à Port-Vila, sans s’être annoncée, dans le but
s’y installer une ambassade nommée « Bureau du Peuple »… Walter Lini les pria de repartir. À la suite de cet incident, le
gouvernement de Vanuatu n’eut plus aucun contact avec la Libye.
Nous fûmes surpris des protestations des Etats-Unis et de l’Australie lorsque des accords commerciaux de vente de poissons furent
signés entre l’URSS et Vanuatu… L’argent ainsi gagné permit au pays d’équilibrer son budget, aide que nos bienfaiteurs nous
refusaient.
Vanuatu était tenu en haute estime par la communauté internationale en raison de sa politique étrangère… Par exemple, lorsque le
Forum désirait soulever une question particulière aux Nations unies, c’était souvent à Vanuatu que revenait la responsabilité de
contacter à ce sujet les autres délégués du Mouvement des Non-alignés. Nous avions ainsi réussi à faire inscrire la Nouvelle-
Calédonie au comité de décolonisation…
* Il avait, pour la deuxième fois, expulsé l’ambassadeur de France.
- Le colonel Rabuka a pris le pouvoir par la force à Fidji, à la suite d’élections remportées par une majorité
d’Indiens. N’admettant pas que le peuple mélanésien soit écarté du pouvoir par les nouveaux venus et
craignant qu’il soit placé sous la domination des Indiens, Rabuka a organisé un coup d’État militaire et ré-
installé à la tête du pays le Premier ministre qui venait d’être battu. Ce déni de démocratie a mis Fidji an ban
des nations : expulsion du Commonwealth, liaisons diplomatiques rompues avec la plupart des démocraties,
dont l’Australie et la Nouvelle-Zélande… Dans la foulée, Rabuka proclame la république, puis annonce des
élections qu’il tarde à organiser. La dictature est bien installée…
Rabuka et la dictature à Fidji
L’implication de l’armée dans la vie politique fidjienne est évidente depuis 1987, alors que, jusque-là, le pays paraissait stable et peu
menacé par un coup de force des militaires, ceux-ci étant très engagés dans les opérations de paix internationales et montrés en
exemple pour leur valeur et leur professionnalisme. La population fidjienne, composée de deux communautés d’importance
comparables, les Mélanésiens et les Indo-Fidjiens, vécut dans la paix tant que les autochtones gardèrent le pouvoir politique. À partir
de son indépendance, en 1970, les Fidji furent gouvernées par le parti de l’Alliance, son leader, Ratu Mara étant le Premier ministre.
Les ministres étaient majoritairement des Fidjiens. Les élections d’avril 1987 virent la défaite de Ratu Mara et de son parti face à une
coalition composée du National Federation Party (N.F.P.) et du parti travailliste, le Fiji Labour Party (F.L.P.), récemment créé.
Cette coalition était conduite par le docteur (Fidjien de souche) Timoci Bavadra. Ce Mélanésien progressiste devint Premier ministre
et composa un gouvernement multiracial. Beaucoup de Fidjiens de souche y virent la perte de leur pouvoir politique au profit des
Indo-Fidjiens, qui détenaient déjà une large part du pouvoir économique. Les groupes nationalistes se mobilisèrent et la tension
monta. Peu importaient la légalité et l’équité, c’était une question de légitimité. Les nationalistes considéraient que leur suprématie
était quasiment de droit divin, s’appuyant sur l’Ancien testament et des terres données par Dieu aux peuples élus.
L’armée était presque entièrement fidjienne, la police l’était en majorité. Beaucoup de leaders coutumiers avaient une instruction
militaire et souvent une expérience des opérations extérieures, acquise pendant la Seconde Guerre mondiale, la campagne de
Malaisie ou les missions de soutien de la paix. Rares étaient les Indiens à avoir une telle formation. Les Mélanésiens avaient donc le
monopole de la force légale. Le 14 mai, l’officier qui était le numéro trois des Royal Fiji Military Forces, le lieutenant-colonel
Sitiveni Rabuka, opéra un coup d’État.
Malgré les pressions internationales, Rabuka et ses partisans restèrent au pouvoir pendant 12 ans.
4- La difficile construction de l’État-nation
On a vu que les nouveaux États indépendants étaient pour la plupart hérités de constructions coloniales.
Beaucoup n’ont donc pas de racines lointaines à partir desquelles ils pourraient puiser.
On peut sûrement opposer la Mélanésie et la Polynésie, ce qui ne manque pas d’enseignements.
La Polynésie (Samoa, Tonga, Tuvalu), l’État-nation, une réalité ?
Il s’est développé dans le Pacifique central, bien avant l’arrivée des Européens, de véritables « empires »
samoans ou tongiens. Il en est résulté chez les populations concernées le développement du sentiment
d’appartenance à un même groupe, plus ou moins homogène mais partageant des valeurs communes et se
reconnaissant parfaitement dans une organisation sociopolitique hiérarchisée. Lorsque le colonisateur est
arrivé dans l’espace polynésien, il n’a pas remis en cause ces structures. Le royaume tongien s’est maintenu
sous la forme d’un protectorat (il n’a jamais été colonisé) et a traversé l’époque coloniale sans être vraiment
remis en cause. Les Samoans ont beaucoup plus souffert, mais le colonisateur n’a pas réussi à briser la
structure politique en place et a maintenu les grands chefs, les tama aiga, au nombre de trois, un pour chaque
grande île.
On comprendra que l’accession à l’indépendance et le passage à ce que les occidentaux appellent l’État-
nation, ait moins posé de problèmes dans ce monde là. La grande majorité des Tongiens se reconnaissent
dans la personne de leur roi, même si beaucoup aujourd’hui en contestent les prérogatives excessives. Les
Samoans forment un groupe uni, même si une partie d’entre eux (ceux de Tutuila) connaissent une destinée
particulière, en lien avec les États-Unis.
La Mélanésie : l’impossible construction de l’État-nation ?
Les États mélanésiens d’aujourd’hui se trouvent dans un tout autre contexte. La conscience d’appartenir à un
groupe existe. Elle est même très forte autour de pratiques coutumières. Mais ce groupe est souvent restreint.
Il ne s’est jamais développé de grandes unités politiques dans l’espace mélanésien. Nous sommes ici dans un
monde éclaté, au niveau de l’île, voire de la vallée. Or, les structures politico-administratives établies par le
colonisateur et qu’il a laissées au moment des indépendances sont beaucoup plus vastes. Les nouveaux pays indépendants ne sont donc pas homogènes. Les groupes qui les constituent ne se comprennent pas entre eux,
n’ont pas les mêmes traditions, souvent ne se sont jamais rencontrés. Aux Salomon, au Vanuatu chaque île
représente une unité autonome, qui a sa propre personnalité qui dépasse dans la conscience populaire la
personnalité d’un État très lointain, comme étranger, voire ennemi. Au sein de ces îles même, les groupes ne
s’entendent pas forcément et les luttes sont nombreuses. Dans un tel contexte, la construction de l’État-nation
n’est-elle pas illusoire ?
L’obstacle des langues
Sur le sujet, on peut aller utilement sur le site Internet de l’Université de Laval (Canada).

du monde, Lexilogos.
Les États-nations vus par Jean Chesnaux
Dans le Pacifique comme ailleurs, la décolonisation s’est opérée à travers un moule exogène, né en Occident dans de tout autres
conditions historiques, à savoir l’État-nation. Ces pays n’avaient pas le choix. C’était le seul modèle politique que leur offrait la
société internationale, si mal adapté à leurs traditions sociales, à leur situation géographique, à leurs besoins fondamentaux. Les
anciens territoires du Pacifique auxquels on a accordé l’indépendance sont donc devenus des Etats-nations…
Sauf au Vanuatu, l’indépendance a été octroyée par en haut. Elle s’est organisée par référence aux deux cultures politiques alors
influentes dans la région : le système dit de Westminster et la « coutume ». Sauf à Kiribati et à Nauru, dirigés par des présidents à
l’américaine, les nouvelles Constitutions ont adopté le parlementarisme anglo-saxon, qui distingue un chef de gouvernement
responsable et un chef d’État symbolique, qui représente la reine d’Angleterre pour les pays restés membres du Commonwealth.
Mais à l’intérieur de ces structures importées, les hiérarchies coutumières restent très influentes. Au Vanuatu, à Fidji, en PNG, la
Constitution donne de grands pouvoirs à un Conseil national des chefs. Les aristocraties traditionnelles contrôlent les cadres de
l’armée à Fidji, les postes ministériels à Tonga, le Parlement à Samoa.
La vie politique se joue donc au sommet, en fonction des rivalités personnelles, des conflits de générations, des intrigues de factions.
TROIS LEADERS CHARISMATIQUES
MICHAEL SOMARE (né en 1936) – Papouasie-Nouvelle-Guinée
Michael Somare a commencé ses études sous l’occupation japonaise et appris à lire et
compter en japonais. Para la suite, il poursuit des études qui le mènent à l’enseignement.
Il travaille ensuite pour la radio, avant d’entrer en politique. Il fonde en 1967 le Pangu
Pati et est élu au Parlement où il devient le leader de l’opposition. En 1972, il forme un
gouvernement de coalition. Lors de l’accession à l’autonomie, en 1973, il devient Chief
Minister et il travaille à la rédaction de la nouvelle Constitution.
Michael Somare a été Premier ministre de 1975 à 1980, puis 1982 à 1985 et enfin depuis
2002. Il cumule aujourd’hui cette fonction avec celle de ministre des affaires étrangères.
Dans ses différentes fonctions, Somare a toujours insisté sur la dimension océanienne et
sur les traditions mélanésiennes (il porte toujours l’habit traditionnel).
Par ailleurs, il a su faire preuve d’ouverture auprès de ses adversaires politiques. Il est
une voix écoutée dans les instances internationales où il milite entre autres pour
l’indépendance des peuples et pour la protection planétaire de l’environnement.
Ses relations avec l’Australie se sont fortement dégradées entre 2005 et 2007, à la suite de
ce que l’on a appelé « l’incident des chaussures » et de « l’affaire Moti » (voir par
ailleurs).
WALTER LINI (1942-1999) – Vanuatu
Pasteur anglican considéré comme le père de l’indépendance de Vanuatu.
Sous le régime du condominium, en 1972, il fonde le Vanua’aku Pati, parti socialiste anglophone
qui milite pour l’indépendance. Il boycotte les élections législatives de 1977 et crée alors un
gouvernement provisoire. Participe l’année suivante à un gouvernement d’union nationale qui
élabore un projet de Constitution. Remporte les élections législatives de 1979 (accusé cependant
de fraude électorale) et devient Premier ministre. Il doit alors faire face à la tentative de sécession
de la minorité francophone dirigée par Jimmy Stevens sur Santo et Tanna.
Lorsque le Vanuatu devient indépendant en 1980, il apparaît comme l’homme fort du pays et
devient Premier ministre, le Président étant George Sokomanu. Les troubles entre francophones
et anglophones s’aggravant, Lini fait intervenir l’armée (soutien de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée) et rétablit l’ordre. Il fait emprisonner Stevens, ainsi que plus de 2 000 personnes.
Lini au pouvoir n’aura de cesse de lutter contre les intérêts français. Il fait occuper
provisoirement les îles Matthew et Hunter, rattachées à la Nouvelle-Calédonie, il renvoie
l’ambassadeur de France en 1983, année de sa réélection. En 1988, il assigne le Président
Sokomanu à résidence (il le fera condamner à sept ans de prison) et fait procéder à de
nombreuses arrestations pour cause de mutinerie… Il finit par être renversé en 1991 par Maxime
Carlot. Il meurt en 1999. C’est son frère, Ham Lini qui est Premier ministre aujourd’hui.
Tout au long de son mandat, Lini s’est heurté aux anciennes métropoles qui lui reprochaient ses liens étroits avec la Libye et les pays
communistes, son activisme indépendantiste (en particulier son soutien au peuple kanak), son mode de gouvernement autoritaire, sa
mauvaise gestion des affaires.
RATU sir KAMISESE MARA (1920-2004) – Fidji
Ratu sir Kamisese Mara est sans doute le personnage le plus emblématique de la vie
politique des jeunes États indépendants océaniens. Issu d’une grande famille de chefs de
l’archipel des Lau, il part poursuivre des études universitaires à Auckland et à Oxford. En
1950, il se marie avec Ro Litia Cakobau, descendante d’une des grandes dynasties
fidjiennes. Il est élu en 1953 au Conseil législatif sur l’un des cinq sièges réservés aux
Fidjiens. En 1959, il est nommé au Conseil exécutif et en 1963, il prend en charge le poste
de responsable des affaires économiques et des ressources naturelles auprès du gouverneur.
En 1964, il entre au Grand conseil des chefs et fonde en 1966 l’Alliance Party qui remporte
les élections de 1966. Lorsqu’en 1967 les Anglais créent un gouvernement d’autonomie,
Ratu Mara est nommé Chief Minister. A ce titre, il est chargé de préparer l’accession à
l’indépendance et d’essayer de régler le problème de la représentativité des Mélano-Fidjiens
dans les discussions sur la Constitution.
Avec l’indépendance, Ratu Mara prend le titre de Premier ministre, qu’il conservera de 1970 à 1992, non sans difficulté parfois. En
1977, il perd « momentanément » les élections, le parti adverse (le National Federation Party), à majorité indienne, éclate dès sa
victoire, ce qui entraîne le rappel de Ratu Mara, dans des conditions douteuses sur le plan institutionnel. En 1987, l’Alliance Party est
à nouveau battue par le NFP de Timoci Bavadra, mais les vainqueurs sont renversés par les coups d’État du colonel Rabuka, qui
rappelle Ratu Mara pour un gouvernement intérimaire qui durera jusqu’en 1992, date à laquelle Ratu Mara s’efface. Il devient alors
Président de la jeune république fidjienne (après 1987, les liens ont été rompus avec la couronne britannique). Mais en 2000, il doit
affronter un nouveau coup d’État qu’il ne cautionne pas, ce qui lui vaut d’être mis en résidence surveillée.
Il meurt en 2004 et laisse le souvenir d’un personnage exceptionnel.
++++
L’OCÉANIE DANS LE CONTEXTE INTERNATIONAL TENTATIVES D’ORGANISATION ET APROCHE GÉOPOLITIQUE
Ce que nous disent les textes
– ES/L/S : on analyse les tentatives d’organisation pour obtenir un poids accru dans les relations internatio nales
(contextualisation)
– L/ES : on s’interroge sur le Pacifique en tant que nouvel espace stratégique sous l’influence des puissances
riveraines.
– STG : on met en évidence la place occupée dans les relations régionales et internationales (B- étude de cas)
Problématiques :
Quel rôle géopolitique joue l’Océanie dans le Pacifique et dans le monde ?
Quelles relations géopolitiques entretiennent les micro-États océaniens
avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande ? Avec le monde ?
Quelle est la place de l’Océanie tropicale insulaire dans les relations
régionales et internationales ?
Comment fonctionne l’Océanie tropicale insulaire dans le monde
d’aujourd’hui ?
Notions et concepts, mots-clés :
ANZUS, Kwajalein, Bikini,
Christmas, Commonwealth, traité
de Rarotonga, espace dénucléarisé,
Forum des îles du Pacifique, CPS
(Commission du Pacifique Sud),
PIDP, PROE, SOPAC, Festival des
Arts, Jeux du Pacifique
Cette question peut être envisagée à différentes échelles :
– l’échelle Pacifique, qui s’intéresse aux relatons existant entre l’Océanie et les façades
Pacifique des continents américain et asiatique ; où l’Océanie se trouve impliquée dans
des enjeux qui la dépassent ;
– l’échelle océanienne, qui suppose de mettre l’accent sur l’interface océanienne, c’est-à-
dire sur les relations entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande d’une part, et les îles et
archipels de l’Océanie intertropicale d’autre part ; on est alors dans la logique des relations
Nord-Sud ;
– l’échelle de l’Océanie insulaire, qui invite à s’interroger sur les tentatives de regroupement
régional, sur son intérêt et sur les difficultés à le mettre en place.
1- L’Océanie dans le contexte Pacifique et mondial : des enjeux qui la dépassent ?
Entre marginalisation et intégration économique
Espace vide et délaissé par les Européens pendant longtemps, l’Océanie est incluse dans un ensemble
Pacifique qui s’est éveillé au monde à la fin du XIXème siècle et aurait même, à en croire les chiffres,
supplanté l’Atlantique dans le volume des échanges commerciaux transocéaniques à la fin du XXème
siècle. Mais on l’a bien compris : ce réveil concerne avant tout le Pacifique Nord, quasiment vide en
son centre mais bordé par des géants économiques qui multiplient les relations commerciales entre
eux : les États-Unis, le Japon, les « Quatre dragons », les autres pays de l’ASEAN et maintenant la
Chine littorale. Il n’en est pas de même pour la partie sud de la région. Celle-ci est certes animée par le
continent australien et l’archipel néo-zélandais, mais elle est constellée en son centre de micro-États
insulaires constituant un espace délaissé et marginal. Ces derniers ne pèsent d’aucun poids sur
l’échiquier économique international. Ils sont le ventre mou d’un système extrêmement actif sur ses
marges. Ils échappent aux grands courants d’échanges et n’en génèrent pas véritablement eux-mêmes.
Ils ne sont qu’une poussière de terres perdues dans l’océan et connaissent tous, y compris les plus
riches d’entre eux, des problèmes de développement qu’ils s’attachent à surmonter avec des fortunes
diverses.
L’Océanie a-t-elle encore un intérêt stratégique ?
L’Océanie intertropicale a longtemps été un enjeu important des relations internationales. La Seconde
Guerre mondiale l’a propulsée au premier plan avec l’avancée japonaise et la contre-attaque
occidentale. La Guerre du Pacifique a laissé des traces indélébiles sur le terrain et dans les esprits. Qui
ne connaît Pearl Harbour, Midway ou Guadalcanal par exemple ? Les pays océaniens ont été bien
malgré eux une interface entre le monde occidental et le monde asiatique et ils l’ont payé au prix fort.
Les archipels mélanésiens et micronésiens ont été ravagés.
Après-guerre, la Micronésie, passée sous tutelle étasunienne, a été incluse dans le glacis de protection
que les États-Unis ont construit face au monde communiste qu’ils souhaitaient « contenir ». Certes, les
îles micronésiennes n’étaient pas aux avant-postes, à l’image de la Corée ou du Viêt-Nam, mais leur
position de deuxième rideau en a fait des pièces importantes du dispositif de défense occidental (voir
les îles Marshall). Ailleurs, plus au sud, les États-Unis ont signé un accord militaire de défense avec
leurs alliés australiens et néo-zélandais, l’ANZUS. Le Pacifique dans son ensemble a longtemps été
considéré par les États-Unis comme une mer américaine, très étroitement contrôlée par les IIIe et VIIe
flottes. Il a pu, à la marge, être l’enjeu des luttes d’influence entre le camp communiste et le camp
occidental. On en veut pour preuve le lobbying de Taiwan et de la Chine communiste pour récupérer
des voix à l’ONU. On a pu aussi s’interroger sur les accords de pêche passés par l’URSS avec le
Kiribati, qui a beaucoup inquiété à l’époque. On s’est inquiété aussi des contacts du Ni-Vanuatu
Walter Lini avec la Lybie… Mais si ces péripéties ont alimenté les colonnes de la presse locale et
régionale, force est de constater qu’elles n’ont pas pesé lourd à l’échelle des relations internationales.
Par ailleurs, leur grand isolement en a fait le siège idéal pour les expérimentations nucléaires. Les
Anglais, les Étatsuniens puis les Français y ont fait exploser des dizaines de bombes thermonucléaires,
en aérien ou en sous-terrain, sans prendre toute la mesure des retombées sur les populations : Bikini et
Eniwetok (îles Marshall par les États-Unis, 1946-58), Christmas (Kiribati, par les États-Unis et
l’Angleterre, 1957-62), Moruroa et Fangataufa (Polynésie française par la France, 1963-96)…
Aujourd’hui, les expérimentations nucléaires ont cessé et le Pacifique Sud est devenu une zone
dénucléarisée (voir plus bas le traité de Rarotonga). Par ailleurs, si les États-Unis conservent leurs
bases de missiles aux Marshall et un important dispositif militaire à Guam et sur Hawaii, on notera
qu’ils se désengagent d’une zone dont l’intérêt stratégique s’est affaibli avec la chute du monde
communiste.
Kwajalein est un atoll corallien faisant partie des îles Marshall et situé au centre l’océan Pacifique. L’atoll d’une
superficie de 16,4 km² comporte 97 îlots qui entourent l’un des plus grands lagons du monde (2 174 km²). Une
partie de l’atoll est occupée par une importante base militaire américaine qui y effectue des lancements de fusées
et de missiles. Les 2 600 habitants sont composés en majorité de civils et militaires américains employés par la
base.
L’atoll est occupé par les forces américaines sans interruption depuis 1944. Kwajalein, contrairement aux atolls
voisins de Bikini et Rongelap, n’a jamais été utilisé pour les essais nucléaires qui se sont déroulés dans l’arch ipel
durant les années 1950 et 1960 .
Les États-Unis louent 11 des 97 îlots. L’activité de la base américaine est en partie liée à la mise en oeuvre
d’installations radars, optiques et d’équipements de communications pour effectuer les tests des intercepteurs de
missiles. L’atoll abrite également l’une des cinq stations terrestres qui contrôlent le réseau de satellites
Aujourd’hui donc, l’Océanie ne présente pas un intérêt stratégique de premier plan. Les enjeux sont
ailleurs, même si la menace de la Corée du Nord peut amener les États-Unis à renforcer leur présence
en Micronésie.
Une analyse du début des années 2000
Pour les Américains, la sécurité de la zone repose sur la présence de leurs forces armées dans le Pacifique Nord et sa frange
occidentale. … Pourtant, on s’accorde à parler d’un désengagement militaire américain dans la région. C’est que l’ennemi
n’est plus le même et l’urgence de la riposte non plus. C’est aussi que les moyens matériels dont disposent les forces
américaines ont qualitativement changé du tout au tout…
Pour les États-Unis, la région continue à présenter un risque d’embrasement : poursuite par la Corée du Nord de son
programme nucléaire menaçant la Corée du Sud, non règlement de la question des deux Chine, montée de l’islamisme en
Indonésie, instabilité politique des Philippines, piraterie et brigandage en mer de Chine et dans le détroit de Malacca…
Cette rive occidentale du Pacifique intéresse également l’Australie qui a des intérêts principalement en Mélanésie, zone la
plus instable du Pacifique insulaire : indépendance tumultueuse de Vanuatu écartelé entre les zones d’influence australienne
et française, coups d’État dans les îles Fidji, crises graves en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans les îles Salomon entraînant
l’intervention de forces australiennes et néo-zélandaises, conflit entre les États et les tribus locales à propos des royalties sur
l’exploitation des ressources, univers traditionnel tellement fragmenté qu’il interdit l’émergence d’un sentiment national…
À cette instabilité politique de la Mélanésie et de son prolongement indonésien, on peut opposer la stabilité du Pacifique
Nord : stabilité institutionnelle liée au pacte d’association des États Fédérés de Micronésie, des îles Palaos et Marshall avec
les États-Unis, au statut de membre du Commonwealth des Mariannes du Nord, au statut de territoire de l’Union de Guam,
sans compter bien sûr les îles Hawaï, cinquantième État des États-Unis…
Parlant de la Nouvelle-Zélande, notons que ce pays se réserve une zone d’intérêt en Polynésie qui le met en concurrence avec
la France. Cependant, sa crispation sur la dénucléarisation de la zone et son refus de donner accès à ses ports aux navires
américains à propulsion nucléaire ou porteurs d’armements nucléaires l’ont placé en marge de l’ANZUS, ce qui réduit
considérablement son influence dans la région.
Le Pacifique ne représente plus guère un enjeu économique par les ressources qu’il recèle. L’intérêt suscité par les ZEE a
diminué … On a beaucoup misé par la passé sur l’exploitation des ressources des fonds marins, notamment des nodules
polymétalliques. Le coût élevé de leur exploitation et l’instabilité des cours mondiaux ont pour le moment détourné les
investisseurs de cette industrie…
Alors, que valent les petits pays indépendants océaniens à l’échelle de la planète ? Plus grand chose
assurément. Mais plus cependant que leur poids économique ou démographique. Ils siègent en effet à
l’ONU et leurs voix, on l’a vu, sont courtisées. Par ailleurs, l’ONU est une tribune pour leurs
revendications et ils savent se faire entendre : lutte pour la décolonisation, lutte écologique, appels aux
aides internationales… Mais ils sont aussi pointés du doigt pour leur mauvaise gestion qui place
certains d’entre eux en position d’ajustement structurel.
Discours de Michael Somare aux Nations-unies, le 27 septembre 2007, ou comment exister sur le plan
international ?
« Monsieur le Président,
…J’aimerais remercier le secrétariat ainsi que toutes les agences de l’ONU qui continuent à rendre de grands services à la
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le 18 septembre 2007, deux jours après avoir célébré ses 32 ans d’indépendance, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée a réuni son huitième Parlement national… La démocratie est un challenge que la Papouasie-Nouvelle-
Guinée continue à relever. Mon pays, avec plus de 800 tribus et langages, continue à trouver dans les principes
démocratiques la force de maintenir son unité dans sa diversité…
Le commerce mondial aujourd’hui est plus caractérisé par des pratiques commerciales condamnables des grandes puissances
que par le souci d’offrir des possibilités de développement à des pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée…
Nous devons lutter contre des maladies aussi graves que le SIDA ou la malaria. Nous ne pouvons y arriver seuls. Je remercie
ici les agences de l’ONU pour leur aide. Je remercie aussi l’ancien président Bill Clinton pour sa contribution, ainsi que la
fondation Bill Gates qui a apporté son soutien à notre lutte contre la malaria, qui est la principale source de décès dans notre
pays…
Le travail du comité de l’ONU sur la décolonisation n’est pas terminé. Nous avons encore 16 pays dépendants sur la planète,
dont certains dans le Pacifique. .. Nous félicitons les gouvernements de la Nouvelle-Zélande et de Tokelau pour le récent
référendum sur l’indépendance de ce pays et nous respectons la décision prise*. Dans le même ordre d’idée, nous espérons que d’autres pays suivront l’exemple de la Nouvelle-Zélande et aideront les autres territoires dépendants à prendre leur
propre décision.
Quand j’ai pris place dans cette assemblée pour mon pays la première fois, il y a 32 ans, je disais alors, et je souhaite le
réaffirmer aujourd’hui : dans la limite de ses ressources, la Papouasie-Nouvelle-Guinée jouera toujours un rôle positif au sein
des Nations Unies. »
* Lors de ce référendum, les habitants de Tokelau se sont prononcés pour le maintien de la tutelle néo-zélandaise, ce que n’apprécie pas
forcément le président Somare…
L’Océanie intertropicale, un espace dénucléarisé ?
L’Océanie intertropicale a sans doute été, on l’a vu plus haut, une des régions de la planète les plus
concernées par les expérimentations nucléaires. Aujourd’hui, celles-ci ont cessé et la région est
devenue une zone dénucléarisée, selon les vœux et les termes du traité de Rarotonga. Le traité de
Rarotonga a été signé en 1985 par l’Australie, les îles Cook, Fidji, Kiribati, la Nouvelle-Zélande, Niue,
Samoa et Tuvalu. Il est entré en vigueur après ratification des pays signataires en décembre 1986, alors
que la France se livrait encore à des expérimentations aux Tuamotu. Nauru (1986-87), la Papouasie-
Nouvelle-Guinée (1985-98), les îles Salomon (1987-89), le Vanuatu (1995-96) et les îles Tonga
(1996-2000) l’ont ensuite signé puis ratifié. Notons enfin que la France et le Royaume-Uni ont signé et
ratifié les protocoles destinés aux pays extérieurs à la zone en 1996, alors que les États-Unis les ont
signés mais non ratifiés.
L’espace concerné couvre les eaux territoriales de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Mélanésie
(dont la Nouvelle-Calédonie), de la Polynésie (dont Wallis-et-Futuna et la Polynésie française), ainsi
que de Nauru et du Kiribati en Micronésie. Notons que le reste de la Micronésie (relevant ou ayant
relevé de la juridiction des États-Unis) n’en fait (curieusement ?) pas partie… Notons également que
la zone descend loin dans le sud, au-delà des eaux territoriales des pays concernés, jusqu’au 60e
parallèle.
Mais que dit exactement le traité ?
Ce que dit le traité de Rarotonga
Traité sur la zone dénucléarisée du Pacifique Sud et de ses trois protocoles
(Rarotonga, 6 août 1985)
PRÉAMBULE
Les Parties au présent Traité, unies dans leur engagement en faveur d’un monde pacifique, (…) gravement
préoccupées par le fait que la poursuite de la course aux armements nucléaires comporte le risque d’une guerre
nucléaire, (…) convaincues que tous les pays ont l’obligation de ne négliger aucun effort pour atteindre l’objectif
de l’élimination des armes nucléaires,
S’inspirant de la décision du quinzième Forum du Pacifique Sud, à Tuvalu, selon laquelle une zone dénucléarisée
devrait être crée dans la région
Sont convenues de ce qui suit :
Chaque Partie s’engage à :
- ne pas fabriquer ni acquérir d’une autre manière, posséder ou exercer un contrôle sur tout dispositif explosif
nucléaire par quelque moyen et en quelque lieu que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la Zone
dénucléarisée du Pacifique Sud (art. 3) - ne pas rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication ou l’acquisition de tout dispositif explosif
nucléaire (art. 3) - ne pas fournir de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux ou de l’équipement ou du matériel
spécialement conçu et préparé pour traiter, utiliser ou fabriquer des produits fissiles spéciaux à des fins
pacifiques (art. 4) - empêcher le stationnement de tout dispositif explosif nucléaire sur son territoire (art. 5)
- empêcher l’essai de tout dispositif explosif nucléaire sur son territoire (art. 6)
- ne pas immerger de déchets radioactifs ou d’autres matières radioactives en quelque lieu que ce soit à
l’intérieur de la Zone dénucléarisée du Pacifique Sud, empêcher l’immersion, par qui que ce soit, de décide
radioactifs (art. 7)…
Chaque Partie rendra compte au Directeur du Bureau de coopération économique pour le Pacifique Sud ("le
Directeur")… de tout événement de quelque importance survenant sous sa juridiction et ayant des incidences
sur l’application du présent Traité.
Le Directeur fera annuellement rapport au Forum du Pacifique Sud sur l’état du présent Traité (art. 9)
Le présent Traité est ouvert à la signature de tout membre du Forum du Pacifique Sud (art. 12).
2- Étude géopolitique du fonctionnement de l’interface océanienne : un exemple des relations Nord-Sud
Y a-t-il un fonctionnement géopolitique interne, propre à l’espace océanien ? Oui, assurément. Et l’on
verra qu’il est représentatif des relations Nord-Sud.
L’Océanie intertropicale : un monde éclaté et sous influence ?
Le Pacifique insulaire intertropical est un ensemble régional tiraillé entre sa volonté de regroupement
et les influences extérieures qui contribuent à son éclatement. Il n’en demeure pas moins qu’il se trouve
écartelé entre de multiples influences externes, ce qui a amené les géographes Benoît Antheaume et
Joël Bonnemaison à découper la région en quatre réseaux fonctionnant de façon autonome et ayant
chacun pour caractéristique d’entretenir des liens privilégiés avec une puissance du Nord. Ces réseaux
sont considérés selon les auteurs comme des "ensembles géographico-politico-culturels" qui
"contribuent à forger l’identité des populations qui les composent". Il s’agit des réseaux :
- australo-mélanésien
- zélando-polynésien
- franco-océanien (sic)
- américano-micronésien".
À ces réseaux dont l’existence est bien réelle, il convient de joindre d’autres systèmes comme le
Commonwealth qu’ont rejoint huit pays du Pacifique (Samoa, Tonga, Vanuatu, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Salomon, Tuvalu, Kiribati et Nauru), Fidji en ayant été exclu en 2006.
Qu’est-ce que le Commonwealth ?
"Le Commonwealth est une association bénévole de 53 États qui se consultent grâce à un réseau largement informel de liens
gouvernementaux et non gouvernementaux. Bien que la moitié de ses membres soient aujourd’hui de petits États comptant
moins d’un million d’habitants, le Commonwealth regroupe néanmoins près du quart de la population mondiale et du tiers des
membres des Nations unies…
En 1949, les membres du Commonwealth ont convenu que le monarque britannique devait être « le symbole de la libre
association des nations membres et, en tant que tel, chef du Commonwealth », indépendamment du fait qu’un pays membre
en fasse ou non son chef d’État. Élizabeth II est la reine du Canada, monarque des 14 autres « royaumes » parmi les 54 pays
membres, et chef du Commonwealth pour tous…
Le Commonwealth fait la promotion d’une série de valeurs communes à ses membres telles que l’égalité, la non-
discrimination, la démocratie et la primauté du droit. La Déclaration de Harare a reconnu l’importance particulière qu’il
accorde aux droits de la personne, à l’éthique démocratique, à l’égalité des sexes, au développement durable et à la protection
de l’environnement…
Au cours du temps, il s’est spécialisé dans certains domaines, ce qui lui a permis d’aider directement ses membres à faire face
à des problèmes communs ou particuliers. En effet, ceux-ci bénéficient de l’appui d’un vaste réseau d’organismes privés,
bénévoles et professionnels, comprenant entre autres des associations juridiques, médicales, d’universités et de
parlementaires, des professionnels et des organisations médiatiques et sportives…
La réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth a lieu tous les deux ans ; à cette occasion, les participants discutent
des grandes questions politiques, économiques et sociales, de leur incidence sur leurs pays respectifs et des mesures à
adopter, au sein du Commonwealth ou conjointement dans d’autres organes internationaux… Elles se déroulent chaque fois
dans un pays différent, le chef de gouvernement du pays hôte en assumant la présidence…
Les ministres des Finances du Commonwealth se rencontrent tous les ans ; les ministres chargés de la santé, de l’éducation, de
l’emploi, du droit et de la condition féminine se rencontrent eux aussi à intervalles réguliers.
Le Commonwealth n’a pas de constitution à proprement parler, mais il a des principes bien établis. La déclaration des
principes du Commonwealth, adoptée en 1971 par les chefs de gouvernement réunis à Singapour, spécifie que les États
membres doivent favoriser la paix et l’ordre dans le monde à l’appui de l’action de l’ONU, promouvoir des institutions
représentatives et des garanties juridiques de liberté individuelle, reconnaître l’égalité des races et la nécessité de combattre la
discrimination et l’oppression raciales, et s’appliquer à mieux répartir les richesses dans la société.

Tufuga Efi, Premier ministre de Samoa, à la droite de Robert Muldoon, Premier ministre de Nouvelle-Zélande, Ratu Sir Kamisese Mara,
Premier ministre de Fidji, troisième à partir de la droite, Michael Somare , Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, assis à gauche,
Fatafehi Tu’ipelehake, Premier ministre de Tonga, assis deuxième à partir de la droite, à la gauche de Malcolm Fraser, Premier ministre
australien, assis au centre.
(University of Melbourne)
L’Océanie intertropicale, un monde dépendant
Pour cette question, se reporter à l’Océanie en tant qu’interface (Michel Lextreyt), sur ce même site.
3- L’Océanie intertropicale vers le regroupement, illusion ou réalité ? Radioscopie des dynamiques internes
Deux analyses des années 1980
Seuls des facteurs et des interventions extérieurs tendent à unifier la zone : la poussée japonaise lors de la guerre du Pacifique
et la longue contre-attaque des Etats-Unis, qui créèrent au passage l’appellation régionale avec leur South Pacific Command
installé à Nouméa. La tutelle des six puissances coloniales qui formèrent en 1947 la Commission du Pacifique Sud,
aujourd’hui débordée par la multiplication des instances internationales dans la région. La persistance des essais nucléaires
français en Polynésie, qui provoque aujourd’hui une unité de refus diplomatique perceptible jusqu’en Asie. L’attitude
traditionnelle américaine en matière de droits de pêche, enjeu plus limité mais économiquement important, qui suscite
d’autres passions. Les incursions récentes de l’URSS dans la région donnent parfois l’apparence d’un véritable Kriegspiel
stratégique et d’un basculement potentiel de l’orientation internationale des micro-États, là où exploitation opportuniste et
attitudes disparates prédominent encore. Seule, la création du Forum du Pacifique Sud, en 1971, avec seize Etats
indépendants, depuis le continent australien jusqu’à Tuvalu (26 km²), peut être considérée comme un pas vers une relative
unité, au moins sur le plan diplomatique.
S’ils disposent d’une voix au sein de l’Assemblée générale des nations unies au même titre que le Chine ou les États-Unis,
ces États, pris isolément, éprouvent de nombreuses difficultés à traduire dans la réalité leur indépendance juridique. Ils se
révèlent par exemple incapables de faire respecter les droits qu’ils détiennent sur leur ZEE, conformément aux règles qu’ils
se sont fixées en 1977 au sein du Forum du Pacifique Sud, ne disposent dans leur grande majorité d’aucune force militaire et
dépendent encore largement de l’aide économique consentie par les anciennes puissances coloniales.
De ce fait, dès la fin des années 1960, ces États ont choisi la voie de la coopération régionale pour défendre plus efficacement
leurs intérêts et leurs droits face aux puissances extérieures à la région. Cette politique s’est traduite tout d’abord par la prise
de contrôle progressive de la CPS… puis par la création, en 1971, à l’initiative de Fidji, du Forum du Pacifique Sud…
Le Forum n’envisage pas le dé veloppement d’une quelconque intégration politique au profit d’une autorité supranationale. Il
est une tribune politique qui défend le concept d’identité du Pacifique-Sud à travers la défense de certains thèmes
unificateurs : la décolonisation complète de la zone…, le refus du nucléaire (création de la troisième zone dénucléarisée de la
planète – traité de Rarotonga en 1985)…
Mais cette politique de coopération régionale ne parvient pas à masquer l’existence de profonds désaccords politiques
internes ni à atténuer le persistance de très fortes dépendances économiques.
L’accession à l’indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Salomon, de Kiribati et de Vanuatu s’est accompagnée
de l’émergence d’une sorte de solidarité mélanésienne défendant des positions beaucoup plus radicales que les États
polynésiens, traditionnellement plus conservateurs. Beaucoup plus soucieux de faire respecter leur ZEE contre le pillage des
thoniers américains, porteurs d’un discours antinucléaire particulièrement virulent et désireux de combattre toutes les formes de néocolonialisme dans la région, quitte à dénoncer celui de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, les États mélanésiens
n’hésitent plus à contester les positions jugées trop pro-américaines de Fidji ou de Samoa…
Au-delà de ces antagonismes, les États du Pacifique-Sud restent confrontés à un grave problème de dépendance économique.
Malgré la création au sein du SPARTECA d’un régime de préférence généralisée et non réciproque destiné à ouvrir plus
largement les marchés australien et néo-zélandais aux productions des pays insulaires, leur développement économique
semble de plus en plus dépendre des aides accordées par ces deux pays au moment où ceux-ci se révèlent de moins en moins
capables de faire face à leurs engagements financiers…Cette situation pousse la plupart des micro-États à tenter de négocier
chacun de leur côté des contrats de pêche, y compris avec l’URSS (Kiribati, Vanuatu…).
L’Océanie intertropicale, vers le regroupement ?
Les relations entre les micro-États océaniens sont insuffisamment développées. Ceci est la
conséquence directe de l’insularité : l’éloignement, l’isolement, l’omniprésence de la mer, l’exiguïté
des territoires auxquels il faut ajouter des ressources fragiles et non complémentaires rendent les
échanges ou la coopération difficiles.
Pourtant, le sentiment d’appartenance à un ensemble océanien plus ou moins homogène qui se
démarque des influences extérieures est bien présent. Ces pays ont un passé commun. Passé lointain
qui les relie pour la plupart à la même souche austronésienne, passé colonial plus récent et maintenant
premières expériences d’émancipation. Ces pays ont aussi les mêmes souffrances, doivent affronter les
mêmes difficultés. La géographie, avec les contraintes communes de l’isolement et de l’insularité se
joint à l’histoire pour construire un fonds commun de reconnaissance.
La situation devient paradoxale. Ces pays vivent de et par l’extérieur qui alimente l’essentiel de leurs
budgets, mais ils multiplient par ailleurs les tentatives de regroupements, à l’impact souvent marginal
mais à la symbolique très forte.
Des organisations régionales tentent de donner corps à une entité océanienne
Par le regroupement au sein d’organismes comme la Communauté du Pacifique ou le Forum, les pays
de la région cultivent l’appartenance à une même communauté d’intérêts et espèrent être plus forts vis-
à-vis de l’extérieur. La plupart de ces organisations se retrouvent dans le CORP, le Conseil des
organisations régionales du Pacifique, qui comprend le Secrétariat de la Communauté du Pacifique, le
Secrétariat général du Forum, la FFA, le PIDP, le PROE, la SOPAC, l’USP et quelques autres…
Des espaces régionaux autonomes dans le Pacifique ?
La notion d’espace régional dans le Pacifique apparaît de façon précise avec la création de la Commission du Pacifique Sud*
(CPS) en 1947 lorsque les six puissances coloniales occidentales du bassin décidèrent de se doter d’une instance
institutionnelle visant à promouvoir le développement socio-économique dans les territoires insulaires sous leur tutelle
respective. S’interdisant de traiter des questions d’ordre politique, la CPS devint une instance quelque peu anachronique dès
que se mit à souffler, à partir de 1960, le vent des indépendances.
En 1971, les micro-Etats indépendants et l’archipel des îles Cook fondent parallèlement à la CPS le South Pacific Forum**
auquel ils invitent l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Non seulement dans cette enceinte il sera possible d’évoquer et de
traiter de questions à caractère politique comme les essais nucléaires effectués par la France en Polynésie ou des mouvements
de décolonisation d’autres entités insulaires, mais aussi de définir les priorités à donner au développement socio-
économique… En 1972, le Forum se dote d’un levier économique, le South Pacific Bureau fir Economic Cooperation
(SPEC) pour coordonner les diverses actions décidées parmi ses membres…
En se rattachant au Forum, l’Australie et la Nouvelle-Zélande accroissent leur statut de grands frères.
L’annuaire des institutions régionales du Pacifique indique l’existence de près de 200 organisations à caractères
gouvernemental, religieux, culturel, sportif, scientifique ou commercial, reflétant nettement le dynamisme de la coopération
régionale collective. Sans doute faut-il y voir le désir de briser les isolements insulaires et de mettre en commun les
ressources humaines, culturelles, économiques afin d’accroître le sentiment de communauté du Pacifique insulaire…
Ancien centre de l’empire britannique dans le Pacifique, Fidji a su tirer profit de la formation de ses élites et de son statut
d’indépendance acquis en 1970 pour attirer à Suva la plupart des organismes régionaux et institutions internationales.
*Aujourd’hui Communauté du Pacifique
** Aujourd’hui Forum des îles du Pacifique
La CPS, ou Commission du Pacifique Sud, est la plus ancienne de ces institutions. Fondée en 1947, elle a pris en 1998 le
nom de Communauté du Pacifique. C’est la seule organisation qui comprend l’ensemble des pays de la région (19 États et 8
territoires sous tutelle), indépendants ou non, francophones ou anglophones. Son siège est à Nouméa. Il s’agit d’un organisme
de coopération technique chargé de financer des programmes de développement à partir de crédits provenant essentiellement
de l’Australie, de la France, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis, voire de l’Union européenne.

Le Forum des îles du Pacifique (ex Forum du Pacifique Sud) regroupe les chefs de gouvernement de tous les pays indépendants ou en self government du Pacifique insulaire autour de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Créé en 1971, il
est une véritable tribune dans laquelle chacun exprime ses vues sur l’évolution politique et les perspectives économiques de
la région. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ont pu y être invitées à titre d’observatrices. Les seize pays du
Forum sont l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les îles Cook, les États fédé rés de Micronésie, Fidji, Kiribati, Nauru, Niue,
Palau, la PNG, les îles Marshall, Samoa , les îles Salomon, Tonga, Tuvalu et le Vanuatu.
La Forum Fisheries Agency, ou Agence des pêches du Forum (FFA) a été créée en juillet 1979 dans le but premier
d’assurer la surveillance et la gestion des stocks de poissons dans les eaux territoriales des petits pays du Pacifique. Le
premier objectif poursuivi par la FFA, dont le siège est à Honiara (îles Salomon) est d’aider les pays signataires à négocier
leurs droits de pêche, puis de trouver les moyens pour faire respecter les accords et assurer l’inviolabilité de leurs eaux
territoriales. De fait, ce contrôle ne peut guère être assuré qu’avec le concours des puissances extérieures (Australie ou
Nouvelle-Zélande). Les récents progrès de la télédétection permettent à présent de mieux surveiller la zone.
Le PIDP (Pacific Island Development Program ou Programme de développement des îles du Pacifique) est une émanation
de l’East-West Center, créé en 1960 par le Congrès étasunien dans le cadre de l’aide des États-Unis aux pays d’Asie et du
Pacifique. Le PIDP quant à lui a été créé en 1980. Il est officiellement chargé de promouvoir la qualité de vie dans les îles du
Pacifique en promouvant l’éducation et la recherche. Il est essentiellement financé par les États-Unis.
Le PROE (Programme régional océanien de l’environnement), ou SPREP (South Pacific Regional Environment Program)
Le PROE est une émanation du Secrétariat de la Communauté du Pacifique. Il est une organisation intergouvernementale
chargée d’appuyer les efforts de protection et d’amélioration de l’environnement du Pacifique insulaire et de favoriser son
développement durable. Son siège est à Apia. Il regroupe tous les pays de la CPS, ainsi que l’Australie, la Nouvelle-Zélande,
la France et les États-Unis.
La SPTO (South Pacific Tourism Organisation) est chargée de coordonner la promotion touristique pour les pays du
Pacifique.
La SOPAC (South Pacific Applied Geoscience Commission), est une organisation intergouvernementale ayant pour objet
l’aide au développement durable. Cette organisation, basée à Suva, est financée par l’Australie, les îles Fidji, la France, le
Japon, la Nouvelle-Zélande, l’Irlande, l’Union européenne…
L’Université du Pacifique Sud (South Pacific University – SPU) est une création originale. Implantée en 1968 à Suva
(Fidji), elle est l’émanation de douze États du Pacifique central qui, isolément et mis à part Fidji, ne pouvaient prétendre à
mettre en place une structure universitaire de ce calibre. Ces États contribuent financièrement à son fonctionnement,
fournissent des enseignants et y envoient leurs étudiants. L’Australie et la Nouvelle-Zélande participent elles aussi à cette
entreprise dans le cadre de leur aide technique par une aide financière et l’envoi d’enseignants
En marge de ces différentes organisations, on peut encore citer l’APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), une alliance
commerciale entre les grands pays d’Asie et d’Océanie et où l’on retrouve l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la PNG.
Sport et culture : vers une identité océanienne ?
Les initiatives dans le domaine du sport et de la culture sont le fait d’organisations régionales de
mieux en mieux structurées et donc de plus en plus efficaces.
- La culture, le sport et les loisirs prennent une part non négligeable dans les échanges à l’intérieur du
monde océanien. Ils contribuent fortement à rassembler autour d’objectifs communs des pays qui par
ailleurs ont du mal à se rencontrer à cause de leur éparpillement et de leur isolement. La Nouvelle-
Zélande et l’Australie, à des degrés divers et suivant les circonstances s’impliquent par des aides à la
fois financières et techniques, dans ces manifestations dont le cœur demeure le monde océanien
tropical insulaire. C’est ainsi que tous les petits pays océaniens se retrouvent à intervalles réguliers au
sein de deux manifestations majeures : le Festival des Arts océaniens et les Jeux du Pacifique Sud.
- Le Festival des Arts est né du souci de lutter contre la disparition progressive des pratiques coutumières et traditionnelles.
Patronné par le Conseil des Arts du Pacifique, qui est une émanation de la Communauté du Pacifique, il est organisé tous les
quatre ans depuis 1972 et permet aux Océaniens de se réunir pour un moment de partage et d’échanges culturels. On retrouve
là non seulement les petits pays insulaires océaniens, mais aussi les Maoris de Nouvelle-Zélande et les Aborigènes
d’Australie. Les Hawaiiens, bien que n’étant pas membres de la Communauté du Pacifique, sont aussi régulièrement invités
en tant que Polynésiens. Le Festival est financé sur fonds de la Communauté du Pacifique, du Forum, ainsi que sur des
crédits débloqués par l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou l’Union européenne. Il s’agit d’un rendez-vous majeur qui
contribue fortement au maintien d’une unité culturelle océanienne et au rapprochement de ces peuples. C’est une occasion
également pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande de replonger dans les racines de leur peuplement originel.
- Les Jeux du Pacifique sont devenus une institution dans la région. Ils ne concernent que les pays insulaires océaniens, qui se
rencontrent entre eux, mais l’Australie et la Nouvelle-Zélande ne sont pas absents pour autant. Ils assurent une participation
financière et fournissent des cadres techniques pour leur organisation. Créés officiellement en 1961, à l’initiative des
Fidjiens, ils avaient pour objectif « [d’] assurer la promotion et le développement de la pratique du sport amateur, [et de]
créer des liens d’amitié fraternels entre les peuples et les différentes régions du Pacifique Sud ». La première édition a eu lieu
à Suva en 1963. Depuis, ils se sont déroulés tous les trois, puis quatre ans. Ils sont devenus une énorme entreprise, le nombre
de participants (et d’accompagnateurs) étant de plus en plus important. Si le Festival des Arts a rassemblé environ 2 000
personnes dans sa dernière édition à Palau, les derniers Jeux du Pacifique qui se sont déroulés à Suva en 2003 ont accueilli
plus de 4 000 athlètes et officiels. Ils ont nécessité la construction d’installations sportives de haut niveau et donc un
engagement financier très important. Tous les pays insulaires océaniens y étaient représentés. De tels jeux, désormais, ne
peuvent être organisés que par les grandes entités de la zone. Les pays plus petits peuvent se contenter des « mini-jeux », qui
ont lieu dans l’intervalle et qui sont limités en nombre de disciplines et donc de participants. On notera que d’autres
rencontres sportives, les Océania, spécifiques à chaque sport, sont organisées au niveau de la région, impliquant directement
cette fois-ci l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
++++
LES DÉFIS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
Quel choix de développement pour les pays indépendants de l’Océanie intertropicale ?
Ce que nous demandent les textes :
– L/ES/S : on analyse les difficultés économiques et sociales auxquelles les États no uvellement indép endants sont
confrontés (contextualisation)
– STG : on montre que les nouveaux États indépendants sont confrontés à des défis économiques (lutte contre la
pauvreté, développement (A - contextualisation) / On met en évidence les choix des pays en matière de
développement, les résultats obtenus (B - étude de cas)
– ST2S : (A- pour l’Afrique sub-saharienne) on étudie les défis économiques (mise en œuvre d’un mode de
développement, intégration à l’économie internationale, rapports à l’ancienne puissance coloniale) et sociaux
(transition démographique, différentiels entre groupes sociaux, urbanisation) que doivent relever les nouveaux
États indépendants / On montre quelles sont les difficultés auxquelles les États (océaniens) ayant accédé à
l’indépendance sont confrontés aujourd’hui (B – étude de cas).
Problématiques :
À quelles difficultés économiques et sociales les États
indépendants d’Océanie intertropicale sont-ils confrontés
aujourd’hui ?
Quels défis économiques et sociaux les États indépendants
de l’Océanie intertropicale doivent-ils relever ?
Notions et concepts, mots-clés :
Terres aliénable, inaliénables, corruption, niche
économique, paradis fiscal, blanchiment
d’argent, rente stratégique, resort, MIRAB, remittances, AusAid, NZAid, FED, politique
d’ajustement structurel
Note importante : on consultera avec intérêt, sur cette question et sur ce même site, la mise au
point proposée sur l’Océanie intertropicale en tant qu’interface. On pourra consulter également le
site de la Commission européenne (suivre l’arborescence : développement – partenariat géographique
– choix de pays).
Les États indépendants d’Océanie sont des pays pauvres, mais pas misérables. On n’y meurt pas de
faim et la faiblesse des structures urbaines fait qu’il n’y a pas trop de déclassés. L’entraide fonctionne
encore au sein des familles élargies. C’est le côté positif d’une coutume encore très présente et souvent
bloquante, mais qui garantit à la société une certaine stabilité et une relative sécurité. On doit donc se
garder de toute analyse catastrophiste qui ne prendrait en compte que les données statistiques,
effectivement préoccupantes mais ne reflétant pas toujours la réalité. On sait par exemple combien il
faut se méfier des indicateurs de niveau de vie comme le PNB/hab., la référence la plus fréquemment
utilisée dans les pays du tiers-monde, faute de pouvoir disposer d’un IDH fiable.
Par ailleurs, il serait contre-productif de vouloir opposer des pays indépendants dont on mettrait en
exergue les difficultés à des pays autonomes dont on vanterait le haut niveau de vie. Une telle
démarche conduirait à des conclusions hâtives, non dénuées de coloration politique, et qui là aussi ne
reflèteraient pas la réalité du terrain. On ne peut jauger sans risque une société de pays en
développement en la rapportant aux standards de vie occidentaux.
Ceci dit, le bilan économique et social de ces pays n’est pas bon et il faudra essayer d’en comprendre
les raisons.
1- Défi démographique et problèmes sociaux
Des États en pleine transition démographique
Tous les pays indépendants de l’Océanie intertropicale se trouvent en pleine transition démographique.
Ils ont aujourd’hui, mais depuis peu, quitté la phase 1 (très forte natalité et mortalité relativement faible) pour entrer à des degrés divers dans la phase 2 (une natalité qui se met à baisser). La plupart
pointent à des taux de natalité situés entre 35 et 25 ‰ et leur taux d’accroissement naturel demeure
élevé (autour de 20 ‰). Les pays mélanésiens, très ruraux et où la terre ne manque pas, peuvent plus
ou moins absorber une telle augmentation de population. Il n’en est pas de même des pays polynésiens
qui ont largement recours à l’émigration. Des indicateurs, enfin, révèlent une situation sanitaire
inquiétante. Ainsi, le taux de mortalité infantile dépasse les 50 ‰ en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux
îles Salomon et au Kiribati, alors que l’espérance de vie de ces trois pays est respectivement de 54, 61
et 60 ans… On notera cependant que des pays affichent des résultats beaucoup plus positifs, comme
les Palaos ou Tonga.
Enfin, d’une manière générale, les pays océaniens demeurent des pays très ruraux, si l’on veut bien
oublier Nauru, qui est un cas très particulier. Moins de 20 % de population urbaine (PNG, Salomon),
c’est excessivement peu. Vanuatu, les ÉFM ou Samoa sont guère mieux lotis (21 à 22 %). Ces taux
trahissent un développement économique rudimentaire dans lequel l’agriculture traditionnelle, de
subsistance, est dominante.
(1) Les chiffres concernant le PNB/hab. sont très aléatoires d’une source à une autre. Il convient de les manier avec précaution.
• 52 (Vanuatu), 60 (Marshall), selon d’autres sources ;
• (1) Les années de référence varient entre 1999 et 2007 suivant les pays
Sources croisées : CPS, Banque mondiale, Index mundi (CIA), OMS, FMI
Des États malades, qui souffrent de malnutrition
La couverture médicale rudimentaire et les carences dans l’information et l’éducation des populations
ne permettent pas une bonne protection contre les épidémies ou certaines maladies comme le Sida.
Les maladies rôdant dans le Pacifique sont légion : le trio Sida-tuberculose-paludisme est le principal responsable d’une
surmortalité dans certains pays (la Papouasie a été victime d’une grave épidémie de paludisme en avril 2006 : 137 morts dans
seulement quatre villages des hauts plateaux). Maladies auxquelles il convient d’ajouter les deux affections typiques des pays
pauvres (typhoïde et choléra), les infections par vecteur, en plus du palu (les dengues, par le biais des moustiques, la
leptospirose), les infections respiratoires hors la tuberculose déjà citée (les grippes et le SARS) et enfin les maladies que des
vaccins évitent (rougeole, rubéole et hépatite B). Mentionnons une grave épidémie de rougeole à Fidji en avril 2006…
Le paludisme (ou malaria) est une maladie endémique dans trois pays : la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Vanuatu et les îles
Salomon… En Papouasie, le « palu » avait tué 500 personnes en 1992. Il en a tué 647 en 2002…
La tuberculose est la maladie par excellence sanctionnant le relâchement des normes sanitaires ou accompagnant
l’appauvrissement d’un pays. Elle est bien plus virulente dans les pays indépendants de l’Océanie insulaire.
Au niveau du Sida, « très clairement, explique un médecin australien, la Papouasie est confrontée aujourd’hui à une situation
comparable à ce qu’il y a de pire en Afrique centrale, et nous ne faisons que commencer à prendre la mesure du
problème »…
Si l’on ne meurt pas de faim en Océanie, on se nourrit rarement convenablement. Les pays les plus
riches (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Guam) sont touchés par le diabète, l’obésité, les
maladies cardio-vasculaires. Les pays les plus pauvres quant à eux sont confrontés à la malnutrition.
Il est rare, dans nos régions baignées par la mer et souvent arrosées par d’abondantes pluies, qu’un peu de pêche et de
cueillette ne permette pas de vaincre la faim. Il n’empêche, la pauvreté extrême et la malnutrition sont des réalités en
Océanie. Les petits pays insulaires indépendants en sont les victimes…
On peut considérer que dans les petits États indépendants de la région, 28,5 % de la population vivent en dessous du seuil de
pauvreté…. Les statistiques de prévalence du manque de poids chez les enfants de moins de cinq ans font apparaître (en
2002) des difficultés dans neuf pays : Micronésie (15 %), Kiribati (13 %), Marshall (27 %), Papouasie-Nouvelle-Guinée (25
%), Salomon (21 %), Vanuatu (12 %)… Ces carences de poids vont de pair avec des carences en sels minéraux et vitamines :
le développement physique et intellectuel de ces populations s’en trouve ralenti …
À noter que ces pourcentages sont très en-deçà de la réalité pour tous ces pays : ces cas de malnutrition ont en effet été
recensés à partir du nombre d’enfants hospitalisés, ce qui sous-entend l’existence d’hôpitaux. Ce n’est pas le cas sur la
majeure partie du territoire des Salomon, de la Papouasie, du Vanuatu…
Et le statut des femmes ?
Beaucoup de pays de l’Océanie insulaire sont encore enfermés dans des types de relations hommes /
femmes d’un autre âge, en particulier dans le monde mélanésien, où l’on continue dans bien des cas à
acheter sa femme, ou ses femmes. C’est le lourd héritage de sociétés bloquées par la coutume et donc
par le poids des Anciens, terriblement conservateurs en matière sociale. Les Églises de leur côté n’ont
souvent fait qu’enfoncer le clou en promouvant l’archétype de la femme soumise donneuse d’enfants.
Quand on plonge dans les pays pauvres de la région, on tombe dans un univers où le statut de la femme est souvent celui d’un
être entièrement soumis à la domination de l’homme… La femme y est encore souvent un objet de troc , une marchandise,
réduite à des activités agricoles et domestiques, avec pour principale mission d’assurer la reproduction. Le tout sur fond de
soumission et d’obéissance à ses « maîtres », pères et frères d’abord, mari et autres membres de la belle-famille ensuite.
Bien sûr, les seuls dominants de clans ne détiennent pas forcément tous les pouvoirs. Ici et là, les religions nouvelles sont
venues diluer l’autorité des chefs, mais bien souvent à défaut du chaman d’hier c’est le pasteur qui décide de la sexualité des
femmes dans sa paroisse. Régulation des naissances, planning familial, contraception sont des mots qui ne font qu’apparaître
encore timidement dans de nombreuses régions d’Océanie. La situation la plus critique est celle de la femme mélanésienne,
soumise à la coutume, à la religion, à l’homme en général…
En Micronésie comme en Polynésie, force est de constater que la liberté de manœuvre laissée aux femmes est un peu plus
large, même si elle demeure très relative… En Micronésie, le rôle de la femme est différent puisque ces sociétés sont basées
sur un système de matriarcat encore vivace, la terre se transmettant par la femme…
On notera toutefois que le statut de la femme est en train d’évoluer dans la plupart des pays océaniens.
Sinon, comment expliquer la baisse très rapide des taux de natalité dans l’ensemble de la région (ils se
situent entre 25 et 35 ‰ en 2008 – voir plus haut) ?
2 – Les handicaps au développement économique
Si les pays océaniens connaissent pour la plupart des difficultés au niveau du développement
économique, c’est qu’ils sont sortis trop précipitamment de la colonisation. Au lendemain des
indépendances, ils se sont trouvés avec des infrastructures rudimentaires, des richesses pillées, une
classe politique restreinte, un environnement technologique dramatiquement insuffisant, des structures
sociales n’autorisant que peu d’ouverture sur le monde moderne et marquées par de profondes
inégalités, une situation financière catastrophique… Ils ne pouvaient s’inscrire, finalement, que dans la
continuité de leur statut colonial : des pays exploités victimes des échanges inégaux nés de la
mondialisation. De ce terrible constat, on fera ressortir quelques handicaps majeurs, sans avoir la
prétention d’être exhaustif.
Le problème foncier
Un des grands obstacles au développement, c’est le problème foncier. Le respect de la société
traditionnelle et donc de la coutume amène à vouloir préserver coûte que coûte le droit
communautaire, au détriment parfois de certaines opérations économiques créatrices de richesses et
d’emplois. Ces blocages ont pu éviter certaines spoliations foncières excessives ou de réelles atteintes
à l’environnement, mais dans bien des cas elles n’ont été motivées que par un conservatisme social qui
ne trouve pas sa place dans le monde d’aujourd’hui.
L’obstacle foncier en PNG
La propriété foncière se divise en deux catégories distinctes en PNG. La terre inaliénable, dite coutumière, possédée et
contrôlée par les communautés indigènes selon leurs coutumes et la terre aliénable, qui a été délaissée par ses propriétaires
traditionnels au bénéfice de personnes qui n’avaient aucun droit originel à leur égard. La terre aliénable représente 3 %
seulement du foncier. Elle peut être nationalisée ou privée.
Dans les années 1950, l’entrave que représentait la terre coutumière à l’égard des initiatives économiques prises par les
planteurs et l’administration coloniale australienne fut considérée comme un obstacle trop important pour être toléré. En
1952, fut votée une loi ayant pour but de permettre au gouvernement d’acquérir des terres pour des objectifs publics. La
même année, une commission des terres indigènes fut chargée d’enregistrer les droits des propriétaires traditionnels. Cela se
révéla impossible et ne furent finalement enregistrées que les terres aliénées. En 1964, une nouvelle loi foncière reprit ce
dossier et exprima la volonté de l’administration coloniale de convertir le foncier collectif en propriétés privées. On fit en
sorte que la propriété privée de la terre devienne une condition indispensable pour obtenir des arrangements en matière de
crédit… Mais au moment de l’indépendance, la plupart des terres sont toujours coutumières.
Résistances populaires à la privatisation des terres
La stratégie néolibérale en PNG se trouve en fait freinée par l’ampleur des terres qui échappent au droit capitaliste et relèvent
de systèmes ancestraux de propriété communautaire, bloquant l’essor du secteur privé. Car la terre n’y fait
qu’exceptionnellement l’objet d’une appropriation privée. Les systèmes fonciers se fondent, non sur la propriété individuelle,
mais sur l’usage indivis des sols. Leur propriété appartient aux communautés rurales qui y vive nt...
Si les liens de parenté ouvrent en général droit à leur usage (pas forcément égalitaire), la participation à des travaux collectifs
peut suffire à recevoir des parcelles à cultiver. L’individu à qui la terre est affectée devient un gestionnaire temporaire de la
propriété de l’ensemble du lignage, sans en disposer librement, car il lui est impossible de la vendre, la louer ou en disposer
en dehors du cadre coutumier. Cette affectation détermine, par des règles spécifiques variant selon les groupes, toute une
gamme de droits relatifs à l’usage des ressources qui en dérivent.
Ces droits d’usage posent bien sûr des problèmes aux autorités, notamment lorsqu’il s’agit de construire des ouvrages
d’infrastructures. La solution en général adoptée consiste à verser des « compensations » aux propriétaires communautaires.
Le trait original de la PNG est que les terres collectives couvrent encore… 97% du territoire national !
Les systèmes traditionnels restent d’une extraordinaire vivacité, malgré les pressions exercées par les transnationales et le
FMI pour privatiser les terres.
En théorie, toutes les transactions foncières doivent être effectuées par le biais de l’État, seul autorisé à acheter et à louer des
terres communautaires. Mais en pratique, ce dernier ne préserve les droits coutumiers que là où il n’y a pas eu de ressources
naturelles découvertes. Partout ailleurs, il s’empare du sol pour en céder l’exploitation au capital étranger, avec tout ce qui lui
est attaché, au-dessus, les forêts, et au-dessous : le cuivre de Bougainville, où l’État papouan-néo-guinéen vola au secours de
Rio Tinto et choisit la guerre contre les populations locales ; le cuivre de Ok Tedi dans les Star Mountains, fief de la
transnationale australienne BHP ; l’or de Lihir, le plus vaste gisement aurifère du monde hors d’Afrique du Sud ; mais aussi
le nickel de Madang ; et bien sûr le pétrole…
Face aux pressions des bailleurs de fonds pour la poursuite de l’enregistrement de terres, l’État a constitué en 2001 un groupe
d’experts chargés de rédiger un projet de loi sur la privatisation des terres coutumières, avant de reculer devant la révolte du
peuple. Alternant âpres négociations sur le montant des dédommagements et répression des manifestants, il promeut l’essor
de l’investissement des capitalistes étrangers, mais promet en même temps la protection légale aux indigènes.
Les résistances à la privatisation des terres e n PNG n’ont cessé de s’amplifier au cours des dernières années. Le cas du conflit
de Bougainville a assurément ouvert une brèche dans laquelle se sont engagés depuis nombre de groupes pour faire valoir
leurs droits auprès des transnationales et de l’État. Les « réformes » du statut des terres coutumières sont au cœur de la
plupart des mobilisations populaires organisées dans le pays
Ces résistances sont bien plus que des crispations sur un passé archaïque auxquelles on voudrait les réduire. Elles expriment
la défense du droit tout à fait fondamental d’accès à la terre et de son usage collectif pour le bien-être de communautés qui
sont agressées par le néolibéralisme. Elles traduisent une révolte contre les crimes écologiques causés par le pillage et les
activités polluantes des transnationales. Elles s’articulent d’ailleurs sur des revendications plus globales, hostiles aux
politiques d’ajustement structurel (PAS) du FMI.
À la fin du mois d’avril 2007, une forte mobilisation des communautés pour la défense de leurs droits inalénables conduisait
à la fermeture de la gigantesque mine d’or de Porgera dans la province de l’Enga…
Le problème des déviances politiques : corruption, protection, favoritisme…
La plupart des pays nouvellement indépendant ont connu des affaires de corruption plus ou moins
graves. Les hommes au pouvoir ont trop souvent confondu bien public et bien privé. Détournements
d’argent, emplois familiaux ou réservés aux « amis », achats de voix pour les élections, protection
contre la justice sont monnaie courante dans beaucoup de pays de la région (pas forcément
indépendants d’ailleurs). C’est que l’on fonctionne beaucoup, en Océanie, selon le principe du don /
contre-don. L’homme politique au pouvoir n’est fort et respecté que s’il redistribue. Ces pratiques
d’un autre temps sont sclérosantes pour l’économie et la société : tout l’argent ne va pas où il devrait
aller et des personnes parfois incompétentes occupent des postes qui leur ont été accordés par
favoritisme. L’économie ne peut bien tourner ainsi. Quelques affaires sont symptomatiques de ces
pratiques illicites.
Le classement des pays selon leur degré de corruption
Selon Transparency international (« the global coalition against corruption »), les pays océaniens sont très largement
touchés par la corruption. Sur les 178 pays répertoriés, on note que Samoa, le meilleur élève ( ?) arrive au 57e rang, Kiribati
au 84e, Vanuatu au 98e , les îles Salomon au 111e , la Papouasie-Nouvelle-Guinée au 162e et Tonga au 175e !
On notera que Fidji n’a pas été classé.
Attention, corruption…
Le règne sans partage du HRPP n’empêcha pas la corruption et le système clientéliste de perdurer. C’est ainsi qu’en 1999,
pour le 20e anniversaire de la création du HRPP, Luagalau Levaula Kamu, ministre des travaux publics du gouvernement
Malielegaoi, fut assassiné en pleine cérémonie commémorative. Son assassin, Eletise Leafa Vitale, n’était autre que le fils de
Leafa Vitale, lui-même ancien ministre des travaux publics et prédécesseur à ce poste de Luagalau Levaula Kamu. Il avait été
remercié de son portefeuille de Ministre quelques mois plus tôt suite à un scandale de détournement de fonds publics que sa
victime avait justement dénoncé. L’enquête confirma que Leafa Vitale était bien le commanditaire du meurtre. Il s’avéra
également que Toi Akuso, membre du HRPP et ancien Ministre des postes, était également impliqué dans le complot.
L’affaire Moti et les relations tendues entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l’Australie
En 2006, les relations entre les deux pays [Papouasie-Nouvelle-Guinée et Australie] empirent suite à "l’affaire Moti". Le 29
septembre, la police papoue arrête Julian Moti, un avocat d’origine fidjienne proche du premier ministre salomonais
Manasseh Sogavare. L’arrestation se fait à la suite d’une demande d’extradition formulée par l’Australie. Moti a été accusé de
viol sur mineure au Vanuatu en 1997, mais rappelle qu’il a déjà été innocenté par un tribunal ni-Vanuatu en 1999. Moti n’est
pas immédiatement incarcéré, et se réfugie au Haut-commissariat salomonais à Port Moresby. Le 10 octobre, il s’envole vers
les îles Salomon à bord d’un avion militaire papou, ce qui provoque une réaction furieuse de la part de l’Australie. Le
gouvernement australien annule une visite programmée de Somare en Australie, et déclare que les principaux ministres
papous, dont Somare, sont dorénavant interdits d’accès au territoire australien. Somare nie avoir autorisé l’utilisation d’un
appareil militaire pour permettre à Moti de quitter la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pourtant, un rapport commandé par un juge
papou affirme que Somare et Sogavare auraient orchestré ensemble la fuite de Moti. S’en suit un bras de fer entre Somare et
la justice papoue
En décembre 2007, le nouveau premier ministre australien Kevin Rudd rencontre Michael Somare à Bali. Les relations
papou-australiennes "ont traversé une période très difficile récemment", remarque Rudd, qui souhaite tourner la page et
normaliser ces relations
L’insécurité
L’insécurité est un élément bloquant pour le développement économique dans la mesure où les
investisseurs hésitent à s’engager dans des pays qu’ils jugent peu sûrs. Dans ce domaine là aussi, la
Papouasie tient la corde…
Recommandations importantes :
La capitale, Port Moresby, ainsi que deux villes (Mount Hagen et Lae) connaissent l’insécurité (agressions à main armée,
vols, cambriolages). Les grandes îles du Nord (Nouvelle-Bretagne et Nouvelle-Irlande) sont plus sûres, mais des vols peuvent
se produire. La violence est présente dans les bidonvilles.
Eviter de se promener seul, à pied en ville après 18h00 (nuit tombée), notamment pour une femme.
La nuit (18h00 - 6h00) préférez circuler en convoi sur les routes de la capitale, portières verrouillées.
Ne pas utiliser les transports en commun, ni les taxis après 16 heures (les grands hôtels ont des bus pour l’aéroport).
Ne pas circuler dans les faubourgs des villes, ni dans les collines environnantes.
Ne pas suivre quelqu’un qui se propose comme guide s’il n’est pas connu de vous.
En arrivant à Port Moresby, prendre contact avec l’ambassade.
Eviter les rassemblements de foule.
L’Australie intervient pour rétablir l’ordre en Papouasie Nouvelle-Guiné e
PORT MORESBY (AFP), le 12-08-2004
L’Australie se lance dans une nouvelle intervention dans le Pacifique pour ramener l’ordre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un
des endroits les plus dangereux du monde. De premiers éléments de la police et de l’administration ont commencé à arriver
cette semaine dans cette île du Pacifique où un total de 230 policiers et une soixantaine de fonctionnaires sont attendus au
cours des trois prochains mois pour lutter contre la criminalité, la corruption et la mauvaise gouvernance. L’opération qui doit
durer cinq ans et coûter 900 millions de dollars australiens (640 millions de dollars US) s’inscrit dans la politique
interventionniste du Premier ministre conservateur John Howard qui veut sortir un certain nombre de pays de la région d’une
situation de crise favorisant le crime organisé et le terrorisme. Après le Timor oriental et, l’an dernier, le déploiement de plus
de 2.000 hommes aux îles Salomon en proie à la guerre civile, c’est maintenant le tour de la Papouasie, avec le soutien des
autorités locales. Mais des responsables australiens reconnaissent que la tâche sera plus difficile dans cette ancienne colonie
de Canberra de plus de cinq millions d’habitants.
"C’est très diffèrent de la mission aux Salomon et il faudra beaucoup plus de temps pour obtenir des résultats", déclare un
diplomate australien participant à l’opération. Les problèmes vont de la répression de puissants gangs qui font régner la
terreur à Port Moresby et dans d’autres villes, aux affrontements tribaux sur les hauts plateaux, en passant par le séparatisme
sur l’île de Bougainville. La Papouasie est riche en ressources naturelles — on l’a parfois décrite comme une montagne d’or
flottant sur un océan de pétrole — mais l’essentiel de sa richesse est perdue dans les méandres d’un gouvernement qui ne
fonctionne pas et est miné par des rivalités de tribus et factions. Les dépenses de santé y sont inférieures à 30 dollars par an et
par habitant, contre 191 dollars au Botswana, selon la Banque mondiale. La durée de vie moyenne ne dépasse pas 56 ans."Le
délabrement des services publics est difficile à imaginer. Vous avez des postes de police sans meubles, sans téléphone, sans
voiture ni essence, sans rien pour faire quoi que ce soit", déclare Hugh White, ex-secrétaire général adjoint du ministère
australien de la Défense et directeur actuel de l’Australian Strategic Policy Institute.
Résultat, la Papouasie "est l’un des pays les plus dangereux du monde", selon l’Economist Intelligence Unit. Autre
conséquence, le sida est en train d’y prendre une proportion catastrophique. Un habitant sur 100 est séropositif et le nombre
s’accroît de 20% par an, soit 150 nouveaux cas par mois, selon Shigeru Omi, le directeur régional de l’Organisation mondiale
de la santé. "La Papouasie-Nouvelle-Guinée s’achemine vers le niveau d’épidémie de VIH/sida que nous connaissons
aujourd’hui en Afrique sub-saharienne", dit-il.
Dans ce contexte, les dirigeants du pays ont répondu favorablement à l’initiative australienne, d’autant que l’économie donne
des signes de redémarrage après trois ans de récession.
3 – Quelles voies de développement ?
Globalement, les pays océaniens indépendants ne peuvent lutter dans la cour des Grands. Ils n’ont pas
les reins assez solides et manquent d’argent, de « cerveaux », d’infrastructures.
La voie traditionnelle : agriculture et pêche de subsistance. Insuffisante.
Les pays océaniens vivent essentiellement de l’agriculture ou de la pêche de subsistance, qui suffisent
à peine à nourrir les populations et qui ne sont pas pourvoyeurs des devises nécessaires au
fonctionnement de l’économie de marché dans laquelle ils s’inscrivent nécessairement, même à la
marge.
La mise en valeur des richesses naturelles a ses limites…
Le développement économique passe alors par la mise en valeur des richesses naturelles, comme la
mer, la forêt ou les gisements de cuivre, d’or, d’hydrocarbures…Mais ces petits pays n’ont pas les
finances suffisantes pour en assurer l’exploitation et confient celle-ci à des multinationales étrangères,
pour l’essentiel australiennes. Le néo-colonialisme se met alors en marche : diktat des grandes
sociétés, pillage des ressources, mais aussi peaux de vin, corruption pour obtenir les marchés ou les
licences d’exploitation… Parfois de fortes réactions de rejet de la part des populations locales viennent
gripper le mécanisme et les exemples sont nombreux de sociétés qui au bout du compte ont dû plier
bagage suite au climat hostile dans lequel elles devaient travailler.
Les malheurs des sociétés australiennes en Papouasie Nouvelle-Guinée…
L’Australie a particulièrement investi dans le secteur minier en Papouasie Nouvelle-Guinée, obéissant à une logique néo-
colonialiste qui l’a conduit à un pillage des richesses au mépris des intérêts des populations en place qui ont fini par se
rebeller. Cette insécurité s’est amplifiée avec la guerre de sécession de Bougainville, qui a obligé la société australienne
Conzinc Riotinto Australia (CRA) à fermer l’énorme gisement de cuivre de Panguna. Ailleurs dans le pays, l’insécurité a
conduit la même société, CRA, à fermer en 1993 le site aurifère de Mount Karé qu’elle avait ouvert en 1990. Dans un autre
registre, à Ok Tedi (la plus grande mine de cuivre du monde), la BHP Billiton (Broken Hill Proprietary Billiton) a dû stopper
toute activité, pour avoir provoqué, par manque de précautions, un désastre écologique sans précédent dénoncé par la
communauté internationale. Ailleurs encore, à Porgera, la même BHP Billiton a fini par revendre ses parts à une société
canadienne. Par contre, les Australiens se maintiennent dans de nombreux autres sites, comme celui du gisement d’or de
Tolukuma, situé à 100 km au nord de Port Moresby et à plus de 2 000 mètres d’altitude. Tolukuma est un énorme gisement
d’or exploité depuis 1995 par l’Empire Mining Limited, dont le siège est à Spring Hill, dans la banlieue de Brisbane.
Et le tourisme aussi
Le tourisme obéit à des règles similaires. Le développement touristique passe par la construction de
grands hôtels et par l’ouverture de liaisons aériennes que seules peuvent assurer les grandes firmes
multinationales. Là encore, une partie des bénéfices échappe au pays d’accueil.
Le tourisme à Fidji : entre les mains des compagnies internationales ?
Les grands hôtels sont nombreux à Fidji. Ils sont situés soit sur Suva et autour de Nandi, soit sur la Côte de Corail.
« La plupart des grands resorts appartient à des compagnies internationales. Le gouvernement joue un rôle mineur en cette
affaire. Ces hôtels de luxe appartiennent à des chaînes connues dans le monde entier comme Regent, Shangri-la, Hilton, le
groupe Sheraton ou, moins cotés, Courtesy Inn ou Travelodge…
Le tourisme rapporte plus que le sucre, mais 45 % des gains quittent le pays comme profits réalisés par les chaînes hôtelières
internationales ou en dépenses de produits à l’importation… »
Par ailleurs, le tourisme est un secteur économique fragile, très lié au contexte politique ou
économique intérieur ou international. En cela, Fidji est un exemple parfait. Le chiffre de la
fréquentation touristique de l’archipel fidjien s’est effondré à partir de 2006, de par les effets
conjugués de la crise mondiale à l’extérieur et de l’installation de la dictature à l’intérieur (boycott de
la part des principaux pays émetteurs, l’Australie et la Nouvelle-Zélande).
Les niches
D’autres solutions s’offrent aux petits pays indépendants de la région. Ce sont ce que l’on appellera les
« niches », à moins qu’ils n’aient recours, sous des formes variées à l’aide extérieure. Les pays
océaniens indépendants ont fait preuve souvent de beaucoup d’imagination pour subvenir à leurs besoins financiers. Il faut dire que vu leur taille le moindre revenu est bon à prendre et pèse tout de suite sur le budget. On passera en revue ci-dessous quelques voies originales…
Nauru fait feu de tout bois
Lorsque les gisements de phosphate s’épuisent au début des années 1990, il s’avère que les investissements immobiliers se
révèlent infructueux et que les caisses de l’État ont pratiquement été vidées par le détournement de fond et la corruption.
Confrontée à une grave crise économique, l’île voit les présidents se succéder, tentant de remplir les caisses de l’État tandis
que les saisies se multiplient. N’ayant aucune autre ressource que celle qui est en train de s’épuiser, ils font le choix du
blanchiment d’argent, de la vente de passeports, de l’accueil de réfugiés demandant l’asile en Australie et jugés indésirables
dans ce pays (la « solution du Pacifique »), et vraisemblablement du monnayage des votes aux Nations unies à partir du
moment où Nauru y adhère en 1999 et à la Commission baleinière internationale lors de son admission en 2005. Depuis
2004, une nouvelle majorité déclare cesser les activités qui font de Nauru un paradis fiscal et lancer des plans de
restructuration de l’économie nauruane.
Vanuatu plaide pour le paradis fiscal
Pourquoi investir au Vanuatu ?
Il est rare de trouver un tel mariage de paradis fiscal et tropical comme il existe au Vanuatu.
Le pays peut se targuer d’être un paradis fiscal hors du commun, caractérisé par des traits uniques comparé aux autres
centres financiers :
Il n’y a pas d’impôt sur le revenu au Vanuatu, pas d’impôt retenu à la source, pas d’impôt sur les plus values, pas de droits de
succession ou de contrôle des changes. L’argent est facilement transférable dans toutes les devises principales, et il n’est pas
nécessaire de déclarer les mouvements de fonds.
• Le Centre Financier de Vanuatu existe depuis plus de 30 ans, bien plus longtemps que bon nombre de ses concurrents. Il
est doté d’une infrastructure bien établie, constituée d’avocats, d’experts-comptables, de sociétés fiduciaires et de banques et
ceci lui permet d’offrir aux investisseurs un service sûr et de haute qualité, "sur le champ".
• Le pays a un environnement multiculturel unique. Ceci est un héritage des temps du Condominium avant son
indépendance en 1980 quand il a été gouverné à la fois par la France et la Grande-Bretagne. Il y a trois langues officielles,
l’anglais, le français et le bichelamar.
• Il y a de vastes étendues de terres non-cultivées. Près de la moitié des terres du Vanuatu ont un excellent potentiel agricole.
• La main d’œuvre non qualifiée ne manque pas au Vanuatu et il y a un nombre croissant d’ouvriers qualifiés. Le prix de la
main d’œuvre est encore peu élevé.
Le Gouvernement est particulièrement intéressé à encourager l’investissement dans le tourisme, l’agriculture, la pêche, la
sylviculture et les produits du bois. L’idée dominante du Gouvernement est d’encourager les industries à main d’œuvre
intensive, utilisant des produits locaux pour être moins tributaire des importations.
Le pays a vraiment besoin d’investissements non seulement pour moderniser les hôtels qui existent mais aussi pour
construire de nouveaux hôtels et pour développer l’infrastructure touristique dans son ensemble.
D’autre part, notez également que les divers experts-comptables et avocats de ce paradis fiscal peuvent toujours trouver des
façons et des moyens de réduire l’impôt sur le revenu que vous pourriez payer à l’étranger (si, pour quelque raison qui nous
échappe, vous voulez toujours vivre dans un pays accablé de taxes). Le Centre Financier de Vanuatu est spécialisé dans l’art
de rogner jusqu’au minimum les taxes que vous êtes appelé à payer dans votre pays de résidence. Aussi, si vous avez un
moment de libre pendant votre séjour au Vanuatu, n’hésitez pas à venir consulter un de nos experts.
Tuvalu : la location de domaine Internet… et ses problèmes
Le nom de domaine .tv a été ouvert à toutes les compagnies de tous les pays par le gouvernement des Tuvalu.
Ce nom de domaine est très populaire. TV étant l’abréviation de télévision dans plusieurs langues.
En 2000, la gestion et la revente du nom de domaine ont été cédées par le gouvernement des Tuvalu à la société
dotTV, une filiale de VeriSign, pour 12 ans en échange de 50 millions de dollars américains. Cette vente a
apporté d’importants revenus au micro-État, qui était, avant la vente du domaine, l’un des pays les plus pauvres
au monde. La société dotTV est détenue à 20 % par le gouvernement des Tuvalu.
Mais la manne financière engendrée par cette vente est un sujet de controverses dans le pays. Une partie de la
population locale s’élève contre cette pratique, car de nombreux sites du domaine sont des sites à caractère
pornographique. La majorité de la population étant de confession chrétienne, cet argent est considéré comme
étant impur.
Malgré les controverses, l’argent récolté a permis d’améliorer les infrastructures routières
Les ventes de voix à l’ONU
La Chine apparaît comme un des grands acteurs en Polynésie, Mélanésie et Micronésie. Elle y offre son aide financière et son
assistance technique. Mais elle y met une condition : les pays aidés ne peuvent maintenir de relations diplomatiques avec Taiwan. De son côté, Taiwan fait ce qu’il peut, dépensant annuellement des dizaines de millions de dollars, pour acheter la
reconnaissance des petits États du Pacifique contre la cessation immédiate des relations des pays concernés avec la Chine.
Le choix des petits États du Pacifique n’est pas un choix idéologique. Il est uniquement motivé par des intérêts financiers. La
Chine et Taiwan pratiquent la « politique du chéquier ». À ce jour, Samoa, Tonga, les îles Cook, Niue, Fidji, Vanuatu, les
États fédérés de Micronésie et la Papouasie-Nouvelle Guinée, ainsi que l’Australie et la Nouvelle-Zélande, sont avec la
Chine, alors que Palau, les îles Marshall, Kiribati, les îles Salomon, Nauru et Tuvalu sont avec Taiwan. Plusieurs nations
jonglent avec ces alliances, allant vers le plus offrant, comme le Kiribati qui est passé de la Chine à Taiwan.
La rente stratégique
Seules les bases militaires, en particulier celle de Kwajalein (îles Marshall), spécialisée dans la réception des missiles lancés
par les États-Unis depuis la Californie, restent rémunératrices. Les revenus compensatoires aux expérimentations nucléaires
américaines (de Bikini et Eniwetok) et françaises (Moruroa et Fangataufa) apportent aussi pour un temps une stabilité
budgétaire importante… Mais rapidement la rente stratégique des petits pays insulaires risque de décliner …Depuis la
signature par la France et les États-Unis du traité de dénucléarisation du Pacifique Sud rédigé à Rarotonga (îles Cook) en
1985, la sanctuarisation du Pacifique peuplé semble acquise.
Les aides
Pour beaucoup de pays indépendants de la région, les solutions traditionnelles comme les
options plus originales ne peuvent suffire à leur développement. Trop petits, sans ressources
propres, trop isolés… Leur salut passe alors par l’aide extérieure…
Un exemple d’aide : les îles Palaos.
20 000 habitants seulement habitent les Palaos, pays qui ne produit quasiment rien. Or, le PNB par habitant des Palaos est de
l’ordre de 10 000 dollars par an, essentiellement dû aux aides conjuguées des États-Unis, du Japon et de Taiwan. Bien
qu’aucun document officiel ne le prouve, il est raisonnable d’estimer que Taiwan participe pour la moitié à ce PNB par
habitant (5 000 dollars). Depuis 1999, Taiwan a donné environ 100 millions de dollars, se répartissant ainsi : 3 millions pour
la construction d’un centre de conférences, 2 millions pour le Musée national, 15 millions pour l’extension de l’aéroport, 20
millions pour la construction de la nouvelle capitale, Melekeck, 1 million pour la rénovation des écoles…
Aide financière et transferts. Le système MIRAB
Avant tout, les pays de l’Océanie intertropicale s’inscrivent, quels qu’ils soient et à des degrés divers, dans un système d’aide
financière, à laquelle contribuent à leur mesure l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ne sont pas les premiers bailleurs de
fonds en ce domaine. Ce système d’aides est assez bien résumé dans ce que deux chercheurs anglo-saxons, Bertram et
Watters, ont appelé le système MIRAB : MI comme migrations (émigration des jeunes actifs vers les pays riches), R comme
remittances (mandats envoyés par les travailleurs émigrés à leurs familles), A comme aid (aide internationale multilatérale et
bilatérale), B comme bureaucracy (poids important de l’administration dans les emplois, financés par l’aide internationale)…
Certains ont également proposé le sigle MIRAGE, qui s’obtient en remplaçant Bureaucracy par Government expenditure,
sans doute plus explicite.
On peut distinguer plusieurs formes d’aides et de transferts :
– le binôme Migrations / Remittances, qui est élevé à l’état d’institution par un certain nombre de petites entités de
Polynésie centrale dont c’est la principale source de revenus (voir dossier).
-* les aides bilatérales, qui sont les plus fréquentes et les plus conséquentes. Elles sont fournies par les métropoles
(France, États-Unis) ou les anciennes métropoles (Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Australie) sous forme de contrats de
plans. Elles se caractérisent par des transferts financiers qui peuvent être très importants (Nouvelle-Calédonie, Polynésie
française, Guam, par exemple) ou par l’envoi de personnels qualifiés (techniciens, fonctionnaires) rémunérés par la puissance
protectrice. On notera que dans ce volet ce ne sont pas, et de très loin, les puissances océaniennes qui investissent le plus.
Australie et Nouvelle-Zélande se caractérisent même par une assez grande frilosité. Quant aux États-Unis ou à la France, le
volume de leur contribution est (ou a été) à la mesure de leur volonté de se maintenir dans la région, entre autre pour des
raisons stratégiques (essais nucléaires, bases de lancement de missiles, stations de surveillance, richesses naturelles, etc.).
Cette présence a un prix, élevé. Les pays insulaires passent aussi des accords ponctuels avec certains pays asiatiques, comme
la Chine par exemple (c’est la Chine qui a financé en grande partie les installations sportives construites à Suva pour
accueillir les Jeux du Pacifique de 2003.)
-* les aides multilatérales, qui sont un complément aux aides bilatérales. Moins importantes, elles portent sur des
projets et répondent souvent à des demandes précises. On retrouve ici les contributions de la France, du Royaume-Uni, de
l’Australie et de la Nouvelle-Zélande dans le financement des actions de la Communauté du Pacifique ou du Forum, ou bien
l’Union européenne qui soutient les programmes de développement dans le cadre du FED.
Un exemple d’aide bi(tri ?)latérale (AusAid et NZAid au Van uatu)

Les aides : impact et conséquences
Une délégation chinoise a été accueillie par le Premier ministre samoan, Tuilaepa Sailele Malielegaoi, « Le gouvernement et
le peuple samoans souhaitent remercier la Chine pour son aide dans la construction des installations sportives
exceptionnelles réalisées pour les XIIIe Jeux du Pacifique qui se tiendront en août 2007 » a dit en substance le Premier
ministre.
La Chine a envoyé également des techniciens et des entraîneurs pour ces Jeux. Mais le sport n’est pas le seul domaine dans
lequel la Chine accorde une assistance à ce pays de 180 000 habitants. Elle a construit également plusieurs bâtiments
gouvernementaux dans la capitale samoane, Apia.
Pour beaucoup de pays du Pacifique, l’aide étrangère est un business majeur et très lucratif, qui ne coûte pas très cher à la
puissance donatrice. Par exemple, 20 000 habitants seulement habitent Palau, pays qui ne produit quasiment rien. Or, le PNB
par habitant de Palau est de l’ordre de 8 000 dollars par an, essentiellement dû aux aides conjuguées des États-Unis, du Japon
et de Taiwan. Bien qu’aucun document officiel ne le prouve, il est raisonnable d’estimer que Taiwan participe pour la moitié
à ce PNB par habitant (4 000 dollars). Depuis 1999, Taiwan a donné environ 100 millions de dollars, se répartissant ainsi : 3
millions pour la construction d’un centre de conférences, 2 millions pour le Musée national, 15 millions pour l’extension de
l’aéroport, 20 millions pour la construction de la nouvelle capitale, Melekeck, 1 million pour la rénovation des écoles…
Ces aides sont dangereuses. Elles provoquent la montée de la corruption au plus haut niveau (on achète les dirigeants pour
qu’ils changent de bord) et favorisent le maintien au pouvoir de systèmes féodaux, par lesquels passe l’argent. Les récentes
émeutes dans de nombreux pays de la région sont révélatrices de la colère des populations conscientes de ne bénéficier que
des bribes de cette aide qui ne fait que renforcer les pouvoirs et la richesse de la minorité privilégiée qui gouverne.
Une aide déguisée : les retours de salaires des expatr iés. L’exemple de Samoa : mobilité, tradition et adaptation
La demande en immigrants a été forte en Nouvelle-Zélande au cours des années 1960. Les premières migrations
des Samoans ont été individuelles. Mais leur importance a fait que, dans les années 1970, presque toutes les
familles samoanes avaient déjà des parents installés en Nouvelle-Zélande. Avec la crise p étrolière, l’immigration
a été limitée. Elle l’est encore aujourd’hui par des quotas.
En 1966, 8 % des Samoans vivaient outre-mer. Ils étaient 16 % en 1 975 et 33 % dans les années 1980, répartis
sur 30 nations différentes. Aujourd’hui, ce sont 200 000 Samoan s, nés à Samoa, qui vivent à l’étranger.
Les raisons qui poussent les Samoans à migrer sont liées à la poursuite des études, au désir de découvrir un autre
milieu que l’on pense plus attractif, à la volonté de gagner de l’argent pour aider la famille. Ce dernier point est
important. Les migrations de travail permettent de rapatrier une partie des salaires sur Samoa (phénomène de
« remittance »). Les sommes récupérées représentent plus du tiers des revenus du pays !
Mais cette attiran ce vers l’extérieur crée une déstabilisation sociale. Les jeunes veulent partir en grand nombre.
Ceux qui ne peuvent le faire l’acceptent mal et on a noté un accroissement de la consommation d’alcool, de la
délinquance et des suicides. Ce contact avec l’extérieur fait également que l’on supporte moins le cadre social
traditionnel largement dominé par les chefs (les matai) dont l’autorité est discutée.
Les aides peuvent avoir un coût, celui de l’ingérence…
… Le sous-sol papou recèle d’importantes ressources minières (or, cuivre) et énergétiques (pétrole) qui en font
un enjeu pour les multinationales. Celles-ci ont tout intérêt à ce que le calme et la sécurité y soient rétablis.
Comme les capitaux australiens sont particulièrement représentés dans cette affaire, on comprend que l’ancien
colonisateur se montre soucieux du maintien de son influence dans cette région du globe et s’implique directement dans les affaires intérieures de la Papouasie Nouvelle-Guinée, même si la complexité de la situation
et l’insécurité chronique ne rendent pas les choses faciles (voir document).
L’Australie a lancé un programme d’aide de cinq ans qui se donne pour objectif de ramener l’ordre dans le pays.
Cette opération doit coûter 900 millions de dollars australiens et suppose l’intervention directe de quelques
centaines de militaires et de policiers qui ont pour tâche prioritaire de lutter contre les gangs urbains et de réduire
les affrontements tribaux, nombreux sur les hauts plateaux. Ce rétablissement de l’ordre est jugé nécessaire pour
que soit prolongée l’aide technique et financière australienne diligentée entre autres par AusAID, l’organisation
australienne d’aide au tiers-monde. On est ici dans la logique de l’aide sous condition (autrement appelée
« politique d’ajustement structurel ») qui permet l’ingérence des grandes puissances dans les affaires intérieures
des pays du tiers-monde afin de contrôler l’utilisation et l’efficacité de ce qu’elles donnent.
On notera que, malgré les difficultés actuelles, des liens économiques étroits sont entretenus entre le
gouvernement papou et les milieux d’affaires australiens. On en veut pour preuve l’activité de l’APNBC, un
bureau d’affaires indépendant qui s’est donné pour tâche de favoriser les investissements australiens en PNG et
de développer le commerce entre les deux États.
Documents joints
La situation de l’Océanie en 1945
PDF - 34.4 kio
Les défis politiques
PDF - 144.6 kio
L’émancipation des colonies
PDF - 60.8 kio
Géopolitique de l’Océanie
PDF - 212 kio
Les défis économiques et sociaux
PDF - 252.7 kio
Dans la même rubrique
La Nouvelle-Calédonie de 1946 à 1975
Ce corpus documentaire propose 76 documents en rapport avec les programmes des classes de troisième et de terminale générales.
Ces héros venus d’Outre-mer 1939-1945
Exposition et série de témoignages sur les engagés du Pacifique, de l'Océan Indien et de l'Atlantique
Le gouvernement et l’administration de la Nouvelle-Calédonie depuis 1945
Une contribution en histoire